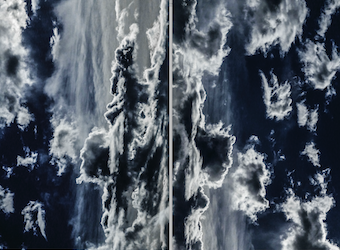Kant avait décrit la présence d’une force vitale chez l’humain1. Freud nommera cette force « pulsion de vie », et fera de sa lutte contre la pulsion de destruction le contenu essentiel de la vie2. On comprend alors que vivre n’a rien d’évident chez l’humain. Lacan a défini les conditions du vivant en termes de sentiment de la vie3 et de son désordre dans la psychose. Établi très tôt dans l’existence, le sentiment de la vie repose sur le nouage des catégories du symbolique, de l’imaginaire et du réel, d’où procèdent le sens de la vie, le désir de vivre et l’existence, soit la modalité singulière et primordiale d’articulation de la vie, du langage et du corps vivant. Ce nouage assure à chacun son style de vie. La vie va plus ou moins à la dérive selon la tenue du nœud inaugural, que les circonstances heureuses et malheureuses mettent à l’épreuve.
Alors que chacun tente de trouver une stabilité, les signifiants-maîtres contemporains poussent à profiter toujours plus de la vie, sous la forme d’une jouissance extrême qui met à mal l’équilibre recherché. Or, ce pousse-à-jouir de la vie est impossible : comme réel, elle est hors sens, abstraite, insupportable. Il n’y a pas d’accès direct à la vie. On ne fait qu’éprouver des rencontres, des idées, une liberté retrouvée, un amour naissant, « le rayon d’un soleil du soir4 » ou « Baltimore au petit matin5 ».
Il arrive que l’impression de vivoter ou que l’absence du désir de vivre conduisent à l’analyse. Celle-ci change le rapport à la vie, non à partir d’un idéal, d’une injonction surmoïque ou d’une identification, mais à partir des effets d’existence que le dire analytique occasionne. De même que « Sade n’est pas dupé par son fantasme6 », l’analysé n’est plus contraint par l’homéostasie fantasmatique et symptomatique initiale, mais il obtient un gain de désir qui assure une nouvelle assise subjective à sa vie.
Avec l’analyse, l’inertie n’est plus de mise. La pulsion vitale s’allie à l’objet du désir, la vie est reconfigurée et trouve une cohérence. Une analyse aide à vivre. Un sujet se sent plus vivant quand, via le transfert analytique, une signification est donnée au vide qui l’habitait, quand des identifications imaginaires viennent à soutenir son corps ou qu’une nomination singulière lui donne place dans le monde. De même qu’un sujet peut retrouver une certaine joie de vivre lorsque l’analyse allège son angoisse sociale ou les exigences écrasantes du surmoi.
Ainsi, vivre relève de l’inconscient et du rapport à l’autre. Laissé à lui-même, le sujet est voué à la répétition, la peur s’impose à lui, son monde s’amenuise. Seul, le sujet peut préférer la mort à la vie. D’autant que, dans sa dimension inéluctable, la mort « futilise » la vie. A contrario, parce qu’elle fait apercevoir et surplombe le trou du non-rapport, une analyse procure une force de vie. Le relief d’une existence, sa valeur, l’attachement qu’on lui porte, ne peut que se dire. Cerner ce qui fait le ressort du joint intime du sentiment de la vie d’un sujet se révèle donc essentiel dans une analyse.
Caroline Doucet
[1] Cf. Kant E., Anthropologie du point de vue pragmatique, Dijon, Imprimerie J.-E. Rabutot, 1863.
[2] Cf. Freud S., Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1986, p. 78.
[3] Cf. Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 558.
[4] Loti P., Le livre de la pitié et de la mort, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2023, p. 3.
[5] Lacan J., « De la structure comme immixtion d’une altérité préalable à un sujet quelconque. Conférence à Baltimore, 1966 », La Cause du désir, no94, 2016, p. 10.
[6] Lacan J., « Kant avec Sade », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 778.