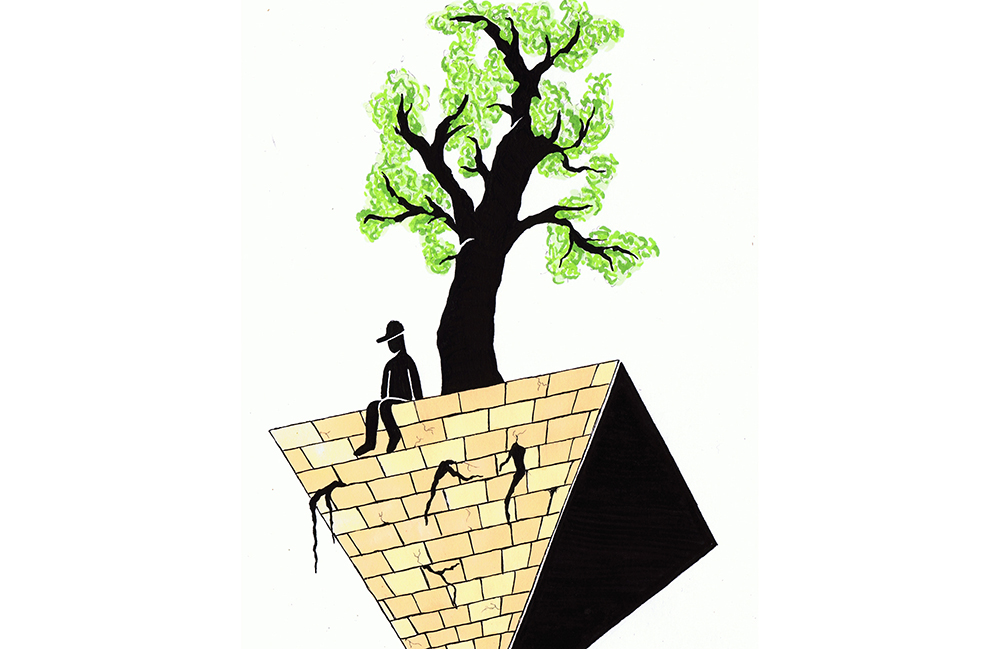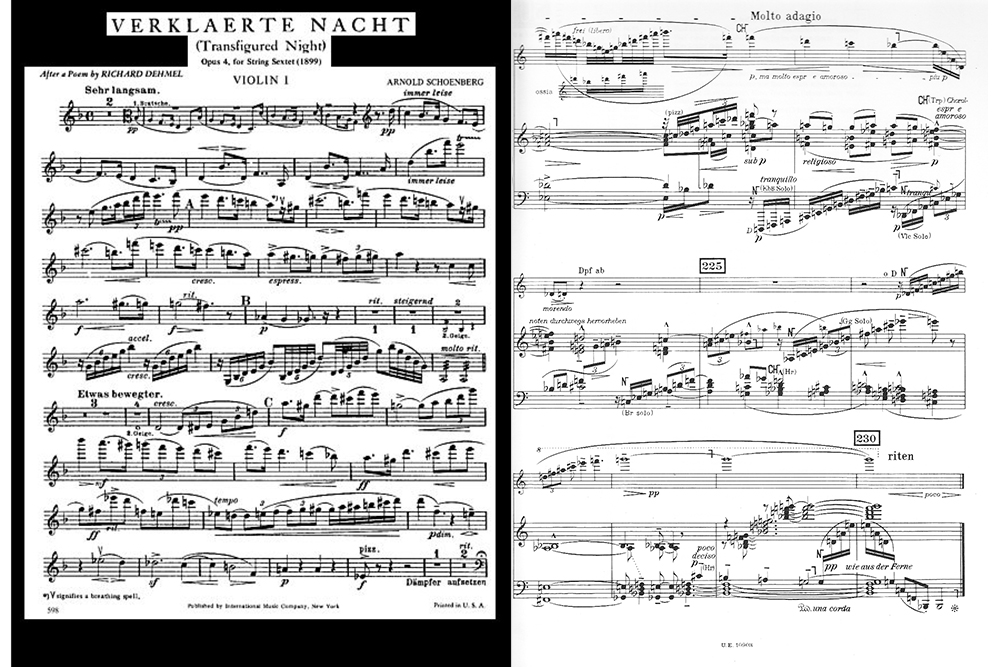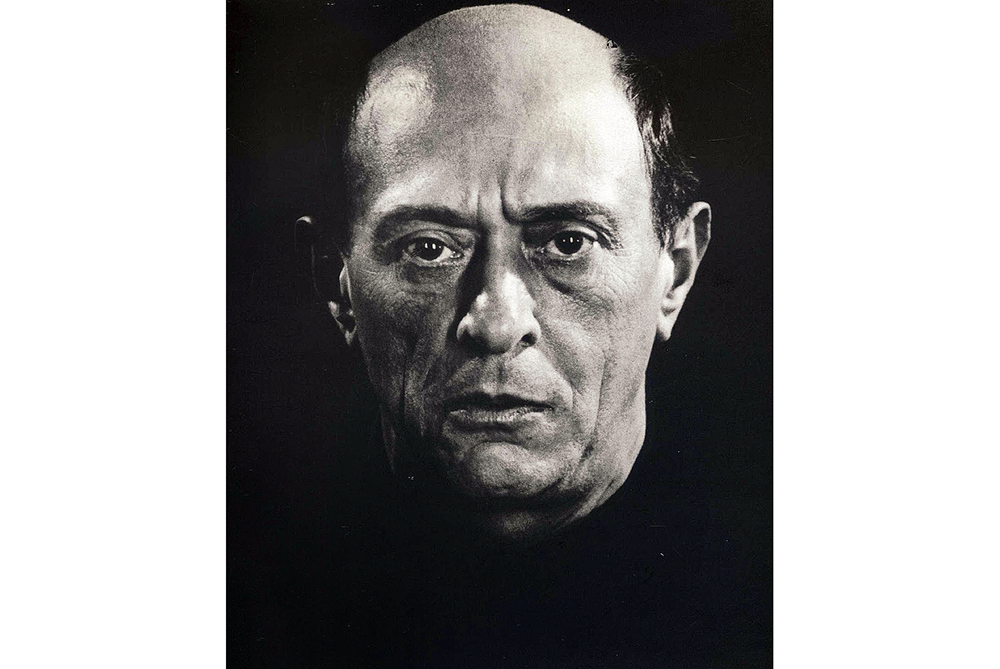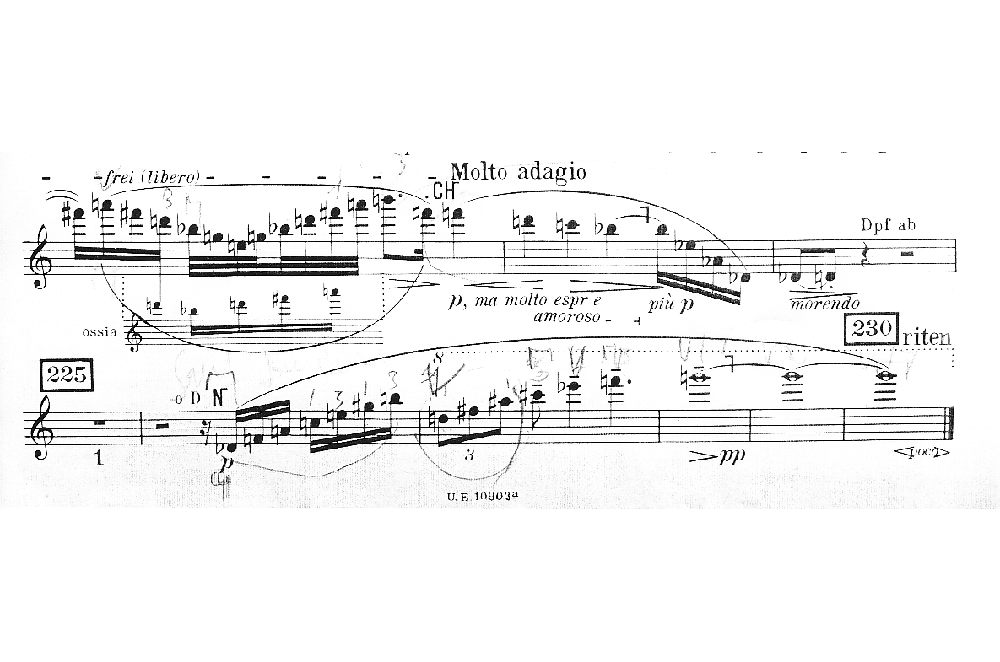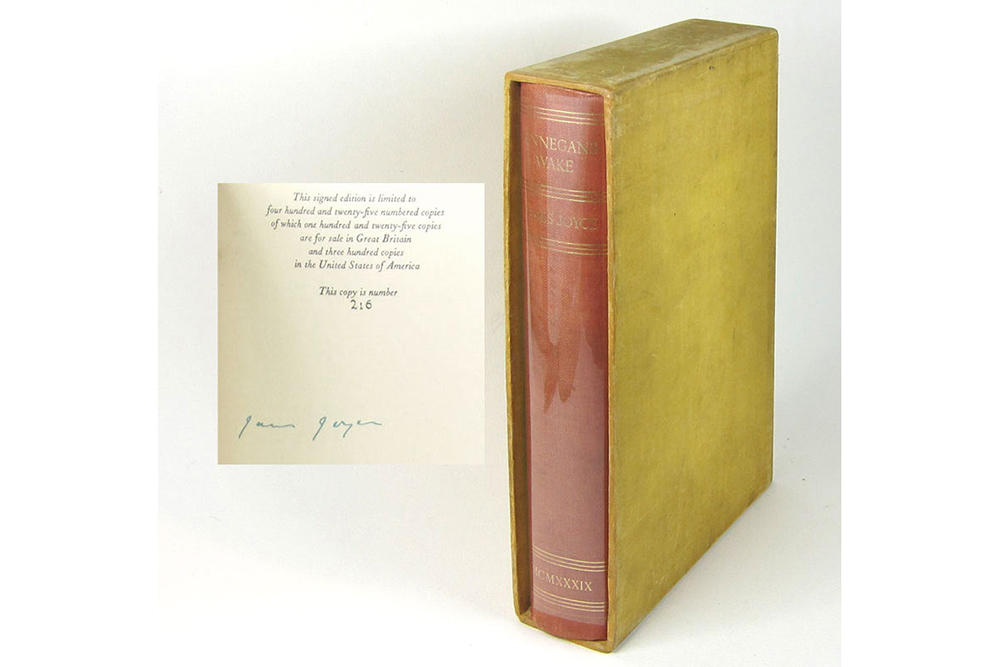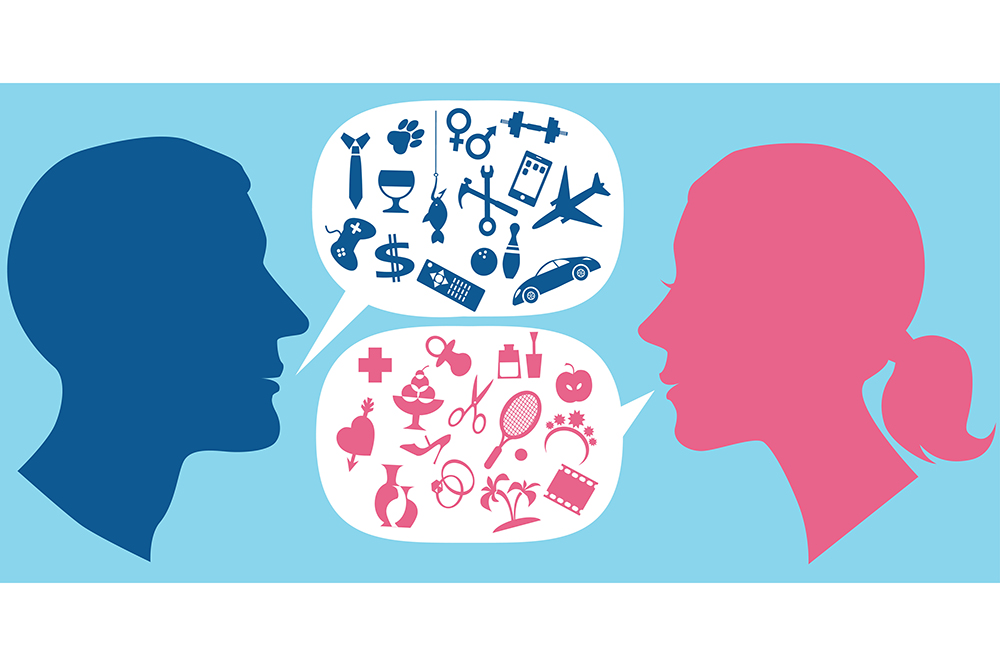Ce sont les idées suicidaires de leur fils Noé, 11 ans, qui amènent M. et Mme B, sur les conseils de la thérapeute de l’enfant, à consulter au CPCT « Centre Parent ». En effet, cela n’est étranger, ni pour M., ni pour Mme, quotidiennement assaillis de telles pensées. Un traitement est proposé à chacun des parents.
Un écho
Je reçois M. B. inquiet pour son fils. Il dit à ses parents qu’il veut se suicider, particulièrement dans les moments où ces derniers lui adressent une demande contraignante. M. B. est très embarrassé par ce « chantage affectif », auquel il ne sait quoi répondre.
Cela fait en effet « des échos » avec ses propres idées suicidaires, survenues à 10 ans, au même âge que son fils, dans « les moments de vide ». Ses idées suicidaires se sont apaisées à 16 ans, après une année de lycée où il était interne et vivait « replié sur lui-même ». Il a « observé le monde et cherché à comprendre comment ça se passe, notamment les enjeux de pouvoir entre les personnes ». Les idées suicidaires se sont arrêtées à 22 ans, quand il a commencé à travailler.
L’énigme de la langue
À la naissance de son fils, il s’est produit un événement : « Avec ma femme, on a changé de langue » me confie M. B. C’est plutôt vers les 3 ans de Noé qu’ils ont dû faire attention à leurs propos et surtout à leur vocabulaire, réalisant que l’enfant répétait tous leurs dires, y compris les gros mots. À cette occasion, M. B. constate qu’il comprend mieux ce qu’il veut dire en me l’expliquant. Un axe de travail se dessine : faire traduire à M. B. les énoncés énigmatiques de sa langue dans le discours commun.
M. B évoque à travers ce qu’il rencontre avec son fils, les éléments de sa propre position subjective. Il se dit coincé entre les plaintes de sa femme à propos de leur fils et les paroles de celui-ci, regrettant ce qu’il nomme sa « naïveté situationnelle ». « Je reçois ce que dit l’autre sans filtre. Un quart d’heure après j’ai l’impression de m’être fait avoir ». Aussi demande-t-il à pouvoir extraire de chaque rencontre « quelque chose d’utile concernant son fils », gain dont il doit s’assurer pour supporter le risque et la perte qu’implique la prise de paroles. M. B. constate au quatrième rendez-vous que Noé ne parle plus d’idées suicidaires.
Diriger ou transmettre
La rentrée scolaire de Noé dans son nouvel établissement se déroule bien. M. B. évoque un projet : acquérir un diplôme d’ingénieur. Depuis six ans, il se forme par correspondance et passe un à un les modules requis. Il s’entend et constate qu’il « fragmente » ; c’est sa « technique » pour « rapetisser la montagne de l’inconnu » en créant des séquences définies. Il existe pour lui deux moyens de poursuivre sa carrière : « diriger ou transmettre ». Il a eu une petite expérience de direction d’équipe qui s’est avérée douloureuse. M. B. dépliera comment, perdu dans le discours de chacun de ses collègues, il ne pouvait prendre une position pour tous. Je soulignerai ce point de savoir sur lui-même, comme un élément important qui l’oriente. Transmettre, enseigner, est donc ce qu’il privilégie désormais. Fragmenter est aussi ce qu’il propose pour ses rendez-vous : « un par mois » !
Un équilibre
Au mois de décembre M. B. se présente « malade ». « Noé ça va. Il n’est plus victime dans son collège : s’il est maigrichon, comme M. B., pour se défendre des autres, il pratique désormais : la défense par la rhétorique ». Depuis 3-4 jours, M. B est assailli de « vertiges ». C’est comme « une imprécision dans l’espace », me dit-il. « Je me cogne dans les portes, ma démarche est moins assurée. » Il est « épuisé » par le rythme effréné auquel il est soumis dans son travail. Il y a 3-4 mois son supérieur, avec lequel il travaille depuis quinze ans, a quitté son poste pour un autre plus élevé. Le poste vaquant a été proposé à M. B. Celui-ci l’a refusé évitant ainsi la fonction qui risquerait de le précipiter dans le trou forclusif. Mais cela implique de se séparer de son collègue, un appui jusqu’alors indéfectible.
Dans ce moment, son fils apparaît plus agressif. M. B. peut aussi évoquer sa propre méchanceté. Il s’est emporté, « de façon vulgaire », pour signifier à sa femme et à son fils qu’il en avait « marre ». Je demande des nouvelles de sa situation professionnelle. Il m’avoue que son ex-supérieur avait dit de lui qu’il était « inactif » ! Il a su trouver « l’équilibre » entre le mordant de la réplique cinglante qu’il imaginait, réduisant l’autre au silence, et son souhait d’être entendu.
Quel équilibre pour un super-héros ?
M. B. raconte les interventions nocturnes sur le réseau informatique et les jours de travail qu’il enchaîne ensuite sans repos. Je me permets d’évoquer le droit du travail qui régule et organise les heures de récupération nécessaires. M. B. craint pour son emploi s’il ne répond pas « complètement » à ses supérieurs. Et puis, il a « l’ego du super-héros ». « Être le seul à pouvoir répondre », le pousse sur une pente mégalomaniaque : « je me sens toujours hyper balaise », me dira-t-il. Cela lui permet, certes, de recouvrir son être fondamentalement dévalorisé, mais ne trouve chez lui aucune limite et risque de le conduire à l’épuisement total.
Le contrepoint de cela est l’appui qu’il trouve sur un nouveau « binôme », un « technicien » lui aussi affecté aux interventions nocturnes. « La transmission des éléments techniques » à ce collègue permet de « dégonfler l’aura mystique de la charge de travail ». Alors que je le raccompagne jusqu’à la porte, il me dira se renseigner auprès de ses collègues sur le code du travail. J’ajoute alors : « mais oui, c’est un outil ! »
Quelques bords ?
M. B. constate que Noé parvient à nouer des relations avec ses camardes de classe, trouvant ses propres solutions.
La situation professionnelle de M. B. s’est apaisée. Quant à son diplôme, il se donne encore deux ou trois ans pour le valider.
La dernière séance lui donne l’occasion « d’extraire les points utiles » de nos rencontres. « Tout en haut de la pyramide », il note ce point crucial : « avec mon fils on se ressemble, mais nous sommes distincts. » M. B. indique que parler de son fils est aussi une nécessaire introduction à toute prise de parole. « Je m’objective pour parler de moi », conclut-il. Il accepte le nom de quelques « tiers de confiance » possibles, « en cas de besoin », non sans s’assurer d’avoir toujours l’adresse du CPCT.