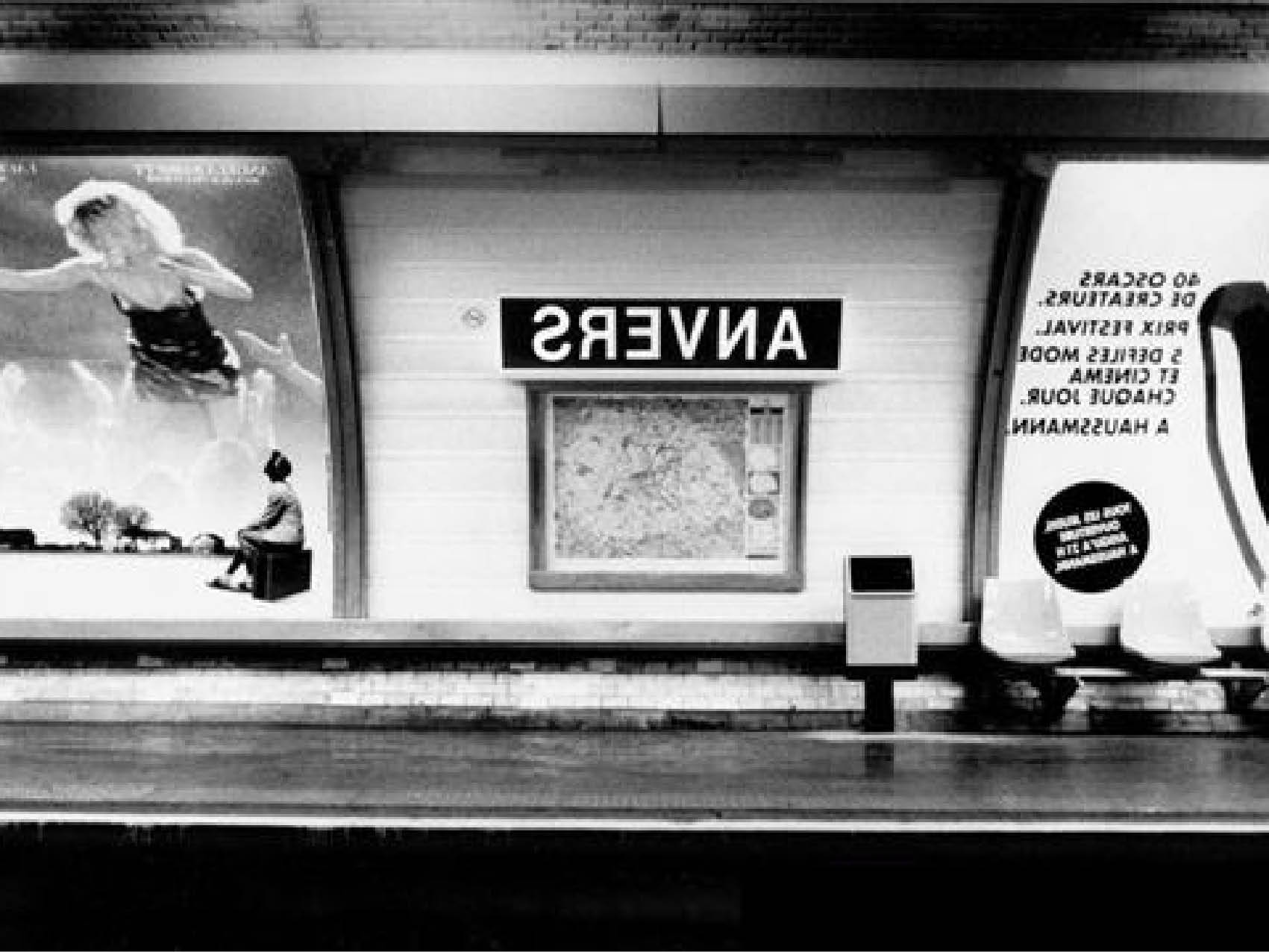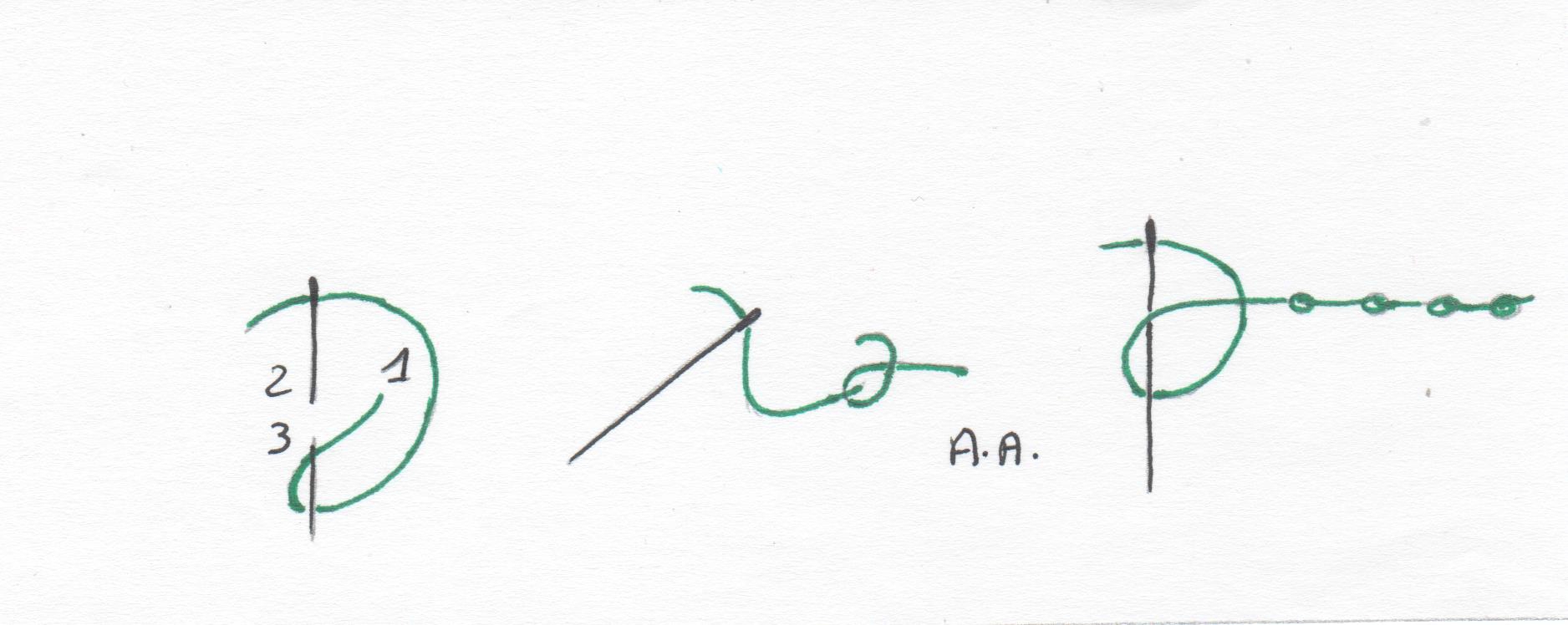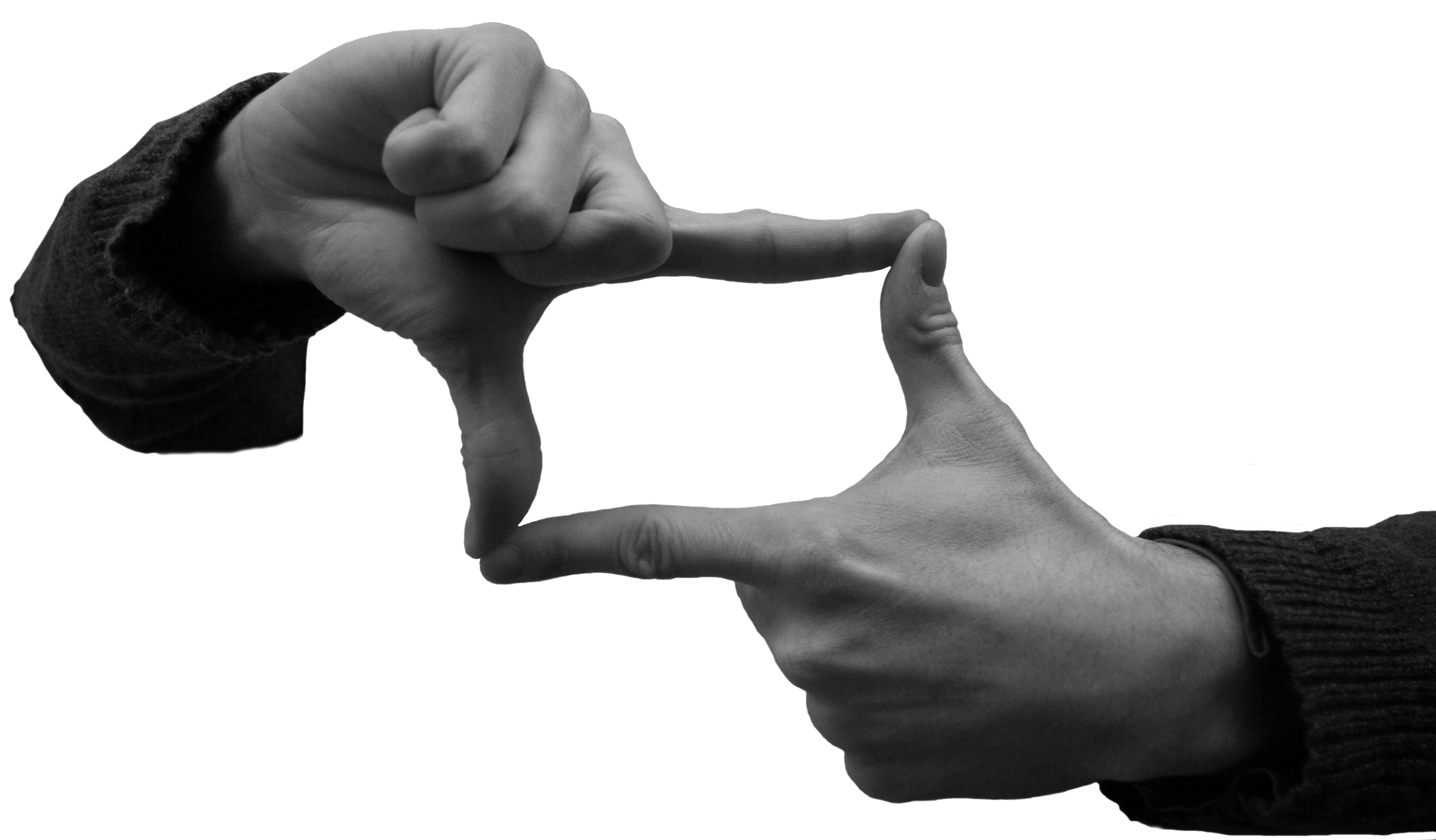Mme F. vient mettre le langage en exercice au CPCT. Le réel de la langue, elle y a affaire sans cesse. Elle livre un « combat » à des pensées qui la désignent comme fautive et qui, « une fois qu’elles arrivent ne la lâchent pas ».
Mme F. a longtemps travaillé dans des magasins de vêtements. Elle aimait conseiller les femmes sur la manière de se vêtir. Un savoir-faire avec le corps qui s’effondre alors qu’un jour elle fait « un petit trou de rien du tout » dans un soutien-gorge, en enlevant une étiquette. Le trou la regarde alors, la dénonçant comme fautive. Le vêtement, tel le voile de l’imaginaire, se déchire et la béance du symbolique apparaît comme un gouffre qui l’aspire.
Point par point, elle me fait part durant les séances de ces bouts d’événements passés et présents, qu’elle relit à la lumière de ce prisme qui fait par battements point de certitude : elle est fautive, quelqu’un serait mort par sa faute.
Mme F. cherche comment limiter ces pensées qui l’envahissent. Elle me fait part de ses bricolages, précaires. Elle trouve abri, tantôt dans le point de croix, qui vient inscrire une forme fil après fil, tantôt dans l’écoute de musiques, allongée sur son canapé. Elle « concentre » sa pensée sur les sons, et s’attache à retenir le titre des morceaux entendus à la radio.
Cherchant à nouer le corps et la langue, elle trouve au CPCT un lieu où il est possible de se séparer, l’espace de quelques instants, de ce qui l’envahit.
Ainsi, elle me dira : « maintenant je mets ces pensées quand elles arrivent dans mon sac et quand je viens ici je pose tout ce qui est dedans ». Elle éprouve aussi un apaisement dans la lecture. Les « romans à l’eau de rose » plantent le décor d’une vie simple. En lisant, elle tisse un voile imaginaire et peut alors s’endormir en s’imaginant être l’héroïne.
J’écoute Mme F. en étant attentive à l’usage qu’elle fait de l’humour. S’il prend souvent la forme de l’ironie, il soutient le vivant du langage et fait appel d’air, alors que sa langue est trop réelle. Je souris volontiers à ses trouvailles, qui sont des manières d’habiller la langue par l’image. Ainsi, pour parler de sa mère qui vit « dans le monde des bisounours » et qui lui parle inlassablement une heure par jour au téléphone, l’abreuvant d’un discours infini sur sa propre vie, elle peut dire en riant : « c’est Marlène Jobert qui raconte les comptines aux enfants : on lance le disque et on attend ».
Je prends parfois appui sur la même légèreté de ton pour l’aider à faire déconsister les signifiants sous lesquels elle s’abrite et qui la désignent de manière trop arbitraire. Un sourire de ma part, un étonnement, une légèreté de ton qui vise à théâtraliser sa perplexité suffisent souvent à soulager la langue de Mme F. de son poids de réel.
Un jour où, en colère, elle me parle de ses pensées qui arrivent sur elle « comme une gifle », elle s’inquiétera de savoir si elle m’a giflée… À cet instant où le mot prend figure de réel, je fais usage du vivant d’un rire léger pour lui adresser d’une voix douce mais distincte : « Vous ne m’avez pas giflée, je peux vous le garantir ! Si vous m’aviez giflée je l’aurais senti ! Vous dites juste votre colère ».
Elle peut alors prendre appui sur cette légèreté de ton pour s’apaiser, et prendre langue en riant : « oui, c’est vrai, et puis si vous étiez inquiète il y aurait déjà la police dans le CPCT et je n’entends pas les gyrophares ! »