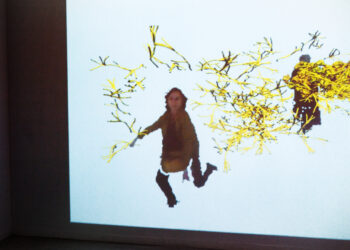Est-ce que l’état amoureux continue d’intéresser les nouvelles générations ? Sous quelles nouvelles formes ?
La rencontre amoureuse et sexuelle me semble encore et toujours au cœur de la parole analysante, mais quelque chose a changé dans le discours sur l’amour. La question de savoir ce que c’est que de consentir, ce que c’est que de dire « oui » sans savoir à quoi, ce que c’est aussi que de n’avoir pu dire « non » , cette question a surgi dans les nouveaux fragments de discours amoureux depuis #MeToo sans doute, mais aussi depuis une sensibilité nouvelle à la complexité de l’aventure amoureuse et sexuelle. S’interroger sur son consentement, c’est apercevoir que le consentement est toujours énigmatique. S’interroger ainsi, c’est aussi quelquefois chercher à distinguer l’expérience amoureuse de celle du forçage, le surgissement de la passion des effets de la mauvaise rencontre. Le récit de Vanessa Springora sur Le consentement1 – adapté récemment au cinéma – a résonné aussi auprès des plus jeunes. Car il s’agit d’une première histoire d’amour pour la jeune fille et en même temps d’une emprise et d’un abus. Cette distinction entre « expérience consentie » et « expérience du forçage » déjoue la confusion entre désir et jouissance, confusion d’autant plus présente que l’événement de la sexualité surgit depuis une mauvaise rencontre.
À partir de l’aphorisme de Lacan « Seul l’amour permet à la jouissance de condescendre au désir2 », qu’est-ce que devient l’amour à l’époque de l’impératif de jouissance ?
Là où la libération sexuelle des années soixante-dix a pu faire miroiter un accès libre au désir, depuis une libération de jouissance, notre moment fait plutôt surgir un questionnement sur la rencontre amoureuse et l’étrangeté du désir. Tout se passe comme si on apercevait qu’au nom de la jouissance, on ne fait pas du tout ce qu’on désire, et qu’on peut même, en venir à maltraiter son désir. Du moins est-ce, ce que l’on peut apercevoir lorsqu’on fait une analyse. Jacques Lacan le formule de façon prophétique dans la première leçon du Séminaire Encore lorsqu’il montre l’enjeu de la question de la jouissance. Ce n’est pas tant celui du droit à la jouissance, que celui du devoir de jouissance qu’il pose. Lacan situe de façon inattendue en cet endroit le devoir kantien – comme en un renversement maléfique du devoir d’obéir à la loi en devoir de jouir sans limite. D’un côté comme de l’autre, le contrat que le sujet passe avec le surmoi garantit la souffrance. C’est donc cette face sadienne du surmoi, celle qui dit « Jouis ! » qui est apparue en notre moment, comme en un après-coup du moment de sa face kantienne qui ordonnait de sacrifier le désir. Jouir, est-ce toujours ce à quoi il faut obéir ? N’y a-t-il pas aussi quelque chose de « toxique » dans le « trop » de jouissance ?
Alors je dirai qu’on voit poindre chez celles et ceux qui découvrent la sexualité et l’amour, un questionnement sur la jouissance qui est nouveau. Oui, quelquefois le « trop » de jouissance, le « trop » de partenaires, le « trop » de dispersion, mettent à mal le désir. Mais ce questionnement amoureux porte aussi finalement sur la difficulté de la rencontre, la difficulté de l’ouverture à la contingence qui seule permet à l’événement de l’amour de surgir. Les sites de rencontre répondent par le régime du nécessaire et de la répétition à l’énigme du kairos amoureux. La rencontre capitale ne va jamais sans la poésie. L’analyse permet aussi quelquefois de ne pas passer à côté de ce qui s’est présenté là, comme par un heureux hasard sur fond d’un subtil émoi entre deux, sur fond d’une parole, d’un regard, d’une lettre, inattendus.
Pour répondre à votre question, oui, je crois que l’on peut vérifier encore aujourd’hui la valeur de l’aphorisme lacanien selon lequel « seul l’amour permet à la jouissance de condescendre au désir » – au sens où l’amour permettrait de tenir compte de l’autre et de ne pas s’arroger le droit de jouir du corps de l’autre aussi longtemps que le caprice des exactions que l’on a le goût d’y assouvir durera.3
Mais cet aphorisme mérite tout de même d’être interrogé au regard de ce que Lacan a pu dire de la jouissance féminine et du ravage que peut aussi être l’amour pour une femme. L’amour peut être une jouissance telle, qu’il pousse au sacrifice du désir. Au nom de l’amour, le sujet en vient à céder sur son désir4. Au regard de ce que Lacan a nommé la folie amoureuse comme modalité de l’hybris féminine, cet aphorisme ne tient plus. Car là, seul le désir – au sens d’un désir de persévérer dans l’être – peut faire limite à la folie amoureuse pouvant conduire une femme à tout concéder pour un homme et finalement à oublier son propre désir. Les récits contemporains, intimes et littéraires, viennent aussi interroger cette folie amoureuse, dont Denis de Rougemont a pu montrer dans L’Amour et l’Occident5, la dimension obscure.
Y-a-t-il vraiment quelque chose de nouveau concernant l’amour et le désir au temps du déclin du patriarcat ?
Ah oui ! Je dirai que si l’amour pour le père, ou plutôt pour un père, est intact – cela se vérifie dans la clinique – c’est la critique des abus du père qui en revanche est nouvelle. C’est cela qu’il m’intéresse de souligner. Car le déclin du patriarcat s’accompagne aujourd’hui d’une critique des abus de ceux qui imposent une jouissance depuis une place de père qu’ils occupent, et dont ils abusent. Le livre de Neige Sinno, Triste tigre6, qui vient de recevoir, et le prix Fémina et le prix Goncourt des lycéens, est à cet égard paradigmatique. N. Sinno interroge la façon dont on a lu à la fin du XXe siècle Lolita de Vladimir Nabokov en ne s’intéressant jamais à la question de l’abus, mais seulement à celle de la puissance érotique de la nymphette bouleversant son beau-père. En notre moment, il n’est pas tant question de considérer qu’il est interdit d’interdire, comme on le disait en 1968, mais de savoir comment limiter la jouissance – de rendre compte de ces expériences où la jouissance d’un autre placé en position d’autorité est venue trahir le désir et l’amour. N’est-ce pas une façon de dire aussi que l’amour, c’est autre chose ? N’est-ce pas une façon de dire que l’amour n’est pas l’instrumentalisation du corps de l’autre au service de la jouissance ? Le signe de l’amour est, comme le cite Lacan, « un caillou riant dans le soleil7 ». Il est ce signe qui change le monde, notre monde, et nous donne envie d’y aller sans pour autant savoir ce qui nous arrivera. Et c’est aussi ce qui fait la beauté du consentement.
Questions posées par Marga Auré
[1] Springora V., Le Consentement, Paris, Grasset, 2020.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’Angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2004, p. 209.
[3] Cf. Lacan J., « Kant avec Sade », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 768-769. “J’ai le droit de jouir de ton corps, peut me dire quiconque, et ce droit, je l’exercerai, sans qu’aucune limite m’arrête dans le caprice des exactions que j’aie le goût d’y assouvir”.
[4] Cf., Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’Éthique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1986.
[5] Rougemont (de) D., L’Amour et l’Occident, Paris, 10/18, 2001.
[6] Sinno N., Triste Tigre, Paris, P.O.L., 2023.
[7] Lacan J., « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 508.