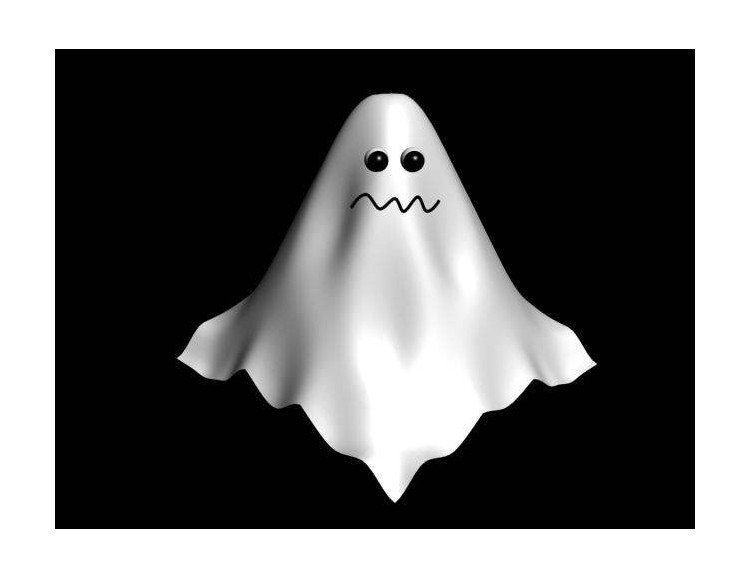Juste avant les J. 45 ! Avec le comité de pilotage, Damien Guyonnet, Virginie Leblanc, Camilo Ramirez
L’Hebdo-Blog – Bonjour Camilo Ramirez, répondriez- vous tout de suite ici à nos questions ? C’est la seconde fois que vous co-pilotez avec deux autres collègues les Journées organisées par Christiane Alberti. Y-a-t-il pour cette deuxième une spécificité, un renouveau dû au thème ou à autre chose encore ?
Camilo Ramirez – Oui, depuis le début nous nous sommes dits, au comité du pilotage, que nous allions favoriser la discontinuité entre les 44es et les 45es Journées, de telle sorte qu’elles ne puissent pas entre elles… faire couple ! Les Journées Être Mère ont beau avoir été un événement historique pour la psychanalyse d’orientation lacanienne, nous n’avons jamais songé à les reproduire sous une autre casquette, car pour que les Journées aient une chance de faire événement, elles doivent prendre acte du fait qu’entre elles il n’y aura pas rapport, elles se doivent d’être uniques.
D’où un blog ayant fait peau neuve, un drôle d’hybride : plus aérien, mais axé sur un tronc fort et moins touffu, doté de branches précises et fleuries à la fois. C’est sous ce signe novateur que Lacan TV a vu le jour, prenant acte de l’importance toute contemporaine de nouer image et discours, de façon aussi bien percutante que poétique. Même esprit de renouvellement du côté du comité scientifique, veillant à ce que l’ouverture des Simultanées reste aussi inoubliable que l’année dernière. D’où l’invention des Tac-o-tac, soit quelques dizaines d’analystes ayant dû forger à quatre mains des objets absolument singuliers, à partir d’une seule phrase soufflée à leur oreille, et pour le moins énigmatique ! Les Simultanées restent ce cœur des Journées où palpite l’expérience analytique transmise à travers 132 récits de cas sur l’actualité de « faire couple ».
Et bien évidement ce même vent soufflera sur les voiles de la plénière du dimanche, moment si fort des Journées pour lequel le moindre détail est soupesé, délicatement, afin de donner toutes ces chances à ce qu’entre la scène et la salle, par un dimanche pas comme les autres, il y ait une rencontre saisissante. De là à dire que ça sera Un long dimanche de fiançailles…
L’Hebdo-Blog – Bonjour Damien Guyonnet, pourriez-vous nous livrer la pointe de ce que vous avez appris au cours de ces mois d’intense préparation sur le thème « Faire couple, liaisons inconscientes » ?
Damien Guyonnet – J’aborderai trois points (pointes).
Concernant le thème tout d’abord, quelle n’a pas été ma surprise de constater, à travers les nombreux textes que nous avons pu lire sur notre blog, que « Faire couple » constitue une question psychanalytique actuelle et cruciale, dont les abords sont multiples, comme ses déclinaisons d’ailleurs… Et si la forme que prennent ces liens à deux puisent dans notre époque, où tout est possible, ou presque, et où tout est montré, ou dévoilé, les liaisons inconscientes, quant à elles, demeurent toujours aussi complexes et obscures, gravitant autour d’un impossible qui ne cesse pas d’insister, et ce, toujours davantage. Et alors de nous étonner, pour ne pas dire nous réjouir, de toutes ces nouvelles solutions qu’inventent les parlêtres pour suppléer à ce non rapport, solutions qui doivent sans cesse se réinventer. Du nouveau, encore et encore…
Cette dimension de la nouveauté était omniprésente au sein même de la préparation des Journées (blog, messages, événements, etc.). Le challenge était le suivant : poursuivre activement le mouvement de renouveau impulsé par Christiane Alberti dès les J43, tout en innovant encore cette année. Et il a été réussi, me semble-t-il. La continuité n’empêche nullement le renouvellement – voyez l’enseignement de Lacan ! Voilà la deuxième grande surprise que cette intense préparation m’a apporté.
Enfin, j’ai beaucoup appris de nos collègues chargés de la diffusion dans toute la France. Je me suis aperçu combien notre sujet, notre façon de l’aborder, notre manière de le présenter, était en « phase » avec les attentes de l’ensemble des professionnels du champ médico-social. Concernant leurs questionnements cliniques bien sûr, parfois même personnels, mais aussi eu égard à la conception qu’ils ont du fait psychique et, pour les plus avertis, l’idée qu’ils se font de la psychanalyse en ce début du XXIe siècle. Sans aucun doute, nous sommes de notre époque !
Pour conclure, je dirais que cette préparation, si intense, si prenante et si sérieuse a été avant tout une aventure très joyeuse. Gageons que ces Journées en seront l’apothéose !
L’Hebdo-Blog – Bonsoir Virginie Leblanc, nous diriez-vous comment vous avez vécu de « l’intérieur » cette longue préparation aux prochaines Journées de l’École ?
Virginie Leblanc – Longue et courte à la fois, car depuis que Christiane Alberti a donné l’impulsion et le signal de départ l’année dernière, de l’intérieur, c’est plus un marathon qu’une course de fond que j’ai eu l’impression de courir, entourée de mes chers co-pilotes, Damien et Camilo, mais également de toute l’équipe du blog, Christiane en premier lieu bien sûr, avec Alice Delarue et Pénélope Fay, Christine Maugin et Xavier Gommichon. L’afflux de textes, de propositions et d’idées de sommaires, personnes à interviewer ou lieux inédits où recueillir les échos de la cité sur notre thème m’a en effet donné l’impression d’une urgence, mais non d’une précipitation, plutôt d’une hâte joyeuse et éclairée par le savoir analytique en construction sur ces liaisons inconscientes du « faire couple », toujours appuyée par mes collègues, toujours en dialogue dans des formes de couples multiples finalement : car de l’édition des textes aux conversations avec les responsables de rubriques, de l’orientation à donner à chaque numéro du journal à l’élaboration de la plénière, que de duos multiples et productifs avons-nous formés, le temps de cette préparation, sous-tendue par un duo plus abstrait et singulier celui-ci, celui du transfert avec l’École qui a soulevé notre désir tout au long de ces préparations et j’ai hâte de participer à un temps fort de sa réalisation en acte, dans quelques jours au palais des Congrès.
Lire la suite

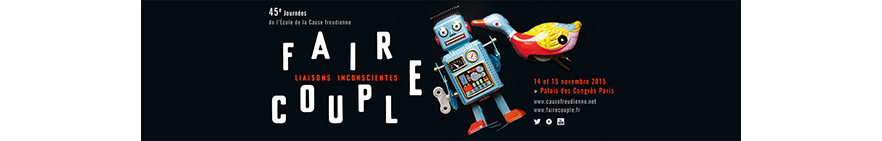

![La psychanalyse dans la cité, « à l’épreuve de la guerre »[1], au cinéma …](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/11/Papillon21.jpg)