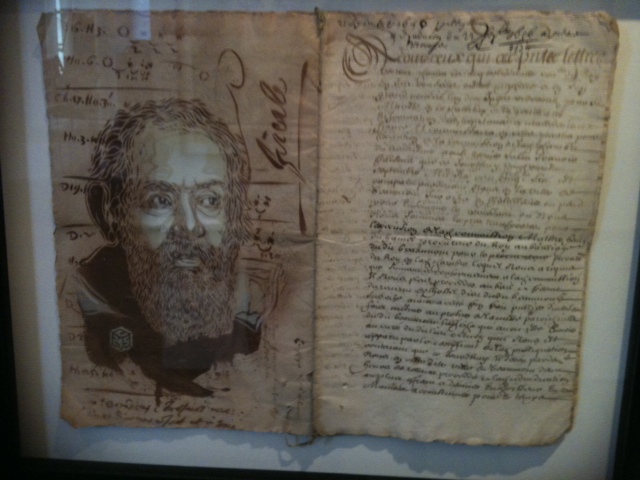Une femme fut confrontée à l’horreur de la mort de son enfant. La naissance d’un second enfant la renvoie alors à ce deuil. Elle veut que cet enfant vive mais le vit comme mort. Dans sa cure au CPCT, elle parvient à retrouver la dimension de la vie, dans un au-delà de l’expérience traumatique. Ce cas nous enseigne sur le parcours d’un sujet confronté à l’indicible. C’est en partant du postulat « le langage ne recouvre pas tout du réel et aucune parole ne peut couvrir le vide », comme le dit Alice Davoine, que la direction de cette cure s’oriente, et que le passage au CPCT trouve tout son sens.
Mme P. vient au CPCT pour la deuxième fois. Elle revient cependant avec la même difficulté : traiter, dit-elle, « sa position de mère » avec son fils, Max.
Le psychologue a dit que…
Mme P. ne sait pas ce qu’elle doit faire avec son fils cadet, Max, qui a treize ans. Elle voudrait tout faire à sa place. Or, le psychologue qui reçoit son fils a dit que Max n’avait pas fait les étapes psychologiques correctement, qu’il fallait le laisser faire tout seul afin qu’il apprenne par lui-même de ses erreurs. Cette intervention laisse Mme P. désarmée : « Max ne se pose pas de questions, il attend que ce soit moi qui décide pour lui. Du coup, c’est forcément moi qui n’ai pas dû faire comme il faut. » Elle estime que c’est à elle que revient la responsabilité de faire passer correctement à son fils les étapes psychologiques.
« Je n’ai rien vu »
Mme P. a eu quatre enfants : une fille aînée, un fils, Théo, puis une fille et enfin un fils, Max. Théo est décédé de la mort subite du nourrisson, alors qu’il avait cinq mois. Les circonstances de ce décès sont très particulières. Alors que Mme P. reprend le travail après son congé maternité, elle confie Théo pour la première fois à la nounou. « Quand je suis venue le chercher le soir, le SAMU était en train de le réanimer » me dit-elle. Elle me dit de ce moment : « Je n’ai rien vu arriver du tout. Je me disais que je n’étais pas capable d’être mère ». Mme P. vit alors un choc tel, qu’elle se trouve dans l’incapacité d’en parler, jette toutes les affaires du bébé : le trauma du décès brutal et inexplicable dévoile que le langage ne recouvre pas tout du réel, et aucune parole ne peut couvrir le vide dans lequel Mme P. se trouve.
Répondant au désir de son mari, deux ans plus tard, Mme P. est enceinte d’une deuxième fille. Et puisqu’ils avaient toujours voulu avoir quatre enfants, ils décident d’en avoir un quatrième. Ce sera Max, le fils pour lequel Mme P. vient consulter, qui est né treize ans après le décès de Théo.
Ma mère m’a dit que…
En apprenant qu’elle est enceinte d’un garçon pour la deuxième fois, Mme P. a été très déstabilisée : « J’ai honte de penser ça, mais quand j’ai su que c’était un garçon, j’ai pensé à Théo et j’aurais préféré une fille. »
Quand ils annoncent la grossesse à la mère de la patiente, celle-ci dira : « Avec ce qui vous est arrivé, pourquoi en vouloir un autre ! Tu vois bien que tu n’es pas capable d’être mère! » Cette parole maternelle trouve un écho direct avec sa propre culpabilité formulée lors du décès de Théo, l’assignant à une nomination de « mère incapable ».
Le « parallèle » des deux fils
Quand Mme P. parle de ce second fils, c’est pour dire à quel point il est inanimé : il ne veut rien de spécial, n’invite pas ses amis à la maison, redouble sa cinquième… « Il n’est pas très vivant, je voudrais le réanimer ! » me dit-elle. Je lui dis qu’elle le voudrait plus que vivant. Cette interprétation signe un moment crucial dans le traitement, puisqu’il aura pour effet de révéler à Mme P. le « parallèle » entre ses deux fils, mot qu’elle utilise pour exprimer ce collage du fils mort sur le second. Elle saisit alors l'enjeu et les conséquences que ça a eu sur sa façon d’être mère pour Max : la culpabilité de ne pas avoir vu les dangers pour son premier fils la pousse à surveiller les moindres faits et gestes du second. Actant ce moment où Mme P. aperçoit ce qui se joue dans sa relation avec Max, je lui dirai alors, d’une manière aussi délicate que possible : « Vous pensez que vous avez tué Théo ». Après mon intervention, un silence de mort se fera entendre. Elle me répondra, très difficilement : « Je crois que je l’ai fait », l’accent de son énonciation portant sur le « fait ». Je ponctuerai, fermement : « crois ». Cette deuxième interprétation soulagera immédiatement Mme P.
« C’est moi qui le dit »
Elle me parlera alors de sa vie d’enfant, de l’année de ses treize ans, très difficile pour elle, année du départ de son frère aîné, parti étudier en internat, et du décès de sa grand-mère qui vivait chez eux « une vraie mère pour nous ». Elle s’est alors retrouvée seule, entre ses parents.
Je soulève le fait qu’avoir treize ans, c’est difficile, et montre la redondance de ce chiffre : ses treize ans, les treize ans qui séparent ses deux fils et les treize ans de Max. Elle s’écriera : « Mais alors, c’est de moi dont il s’agit, pas de mes fils ! » Mme P. aperçoit que c’est dans sa vie que ce « treize » se répète. Elle ponctue dorénavant souvent ses séances par « ça, c’est moi qui le dit ! »
Lors de la dernière séance, Mme P. parle de son fils Max autrement : « Pour Max ? La rentrée se passe bien… Il se ‘laisse vivre !’ » Je fais résonner ces paroles.
Mme P. est venue au CPCT traiter sa culpabilité, dont elle ne pouvait rien dire, l’effraction du décès de son premier fils trouant le langage, la laissant seule avec ce sentiment de faute impardonnable. « Pas capable d’être une mère » est une lecture de ce trou effroyable, lecture toutefois mortifiante pour Mme P. qui ne peut s’en échapper dès lors qu’un deuxième fils naît. L’écho qu’elle rencontre dans les paroles de sa propre mère l’a vouée à une place de mère qui ne sait pas être mère. Son idéal de mère parfaite, sachant répondre à tout, achève de l’enfermer dans une nomination de mère incapable.
Alors qu’un « J’aurais dû le savoir » la cloue à une culpabilité féroce, le « Je ne sais pas tout » qui surgit en séance lui aménage une place plus vivante, et elle peut « laisser vivre » son fils Max.
Comment dire que…
Mme P. se trouve embrouillée dans de nouvelles questions : comment répondre aux questions de ses enfants ? Elle ne sait pas. « La mère idéale, c’est celle qui a réponse à tout », me dira-t-elle. À ma moue dubitative, elle rit : « C’est vrai que c’est la pire aussi ! » Elle entend que l’idéal de la mère parfaite qui a réponse à tout la conduit au pire.
Le travail de Mme P. au CPCT n’a pas été de trouver une réponse à son problème, mais de pouvoir se poser une infinité de questions, et de trouver un partenaire « qui ne juge pas ». « Vous, vous ne répondez pas ! »
Lire la suite