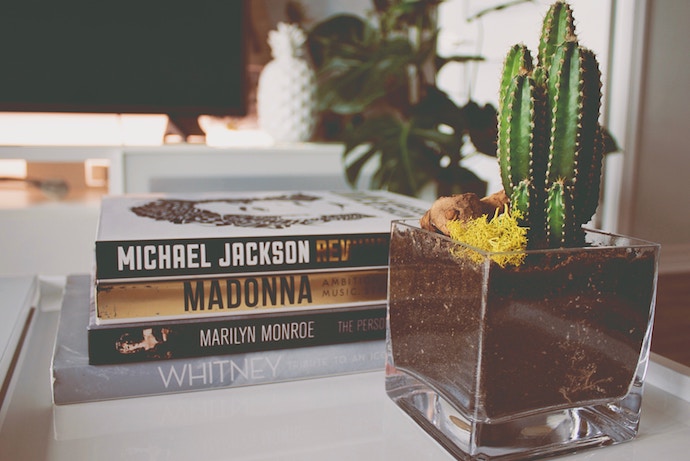Je travaille dans une structure dans laquelle nous sommes amenés à recevoir des adolescents demandeurs d’asile [1]. Dans le dispositif du droit d’asile, l’étranger doit fournir un récit de ce qui l’amène en France. Une enquête est menée par les services de l’Etat afin d’évaluer et d’analyser les documents fournis. La méfiance est de mise, des deux côtés. Ainsi, quand un migrant demande un rendez-vous auprès du personnel de santé, la question de l’authenticité de sa démarche est interrogée : Que veut-il ? Etoffer, étayer son dossier avec des attestations ou des certificats de complaisance ? Ses symptômes ne sont-ils pas le fruit d’une simulation ?
Pourquoi de telles interrogations de la part des soignants ? Quelle place fait-on à l’étranger ? Quels droits lui reconnaît-on ? « Et par là même, quels sont les droits que l’on s’attribue en tant que ceux qui seraient chez eux. Et donc quels sont les droits et les devoirs d’une communauté à l’endroit de ce qui n’en sont pas mais qui désirent y rentrer. » [2]
Dans un meeting du 24 février 2019, un responsable politique s’interrogeait sur le fait qu’un migrant fraîchement arrivé touche d’avantage qu’un retraité modeste. Une fake news qui permet de mettre en lumière cette phrase de Lacan dans L’éthique de la psychanalyse : « ce que je veux, c’est le bien des autres, pourvu qu’il reste à l’image du mien » [3] et Lacan d’ajouter : « sa jouissance nocive, sa jouissance maligne, c’est elle qui se propose comme véritable problème à mon amour. » [4] Autrement dit : l’autre est intrusif et me dépossède.
Le migrant est-il un citoyen ? La clinique du demandeur d’asile n’est pas pour moi une spécialité. Je n’accueille pas des citoyens, mais des sujets divisés, tiraillés entre des identifications multiples et contradictoires, car être un immigré « c’est aussi le statut même du sujet dans la psychanalyse. Le sujet comme tel, défini par sa place dans l’Autre, est un immigré … étant donné que l’Autre est seul chez-soi. » [5] Le statut ordinaire du sujet (citoyen, migrant…), du fait de son rapport à la jouissance, est de se sentir étranger à lui-même.
C’est dans ce contexte que je reçois Michael, un adolescent de 17 ans. Il vient d’un pays où exprimer une opinion peut être dangereux. Il a dû quitter son pays avec son père et l’un de ses frères, laissant sa mère, une sœur et d’autres frères vivre dans la clandestinité dans une région voisine de son pays. Avant l’exil, Michael venait de terminer ses études et un avenir brillant de sportif s’offrait à lui.
Je le reçois un an après son arrivée en France. Il est adressé par l’école et c’est écrit comme ça dans la fiche de renseignement : « Michael a des difficultés de comportements et d’investissement en classe, il est refermé ; (exil, histoire du père…) »
Le travailleur social et l’école interprètent les comportements de ce jeune homme comme étant une conséquence d’un traumatisme lié à ce qui a poussé cette famille à partir de son pays.
Pour la psychanalyse, un événement douloureux n’est pas forcément traumatique. Ce qui fait trauma c’est la rencontre inopinée avec un réel générateur d’angoisse. Ce qui est important, c’est d’entendre ce que Michael a à dire de ces manifestations. Mais notre structure n’a pas de budget pour payer un interprète. Nous avons la possibilité de travailler avec le traducteur du lieu d’accueil. Caroline Leduc, dans son article « Mission en Syrie » propose de s’appuyer « sur le désir de savoir de l’interprète plutôt que de tâcher à annuler sa subjectivité » [6] car « on ne peut pas lutter vainement contre le réel du dispositif, cela suppose une pratique originale de supervision, où chaque entretien est discuté après coup dans une visée de formation ». [7] Pour certains sujets, le fait que l’interprète soit à l’interface entre la constitution administrative du récit de demande d’asile et ce qui se dit en séance peut poser problème. En effet, il est important d’offrir un cadre où la confidentialité et la vérité de chacun soient respectées, sans enjeu d’exactitude, sans que la parole soit mise en doute.
Lors du premier rendez-vous, Michael et son père font le choix de venir sans interprète. Le père ne parle pas bien français mais il se fait comprendre. Il veut un traitement pour son fils, pour stopper ses maux de tête et régler ses problèmes de sommeil. Il souhaite voir un médecin. Dans le deuxième temps de l’entretien, je suis seul avec Michael. Son français est correct et on arrive à échanger. Il ne comprend pas pourquoi il doit aller à l’école faire des trucs de « bébé ». Il a un projet d’entrer dans la sécurité et faire du sport dans un club de haut niveau, comme dans son pays.
Avec lui, je n’ai pas l’impression que l’on parle français, mais qu’on invente une langue à mi-chemin entre la sienne et la mienne. Les repères habituels que l’on découvre spontanément dans la langue comme les allusions, les affects, les contradictions, les empêchements, les lapsus, ne sont pas aussi visibles. Il faut tenir compte de cet impossible. Il est, par conséquent, difficile de saisir l’émergence de l’inconscient lorsqu’il est situé dans le décalage entre ce que le sujet veut dire et ce qu’il dit, entre l’intention de signification et la trajectoire propre du signifiant. Ceci génère une perte importante d’information clinique. Pour autant, Michael est très assidu à nos rendez-vous. Il trouve que son père ne fait pas ce qu’il faut pour regrouper la famille en France. Il s’inquiète beaucoup pour sa mère et par conséquent, arrivé à l’âge de 18 ans, il décide de prendre les choses en main : il veut présenter son dossier de demandeur d’asile, changer de ville afin de trouver une formation et un lieu pour s’entraîner. Plusieurs fois, il me demande de convoquer le travailleur social afin que je me fasse l’interprète de ce qu’il désire. Quelque chose s’anime.
Finalement, Michael m’a très peu parlé de son histoire passée, il se focalise sur le présent, car il dit que le futur est incertain. Nous nous sommes accordés pour poursuivre les entretiens, bien qu’il ait atteint sa majorité, car il y a peu de personnes à qui il peut parler de cette manière : se raconter sans se dévoiler. En effet « Quand le sujet a affaire à l’opacité du désir du grand Autre et que cette opacité, son illisibilité, a pour effet l’Hilflosigkeit Freudienne, la détresse du sujet, c’est alors qu’il a recours au fantasme comme à une défense ».[8] C’est à dire que le sujet « puise dans les ressources du stade du miroir qui lui offre tout une gamme de postures, du triomphe à la soumission ».[9]
[1] Texte issu d’une table ronde « Étranger, dis-moi qui tu es », dans le cadre du « Week-end Lacan », organisé du 12 au 14 avril 2019 à Toulouse, par l’ACF-Midi-Pyrénées.
[2] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, cours du 5 mars 1997, inédit.
[3] Lacan J., Le séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Seuil, Paris, 1986, p219.
[4] Ibid.
[5] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Extimité », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII cours du 27 novembre 1985 inédit.
[6] Leduc C., « Mission en Syrie », La psychanalyse à l’épreuve de la guerre, Berg International, 2015, p. 49.
[7] Ibid.
[8] Miller J.-A., « Une introduction à la lecture du séminaire VI, Le désir et son interprétation », La Cause du Désir, Paris, Navarin, 2014, n°86, p.63.
[9] Ibid., p.64.