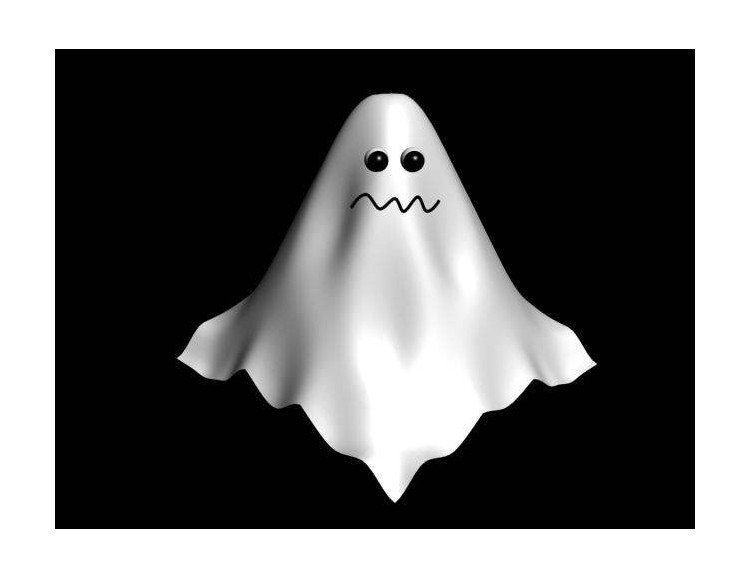La séparation impossible est un classique. Serge Cottet démontre avec finesse qu’en voulant protéger l’autre de la rupture, c’est nous-mêmes que nous protégeons. Les chemins alambiqués de l’inconscient, masculin, en occurrence…
Le roman ultra célèbre de Benjamin Constant, Adolphe, fait figure de paradigme de la rupture impossible. Bien au-delà des clichés de la littérature romantique, le mode d’impasse subjective relaté confirme les ruses de l’inconscient.
Il s’agit d’un jeune homme de 24 ans, indécis quant à sa carrière, qui quitte la maison paternelle pour courtiser une veuve de dix ans de plus que lui. Celle-ci, une fois séduite, le sujet s’en trouve embarrassé comme un poisson d’une pomme : la rupture est toujours différée, annulée, jamais définitive ; seule la mort d’Éléonore mettra fin aux tergiversations. Le roman a donné lieu à d’innombrables débats et exégèses relatives à la biographie de Constant et au déguisement plus ou moins voyant des relations amoureuses du narrateur, bien connues des historiens.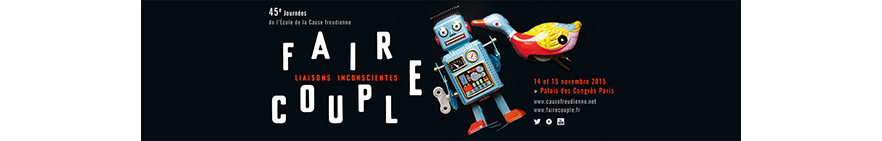
Stendhal qui n’appréciait qu’à moitié l’ouvrage, le résume ainsi : « Un marivaudage tragique où la difficulté n’est point, comme chez Marivaux, de faire une déclaration d’amour mais une déclaration de haine »[1]. Ce jugement abrupt escamote le dilemme auquel est confronté le jeune homme qui, certes, n’aime pas Éléonore d’une passion violente, mais se trouve prisonnier de scrupules : s’il pense l’abandonner, le mal serait aussi grand pour elle que pour lui : « La grande question dans la vie, écrit l’auteur, c’est la douleur que l’on cause, et la métaphysique la plus ingénieuse ne justifie pas l’homme qui a déchiré le cœur qui l’aimait »[2]. Justification d’une mauvaise conscience ou indécision du désir se confondent. Si la douleur est certes du côté de l’objet abandonné, « c’est un affreux malheur d’être aimé quand on n’aime plus »[3]. Lacan traitera ce paradoxe qui fait qu’on est en deuil non pas seulement de ceux qu’on aimait mais peut-être plus encore de ceux qui nous ont aimés et dont nous étions le manque. « Bizarrerie de notre cœur […], écrit Constant, que nous quittons avec un déchirement horrible ceux près de qui nous demeurions sans plaisir »[4].
Adolphe se répand en auto-justifications alambiquées pour s’exonérer d’une faute qui n’est pas loin de faire de lui un monstre dans le cercle étroit que fréquente Éléonore. Il touche pourtant un point qui n’est pas toujours relevé par les critiques littéraires concernant l’interprétation qu’Éléonore elle-même donne des atermoiements de son jeune amant : « Vous croyez avoir de l’amour pour moi mais ce n’est que de la pitié »[5]. Ces paroles ont un tel effet de vérité sur le jeune homme que son sacrifice perd son sens. Celui d’Éléonore tout aussi bien, elle qui sacrifie et ses enfants et sa fortune à cette duperie (elle renonce pour lui à un mariage avantageux). Adolphe est justiciable de l’analyse que fait Lacan de l’altruisme moralisateur : « en voulant le bonheur de ma conjointe, sans doute je fais le sacrifice du mien, mais qui me dit que le sien ne s’y évapore pas aussi totalement ? »[6]
Benjamin Constant, lecteur de Jean-Jacques Rousseau, a bien compris ce qu’il fallait entendre par pitié, rien d’autre qu’une projection imaginaire de l’amour de soi-même. Les sentiments qui en procèdent sont tournés vers soi-même plus qu’ils ne témoignent d’un amour pour le prochain. Il apparaît alors que la relation à Éléonore est marquée d’un trait narcissique quasiment transitiviste. Il se tue lui-même, dit-il, s’il la quitte. Perdre l’amour lui semble aussi impensable qu’est pour Éléonore l’idée d’être abandonnée. Mais s’il reste ce n’est pas mieux ; on l’a dit : le bonheur de l’un se consume des renoncements de l’autre.
Il est facile de faire de la psychanalyse appliquée dans ce cas et de mettre en évidence la structure œdipienne des impasses du désir. Nombre de biographes ont rappelé que Constant n’avait pas connu sa mère décédée après sa naissance. Il lui est arrivé d’avoir des maîtresses beaucoup plus âgées que lui. Son ambivalence à l’égard de Mme de Staël (qu’on identifie généralement à Éléonore) dont il ne supporte pas les récriminations, donne à certains l’idée d’une vengeance à l’endroit d’une mère qui l’a laissé tomber.
L’aveu de la rupture pour Adolphe est difficile, car c’est son propre malheur qu’il déclenche. Croyant ménager l’autre, il se ménage. D’ailleurs, après qu’il ait eu le courage de lui avouer « je ne vous aime plus »[7], il se ravise comme chaque fois qu’Éléonore s’effondre. Il y a dans cet aveu qui, croit-il, le délivre de ses chaînes, une jouissance impossible à supporter ; celle-la même que Lacan dénonce comme le trait de cruauté dans l’amour du prochain[8]. D’un mot, Adolphe bat sa coulpe : il est culpabilisé. La belle affaire !
On raconte que lors d’une présentation de malade à Sainte-Anne une jeune femme avait fait une tentative de suicide par désespoir amoureux ; Lacan la faisait parler de son amant ; un médecin qui avait pris contact avec ce dernier est intervenu à sa décharge pour dire : « Oh ! Mais il est très culpabilisé ! » « Alors, avait conclu Lacan, c’est qu’il est bien décidé à ne rien faire. »
[1] New Monthly Magazine, 1er décembre 1824 ; d’après Stendhal, Courrier Anglais, tome 2, p. 224.
[2] Constant B., Adolphe, Réponse à la lettre de l’éditeur, Garnier Flammarion, Paris, 1989, p. 196.
[3] Ibid., p. 100.
[4] Ibid., p. 101.
[5] Ibid., p. 108.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986, p. 220.
[7] Constant B., Adolphe, Réponse à la lettre de l’éditeur, Garnier Flammarion, Paris, 1989, p. 113.
[8] Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986, p. 229.




![La psychanalyse dans la cité, « à l’épreuve de la guerre »[1], au cinéma …](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/11/Papillon21.jpg)