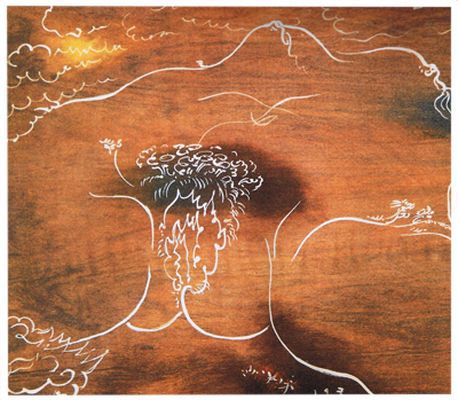L’œuvre qui fait connaître Ron Mueck en 1997 est Dead Dad, sculpture figurant le cadavre nu d’un vieil homme allongé sur le dos, « sculpture étrangement vivante, ou plutôt étrangement morte »[1], qui bouleversa le public. Absent et à l’autre de bout de la planète lorsque son père meurt, Ron Mueck a matérialisé cet événement en cette sculpture le représentant en « cadavre nu et privé de dignité et d’émotion », commente l’historien d’art Robert Rosenblum[2].
Tellement familier…
Ce qui frappe, dans l’œuvre de Ron Mueck, c’est l’hyperréalisme sidérant avec lequel il parvient à bâtir des corps à la morphologie parfaitement convaincante, tant du point de vue de leur posture que de leur carnation, et ce, pari réussi, quelque soit l’angle de vue du spectateur. En effet, ces corps tantôt nus, tantôt vêtus, sont parés de détails anatomiques incroyablement précis : les cheveux, les poils, les taches de rousseur, les stries des ongles, les imperfections et les disgrâces, les boursouflures, les callosités, les bourrelets, les plis et les pores de la peau, et occasionnellement jusqu’à la sueur et au poisseux. Ron Mueck parvient de manière ahurissante à produire de véritables enveloppes de peau qui laisseraient assurément croire qu’elles reposent sur la même fondation squelettique que notre propre corps et qu’elles recouvrent ce que l’on peut manifestement s’imaginer être, sous cette peau, des veines, des muscles, de la graisse et pourquoi pas des organes. L’historien d’art Robert Rosenblum le relève avec amusement : « Un médecin, se dit-on, pourrait donner une leçon d’anatomie en les ouvrant au scalpel. »[3]

Ce qui touche dans cette œuvre, me semble-t-il, ce sont les traces de vie qui paraissent laissées sur ces corps (c’est assez marquant avec la représentation des visages ridés, des corps au dos lourd du poids des années de certaines figures de personnes âgées : on s’attendrait presque d’ailleurs, tellement on y croit à sentir leur parfum suranné si on s’en approchait suffisamment près !). Plus précisément, ce qui touche et à quoi l’on peut éventuellement s’identifier dans cette œuvre, c’est le thème qu’elle aborde de toute évidence, et qui est celui du cycle de la vie humaine, de la naissance à la mort, dont l’artiste interprète des sortes d’instantanés, des scènes de vie intime figée dans le silicone et la fibre de verre de ses personnages sculptés. Il traite notamment de la naissance et de l’enfance avec une série de représentations de bébés (Baby, Head of a Baby, Baby on a Chair), de la question que l’on pressent être celle de l’embarras ou de la curiosité face au remaniement corporel de la puberté avec Ghost et Crouching Boy in Mirror, du couple représenté dans un lit partagé avec Spooning Couple, de la grossesse avec Pregnant Woman, de l’accouchement avec Mother and Child, de l’âge avançant avec le corps voûté de la femme assise (Seated Woman) et de ceux des deux petites vieilles aux visages burinés de traces de vie (Two Women), et enfin des corps alités paraissant en fin de vie (Old Woman in Bed), sans oublier Dead Dad…

Tellement étranger…
À propos de cette dernière sculpture, Dead Man, Robert Rosenblum précise : « De la confrontation brutale avec cette réalité – le spectacle de la dépouille mortelle d’un parent –, qui dans la vie est une catharsis nécessaire au deuil, on passait soudain au domaine de la fantasmagorie puisque cet homme nu, aussi étonnant que cela pût paraître, ne mesurait qu’un mètre, fruit d’une effrayante mutation de l’espèce humaine qui le renvoyait au royaume des rêves et des cauchemars originels. »[4]
C’est précisément là que la singularité de l’artiste trouve son assise : à la fois il y a son travail de reproduction des détails corporels, époustouflant d’exactitude et de réalisme, mais à la fois, a contrario, et paradoxalement, serait-on tenté de dire, ces sculptures ne sont jamais réalisées grandeur nature. Au contraire, en la matière, elle semble plutôt faire un pied à la nature. Effectivement, Ron Mueck fait subir aux corps qu’il façonne une distorsion au regard des gabarits humains ordinaires – distorsion qui va de l’atrophie à l’hypertrophie, non sans susciter un certain trouble, face à cette bousculade de « notre sens de l’échelle humaine »[5] par les dimensions hors-norme du corps de l’œuvre.
En effet, ces réductions et ces amplifications produisent un certain effet de surprise un peu inquiétant parfois, et semble-t-il précisément parce que par ailleurs toutes les qualités hyperréalistes des sculptures nous offrent la possibilité d’entrevoir un corps que l’on pourrait tout à fait confondre avec un corps humain. Robert Rosenblum le dit autrement : « On retrouve cette même vision dans chacune des sculptures de Mueck. L’artiste devient une sorte de Frankenstein moderne, créateur d’un univers personnel peuplé d’humanoïdes qui tout à la fois reflètent notre image et nous transforment en créatures étranges. »[6] Et plus loin : « La sculpture figurative […] a toujours joué sur les rapports d’échelle. Mais lorsque les personnages deviennent des répliques aussi terriblement ressemblantes de nous-mêmes et de nos contemporains, ce jeu sur les dimensions nous transporte aussitôt dans un autre territoire, plus proche d’un monde de l’irrationnel, où des créatures effrayantes peuvent rétrécir jusqu’au néant ou se dresser très haut pour boucher l’horizon. »[7]
L’Unheimliche / L’inquiétante étrangeté
C’est ainsi à un certain sentiment d’Unhheimliche, d’inquiétante étrangeté, telle que Freud l’a conceptualisée, que Ron Mueck nous convie par son art de la conjugaison entre : d’une part l’hyperréalisme de corps à l’exactitude anatomique parfaite, et ceci qu’ils semblent traverser la vie dont ils portent des marques ; et d’autre part : leur démesure, le côté aberrant de leur dimension.
L’inquiétante étrangeté c’est, selon Freud, ce malaise produit par une rupture dans la rationalité rassurante de la vie quotidienne, mais pas, contrairement à ce que l’on pourrait croire, par quelque chose d’inédit : « cet ‘‘Unheimliche’’, écrit-il, n’est en réalité rien de nouveau, d’étranger, mais bien plutôt quelque chose de familier, depuis toujours, à la vie psychique, et que le processus de refoulement a rendu autre »[8]. Il « provient […] de l’intime refoulé »[9]. Bref, ce qui provoque ce sentiment d’inquiétante étrangeté, c’est précisément là où ce qui se donne à voir, à la fois, on ne s’y attendait pas, ça nous surprend, mais aussi, quelque part, ça nous fait écho, dans les « recoins les plus reculés »[10] de notre vie psychique.
Et c’est bien cela que Ron Mueck nous donne à voir – du moins est-ce l’expérience que j’en fait. C’est-à-dire qu’en premier lieu, ce sculpteur nous offre le spectacle de corps de silicone à la perfection si troublante qu’on s’attendrait presque à les voir respirer et se mouvoir. Freud notait que « c’est une circonstance particulièrement favorable à la création de sentiments d’inquiétante étrangeté qu’une incertitude intellectuelle relative au fait qu’une chose soit animée ou non, ou bien lorsqu’un objet privé de vie prend l’apparence trop marquée de la vie »[11].
Et, en second lieu, nous donnant à voir ce en quoi on peut se reconnaître dans ces sculptures à la plastique absolument convaincante, dont la précision de la reconstitution des détails confère une certaine rationalité rassurante, d’autre part, donc, dans un mouvement simultané de disproportion, il fait vaciller notre sens de l’échelle corporelle, anatomique. Si c’est Unheimlich, c’est bien parce que cela comporte quelque chose qui nous parle parce que cela nous est familier. Alors, quelle est l’inquiétante étrangeté dont Ron Mueck parvient à nous faire la démonstration, en procédant à l’hypertrophie ou à l’atrophie de tous ces corps, en les faisant toujours trop petits ou toujours trop grands ? Je fais la proposition que ce qu’il nous donne à voir, c’est comme un vacillement (pas une levée totale) du filtre du stade du miroir – celui-là même qui nous donne l’assurance d’avoir un corps bien unifié et donc une image consistante. Comme si, peut-être, l’artiste pressentait l’artifice de ce filtre, et que les limites et les représentations du corps, ça ne va pas de soi, en tout cas pas sans une construction. Et par cette vacillation esthétiquement organisée, nos représentations a priori rationnelles du corps se trouvent contrariées, troublées, nous faisant passer de la contemplation de corps gigantesques à celle de corps étrangement réduits, et nous étonner sur ceci que dans ces corps enflés ou rapetissés, quelque chose d’une absence se retrouve avec récurrence..
Une certaine absence
S’il est difficile de cerner la fonction que sa pratique de sculpture peut avoir pour cet artiste, puisqu’il se tient silencieux à son propos, ne donnant aucune interview et ne livrant aucun commentaire, on sait au moins que dans son petit atelier londonien, il ne se lasse pas de répéter des dizaines et de dizaines de fois par jour le même geste pour que son œuvre atteignent à la perfection vers laquelle il tend.
On constate enfin, comme je l’évoquais à l’instant, que ces corps qu’il produit, à la vraisemblance troublante et aux mensurations atypiques, il les représente le plus souvent en solitaires – et ils n’en apparaissent pas moins dans une certaine solitude, même quand ils sont figurés en couple ou en duo –, tout plongés qu’ils paraissent dans leurs pensées, les yeux dans le lointain. À la fois ils nous saisissent par leur aspect vivant, et à la fois, en contraste, quelque chose semble chez eux délibérément éteint, absent, et aussi silencieux que leur auteur…
[1] Robert ROSENBLUM, Ibid., p. 46.
[2] Robert ROSENBLUM, Ibid., pp. 46 et 50.
[3] Robert ROSENBLUM, « Ron Mueck : corps et âmes », Ron Mueck, Fondation Cartier pour l’art contemporain, Actes Sud, Paris, 2005, p. 54.
[4] Robert ROSENBLUM, Ibid., p. 50.
[5] Robert ROSENBLUM, Ibid., p. 72.
[6] Robert ROSENBLUM, Ibid., p. 50.
[7] Robert ROSENBLUM, Ibid., p. 68.
[8] Sigmund FREUD, L’inquiétante étrangeté, 1919, p. 24.
[9] Sigmund FREUD, Ibid., p. 29.
[10] Sigmund FREUD, Ibid., 1919, p. 26.
[11] Sigmund FREUD, Ibid., 1919, p. 18.