Rencontrer les jeunes nigérianes adressées au CPCT de Lyon a été un challenge intenable tant leur demande fruste voire informulable avait de difficultés à trouver place dans l’offre que nous faisons. Ces jeunes vivent de la prostitution et m’ont beaucoup enseignée sur la fonction de la croyance dans la clinique. Elles ont abordé l’immigration dans des circonstances difficiles. Les narrations sont parcellaires ou sont des récits conventionnels élaborés pour les besoins de l’obtention de papiers, au titre de victimes de « la traite des êtres humains ». Sans domicile fixe ou exploitées par des logeuses du réseau prostitutionnel, elles sont en attente d’un toit plus sûr procuré par une association comme l’ADN[1]. Leur plainte est d’abord focalisée sur des maux physiques : blessures ayant laissé des traces indélébiles, insomnies, cauchemars, migraines violentes. La maladie mentale affleure, tamponnée par l’allégation d’être victimes de malédictions, ce qui reste de leur inscription dans un discours premier. Leur récit, aussi stéréotypé qu’il paraisse, est à prendre au sérieux, car il voile quelque chose qui reste le plus souvent insubjectivé au cours de nos rencontres, sauf par des bribes qui désignent fugitivement un point du bord cernant un trauma incurable. La prostitution, qui définit leurs conditions de survie en France, n’en est que la conséquence. Elles n’en soufflent mot par honte et par crainte des passeurs et souteneurs, momies et tantes, « maîtres », « maîtresses » et jujus[2], tout l’appareil criminel qui les a prises en charge.
Une jeune femme nigériane débute ce qu’on appelle un « traitement ponctuel ». Elle est venue au CPCT la première fois accompagnée de deux enfants : un fils de six ans et une fille de trois ans qui vont à l’école et parlent bien le français.
Joy a trente ans, elle est mère de trois enfants ; le sort de l’aînée, une fille restée au Nigéria, est une source d’inquiétude et de culpabilité. Cette enfant est à l’origine de ce qui l’a précipitée dans l’exil car, cette dernière, à sa naissance, aurait dû être excisée (elle dit circumcised). Terrifiée par la barbarie de cette pratique qui avait coûté la vie d’une sœur aînée, elle s’est opposée à ses parents, au père de l’enfant, aux exécuteurs du rituel. Elle a été battue, marquée sur le corps et sur le visage comme fugitive. Avec la complicité d’une « tante », elle a accouché dans le bush d’un enfant dont elle ne connaît que le sexe. La tante en question s’est chargée du bébé et a organisé le passage de la mère en Libye où elle a été prostituée pour payer ce passage. Elle rencontre le père de ses deux autres enfants à Tripoli. Lorsque celui-ci meurt au cours de la guerre libyenne, elle s’enfuit. Elle a accouché de sa deuxième fille au Maroc, dans un camp humanitaire, puis a embarqué pour la France. Le récit de Joy se précise au fur et à mesure qu’elle le reprend et le corrige en de véritables repentirs qui soulignent la précarité de la vérité dont elle peut témoigner. Ses enfants sont au cœur de ses préoccupations car ils incarnent à la fois son envie de survivre et l’objet de son angoisse : et si l’une de ses deux filles, celle qui vit avec elle ou celle qu’elle a laissée derrière elle, devait un jour subir l’excision !
En Libye, à la naissance de son fils, elle en a été séparée car elle était prise d’accès de violence qui le mettaient en danger, dit-elle. Aujourd’hui encore elle est partagée entre l’amour maternel et des « impatiences » incontrôlables. C’est, je crois, plus encore que les cauchemars et les insomnies qu’elle évoque, une des raisons de sa demande au CPCT. Pour éviter le délai inhérent à la formule du « traitement ponctuel », je lui ai proposé de venir le vendredi matin sans rendez-vous, tous les vendredis si elle le souhaite. Elle se sert de cette offre, mais vient parfois en dehors de mes heures de présence. Une question sur son rapport au temps a émergé ainsi ; ses « oublis » et les rendez-vous manqués ici, ou avec son avocat et les enseignants de son fils commencent à faire symptôme pour elle, subjectivés à partir de la question « why me ? » qui la décolle sensiblement du statut de victime.
Ainsi au plus intime de la singularité de ces sujets, la prostitution est l’écran de la douleur incurable qui les a mis en route vers l’immigration. Un dire est à entendre au cœur de leur plainte formulée dans un discours parcellaire, sans que la cause de la douleur soit vraiment subjectivée ou alors à côté, par des détails infimes. Il y a un enjeu éthique à croire leurs dires : « y croire sans trop les croire »[3], en sachant que ce qu’elles disent relève de cet insondable. La prostitution avec tous les avatars qui constituent ses formes particulières à un instant donné de l’histoire : aujourd’hui la prostitution des nigérianes et autres africaines n’est qu’un aspect des migrations de masse déchirant notre monde globalisé.
Rappelons la définition que Lacan donne du symptôme du sujet dans son rapport à la croyance. « Ce qui constitue le symptôme, dit Lacan dans le Séminaire “ R.S.I. ”, c’est qu’on y croit. »[4] Et qu’est-ce que croire, pour le praticien du champ social ou du champ psy orienté par la psychanalyse, « sinon croire à des êtres en tant qu’ils peuvent dire quelque chose » (ibid.). Il me semble que cet « autre » réseau dont elles usent, celui que constituent nos institutions et les actions non concertées que nous y menons, instaurent un souffle d’air qui circule dans l’existence de ces femmes asphyxiés par les impératifs tant des discours mafieux que par ceux conformes à la législation du pays d’accueil. Lacan déclarait dans une interview à France Culture en 1973, que la psychanalyse « est le poumon artificiel grâce à quoi on essaie d’assurer ce qu’il faut de jouissance dans le parler pour que l’histoire continue »[5].
[1] L’Amicale du Nid est une association qui a pour vocation « d’accompagner les victimes de la prostitution, de la traite des êtres humains et du proxénétisme vers une insertion socio-professionnelle ».
[2] Le terme « juju » réfère historiquement aux religions traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, désignant aussi bien des objets que des rituels magiques liés à ces cultes et les sorts qui en participent. Ici, il s’agit des magiciennes elles-mêmes, les marabouteuses .
[3]« Y croire sans trop les croire », c’est en substance la phrase mémorable qui sert de boussole aux éducatrices que j’ai rencontrées au local du service « Milieu ouvert » de l’ADN avant d’écrire ce texte.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XXII, « R.S.I. », leçon du 11 mars 1975, inédit.
[5] Transcription parue dans Le Coq Héron n° 46-47, 1974, p. 3-8.


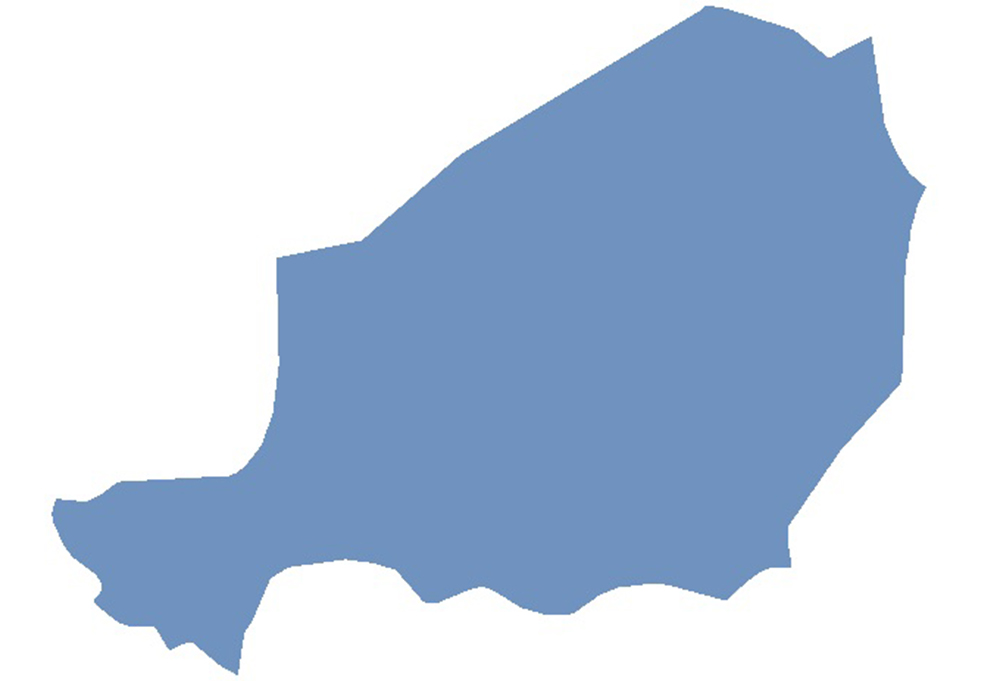



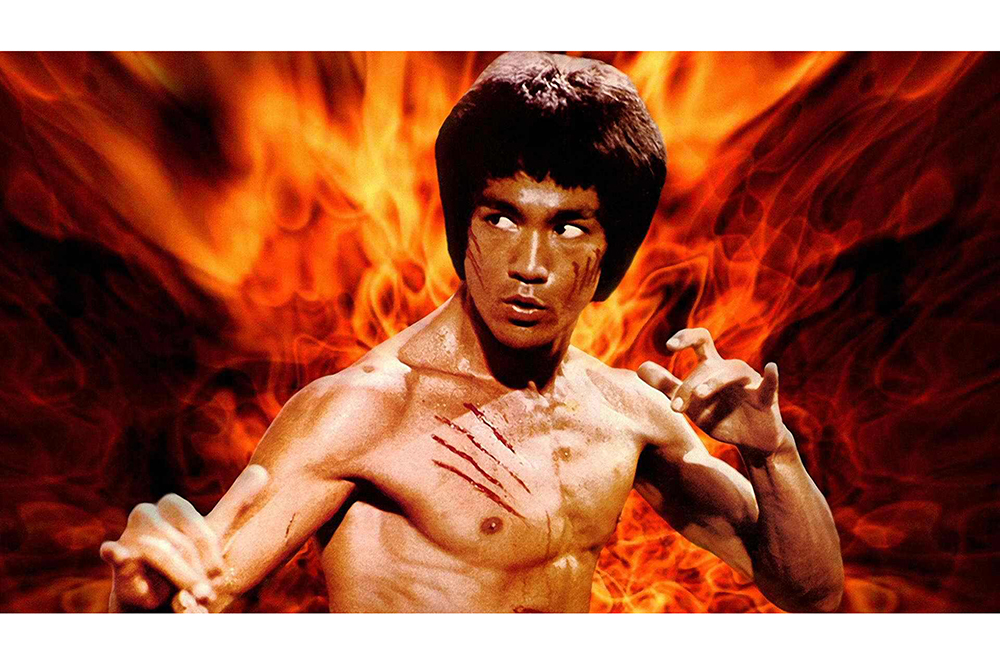

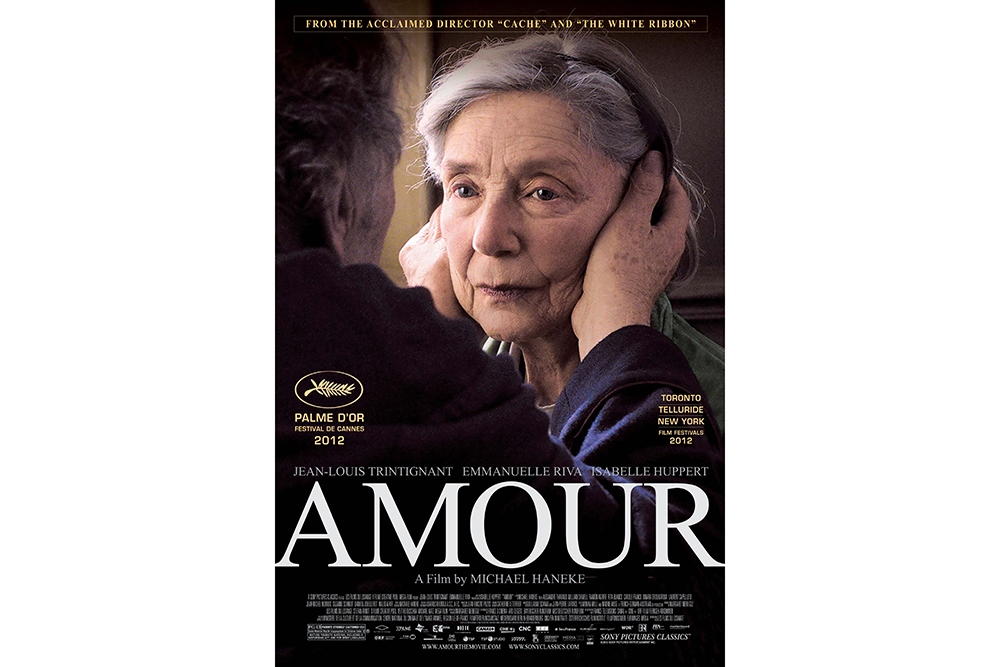
![Le corps pris au mot[1] Hélène Bonnaud répond aux questions de Marie-Christine Baillehache](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/09/BonnaudHD.jpg)