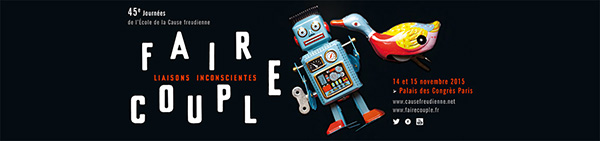
Corée du Nord, 1958, aux aurores. Une chambre d’hôtel. Un Européen est l’invité du régime stalinien. Une infirmière en habit traditionnel arrive pour lui injecter dans le fessier sa dose de vitamine B12 1000 gammas. Elle a « les seins bridés… la noire chevelure qui tombait bas en deux nattes, les yeux, bridés aussi, mais de feu, bien qu’elle les tînt baissés[1] ». Elle est accompagnée de cinq gardes ; nous sommes sous dictature ! Pour préserver son intimité, l’homme, trente-trois ans, entraîne la jeune femme dans un coin de la pièce. Elle effectue alors son geste, délicatement. À ce moment précis, une « souterraine intimité forcée par la transgression même – le déplacement vers l’angle mort – s’établit entre l’infirmière et moi » sans qu’un seul regard, un seul battement de cils, le moindre signe de connivence aient été échangés ». Cet homme est Claude Lanzmann. Son récit est autobiographique.
Durant une semaine, l’infirmière nord-coréenne revient tous les jours, à huit heures du matin. Jamais ils ne se regardent ni ne se parlent. Ils se retrouvent simplement dans cet angle mort de la pièce pour l’injection quotidienne. Et puis, le dernier jour, un dimanche, elle apparaît seule, toute Autre, métamorphosée, « vêtue à l’européenne, d’une jupe légère et colorée, les seins débridés saillants sous le corsage, nattes escamotées, ramassées en chignon, cheveux bouclés sur le front, la bouche rouge très maquillée, d’une insolente et insolite beauté[2] ». Cette fois-ci, ils se regardent. Les gardes n’arrivent toujours pas. Elle effectue le soin, encore plus délicatement qu’à l’accoutumée. Il tremble, ressent l’appel sexuel qui émane de cette créature méconnaissable. Elle range son matériel, il lui propose de l’argent, elle refuse violemment. Que veut-elle ? Les casquettes ne sont toujours pas là. La tension monte, puis… puis ils tombent l’un sur l’autre : « nous nous embrassons à pleine bouche, nos langues luttant avec une passion, une force, une avidité, une férocité sans contrôle ni mesure »[3], raconte Lanzmann. C’est fait ! L’injection a fait place au baiser. Les gardes vont arriver, il faut faire vite. Il se fait comprendre comme il peut, lui fixe un rendez-vous pour plus tard. Il veut lui faire l’amour, « hors du regard humain »[4].
Il est quatorze heures ce dimanche. Les deux amants se rejoignent près d’un pont avec pour objectif de se rendre à l’embarcadère. La route est longue et la surveillance omniprésente, ils ne peuvent marcher l’un près de l’autre. Enfin, arrivés au bord de l’eau, le plan peut commencer : prétexter une simple partie de canotage sur le Taedong pour quitter la ville et se retrouver enfin seuls. Dans leur barque, ils sont ensemble, enfin, et tentent de s’échapper de la flopée de canots, mais à la moindre tentative de s’extraire du cercle autorisé, un garde leur aboie dessus. Qu’importe, leur tournant le dos, la jeune femme déboutonne son chemisier, offrant à l’unique regard de son compagnon « deux seins hauts, bruns, fermes, et, sous le gauche, une terrible et profonde entaille calcinée qui balafrait son torse, prononçant à la coréenne un seul mot universel : napalm »[5]. Cette marque sur le corps qu’elle donne à voir déclenche la passion de Lanzmann : « Pétrifié, bouleversé, condamné à l’immobilité par la situation, je lui vouai soudain un amour fou », confesse-t-il, « comme de chevalerie, prêt à tout pour prendre sur moi ces souffrances passées et conquérir le saint Graal. »[6]
Les rameurs se font de plus en plus nombreux, ils doivent rentrer, il le sait, mais une pensée l’obsède : « Où me trouver seul avec elle ? Elle était là, consentante, à ma portée et hors d’atteinte, définition nominale du supplice de Tantale. »[7] Au moment de débarquer, la jeune femme fait un « faux mouvement »[8] et tombe. « Hors d’atteinte », disait-il. Il plonge aussitôt pour la sauver. Il la remonte, et s’engage alors une course folle à travers des ruines pour atteindre l’hôtel le plus vite possible. Il la tire, la porte. Ils escaladent, chutent, dévalent, se relèvent, toujours sous les regards féroces de la population, et arrivent finalement à leur destination. Mais les gardes sont là et les arrêtent. Qu’importe, Lanzmann saisit de toutes ses forces sa « princesse inerte »[9] et s’enferme dans la chambre. Elle a tout juste le temps de se revêtir avant que les gardes ne surviennent. C’en est fini de leur fuite. Lanzmann ouvre aux policiers et Kim Kum-sun sort de la salle de bains telle une « apparition inoubliable, Vénus asiatique et botticellienne »[10]. Ils embarquent la déesse, l’interrogent, mais l’amoureux transi leur fait front, s’accuse, pérore, loue ce peuple héroïque, le Grand Leader, etc. Miracle, ils la libèrent, et notre héros de vouloir la mener cette fois-ci à l’hôpital, sauf qu’elle décide de rentrer chez elle, le laissant à sa porte.
Il rentre à l’hôtel. Une nouvelle pensée l’obsède : ne pas rester sur ce « fiasco d’amour »[11], la revoir, encore, et surtout l’étreindre une dernière fois. Aussi, le lendemain, déjouant la surveillance, il se rend à l’hôpital où elle travaille. Il la retrouve, et « elle leva les yeux, se précipita vers moi », nous dit Lanzmann, « me prit la main, m’entraîna vers la cour et, dans une encoignure… m’étreignit avec une violence qui fut aussitôt la mienne : nous reprîmes le baiser fou de la veille, langues à la lutte, bouches écrasées, souffles coupés, pendant un temps encore plus menacé »[12]. Puis elle le chassa et le repoussa.
Fin de l’histoire, de cette « brève rencontre »[13] qui a « modifié en profondeur »[14] notre narrateur. Relevons tout d’abord que la condition de leur rapprochement est de se soustraire au regard, les installant d’emblée dans un espace privé, intime. Ils n’échangeront aucune parole, mais doit-on considérer pour autant que seule la dimension de l’image prévaut ? Gageons que ce sont principalement les expériences relatives au corps qui délivrent ici les coordonnées-mêmes de leur rencontre, depuis la première piqûre administrée (le corps de Lanzmann) à la vue de cette profonde entaille (le corps de Kim Kum-sun), point de cristallisation chez lui d’un fantasme chevaleresque (mis en acte juste après en la sauvant de la noyade). Et, entre les deux, un premier baiser. Rappelons-nous alors que le terme de contingence rend compte chez Lacan autant de la rencontre amoureuse que de la rencontre avec la jouissance[15], relative au corps, si essentielle ici. Contingence qui ne fait que démontrer un point d’impossible, celui du rapport sexuel, que le contexte même de cette rencontre furtive en milieu hostile, ne fait qu’accentuer.
Épilogue : Lanzmann termine son récit par l’évocation d’une lettre que Kim lui écrivit quatre mois après. Au lecteur de la découvrir.
[1] Lanzmann C., Le lièvre de Patagonie, Paris, Gallimard nrf, 2009, p. 294.
[2] Ibid., p. 296.
[3] Ibid., p. 298.
[4] Ibid., p. 299.
[5] Ibid., p. 303.
[6] Ibid.
[7] Ibid., p. 304.
[8] Ibid.
[9] Ibid., p. 306.
[10] Ibid., p. 307.
[11] Ibid., p. 309.
[12] Ibid., p. 310.
[13] Ibid., p. 335.
[14] Ibid., p. 343.
[15] Cf. Miller J.-A., « La théorie du partenaire », Quarto, n° 77, juillet 2002, p. 7.






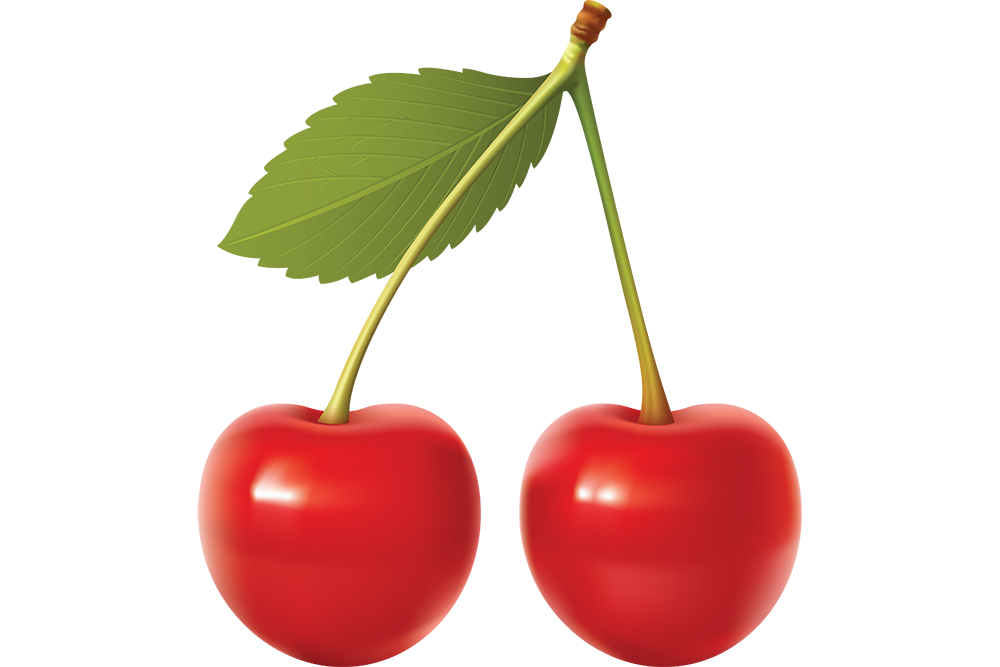




![Entretien avec François Ansermet à propos de son livre La fabrication des enfants, un vertige technologique[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/07/AnsermetHD.png)

