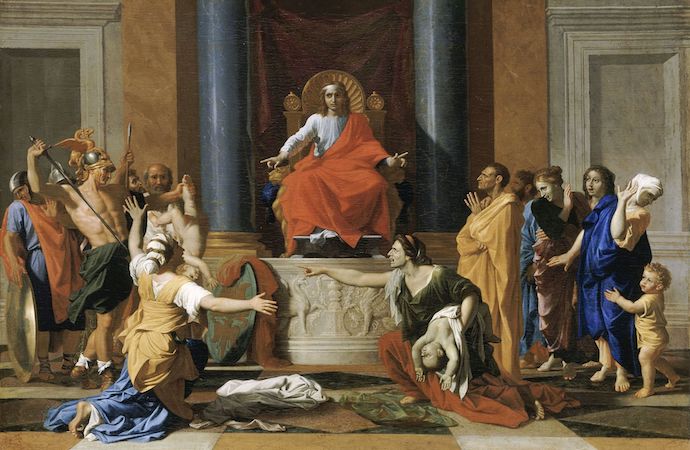Dans la série des interrogations posées au cours des Conversations « Psychiatrie et Psychanalyse » par L’Envers de Paris et L’ACF Île-de-France, la question de la justice tient une place singulière en France, la naissance de la clinique psychiatrique étant contemporaine de son encadrement juridique selon les idéaux de justice et de liberté de la Révolution française.
Pour aborder cette vaste thématique sous l’angle de la psychanalyse, étaient invitées [1] Sylvie Moysan, Juge des Libertés et de la Détention (JLD), Marie-Laure de Rohan Chabot, Juge d’Application des Peines (JAP) et Francesca Biagi-Chai, psychiatre, psychanalyste et auteure de Le cas Landru : à la lumière de la psychanalyse [2].
De la loi du père à la loi sans père
Avant la loi du 5 juillet 2011, il y eut la loi de 1990. Celle de 1838, dite loi des aliénés qui, malgré les controverses homériques qu’elle suscita, réglementa la psychiatrie française pendant un siècle et demi. Les soins psychiatriques n’ont longtemps été conçus que comme internement ou soins sous contrainte, constituant une exception majeure à la garantie de liberté individuelle, assurée par l’autorité judiciaire selon l’article 66 de la Constitution.
Mais en contrepartie, la loi de 1838 garantissait abri, soins et retour au sein de la société des enfants perdus. À cette époque, famille, état, justice et psychiatrie ne font qu’Un, l’Autre social, sous l’égide du Père et selon un ordre du monde dont M. Foucault a dénoncé l’abus de pouvoir. Bien après la seconde guerre mondiale et sa critique d’une psychiatrie « de débarras » [3], le fou a pu, dans les années 1960, revêtir la figure de l’homme libre et susciter un rejet de ce que présentait la psychiatrie.
Libérer le fou est devenu cet idéal ambigu à la source des évolutions législatives récentes, en phase avec les mutations d’une société marchande pour qui le « tous normaux » consonne avec un « faut que ça marche » qui croit éviter les antagonismes issus du singulier.
Dans ses termes mêmes, la loi de 2011, « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge », efface toute référence à la pathologie, au traitement ou à l’enfermement pour inscrire l’usager dans une relation lénifiante et contractuelle avec le soin. Son but avoué : diminuer la contrainte, l’enfermement et privilégier l’accord des patients.
C’est ainsi que le juge des libertés fait son entrée dans le soin psychiatrique, « non plus à partir de la clinique et de ses débordements, mais sur fond de norme généralisée » [4].
La dissolution de l’Autre mais pas du réel
Le malaise actuel des psychiatres tient partiellement à l’image qui leur est renvoyée de leur discipline comme reliquat d’un monde obsolète où l’arbitraire est la règle. Il n’est pas rare que l’intervention du juge des libertés, au douzième jour d’hospitalisation d’un patient en soins sous contraintes, ne soit une censure du travail psychiatrique plutôt qu’un acte de libération. Possiblement pour contrer des chiffres qui restent têtus : depuis 2011 le volume des soins sous contrainte n’a fait que croître.
Or, un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation du 27 septembre 2017 dispose que le juge ne saurait substituer son avis à l’évaluation médicale de l’état de santé de l’intéressé et de son consentement aux soins.
La loi du 5 juillet 2011 a systématisé le recours au juge des libertés, déjà écrit dans les lois précédentes mais rarement usité. Si l’on peut saluer cette innovation, au regard des exigences de droit auquel tout citoyen doit prétendre dans une démocratie, sa mise en place maladroite et hâtive, ne répond pas aux critiques et débats des avocats, juges et psychiatres. Comment un juge peut-il décider du bien-fondé d’une mesure de soins sous contraintes – le plus souvent motivée par psychiatres, certificats et demande d’un tiers – après un entretien de quelques minutes avec un sujet dont il ne peut évaluer l’état clinique, sans légitimité pour ?
Son rôle se cantonne donc à celui d’un agent administratif, statuant sur la procédure quand il s’agit de répondre à partir de la clinique.
Ce dialogue de sourds est le résultat du clivage issu de cette confusion entre contrat et soin, généralisée depuis l’inscription de la médecine dans le champ de la marchandise, supposant le patient sujet de droit et client. Or, précisément, le patient en psychiatrie n’est plus sujet de droit du fait de sa pathologie. Justice et psychiatrie sont alors amenées à répondre chacune dans son univers de discours, face à face, sans la médiation de la référence au Père qui donnait sens commun au non-rapport sexuel.
Toutefois, qu’il n’y ait pas le Père n’empêche pas que, comme le disait J. Lacan, « Y’a d’l’Un » [5], soit l’irréductible de la causalité signifiante pour chaque parlêtre. C’est ici que la psychanalyse peut substituer au vide et à la déliaison laissés par le Père, le lien que le langage permet si quelqu’un sait en déchiffrer le réel, soit cet au-delà auquel chaque parlêtre a affaire mais qui lui échappe.
Du réel de la clinique
L’attente des juges qui traitent ce réel est immense. Que ce soit dans la décision du bien-fondé d’une mesure de soins, dans la prévention de la récidive ou la détermination d’une dangerosité criminelle, ils sont confrontés à la nécessite de singulariser chaque cas selon des critères que la loi ne permet pas toujours de circonscrire.
Malgré le recours aux expertises psychiatriques, matériellement et qualitativement de plus en plus difficiles à obtenir, et les avis des professionnels en charges des personnes en main de justice, l’acte de juger suppose que soit possible une transmission d’un savoir sur ce qu’est ce réel.
C’est le sens de la clinique psychanalytique partout où elle peut trouver sa place. Pourquoi pas dans les tribunaux ?
[1] Troisième Conversation organisée par l’ACF-IdF, « Psychiatrie et justice, à la lumière de la psychanalyse », Paris, 14 février 2019.
[2] Biagi-Chai F., Le cas Landru : à la lumière de la psychanalyse, Paris, éditions Imago, 2007.
[3] Londres A., Chez les fous, Albin Michel, 1925.
[4] Biagi-Chai F., op. cit.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre XIX, … ou pire, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2011, p. 123.