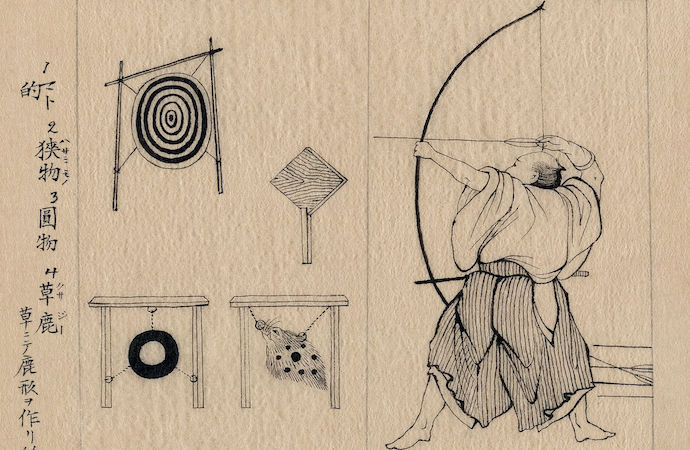La passe * est ce moment où l’acte dont procède un analyste « pourrait se saisir dans le temps qu’il se produit » [1]. Loin de n’intéresser que le seul sujet en analyse, la passe est aussi l’expérience qui soutient un projet beaucoup plus large, celui d’une Ecole. Ce projet vise à prendre en considération et à résoudre les problèmes cruciaux posés à la psychanalyse, parmi lesquels le devenir analyste n’est pas des moindres.
La passe met à contribution un analysant qui, par son cheminement dans la cure, en vient à reconsidérer son rapport au désir et à éclairer d’un jour nouveau la version du réel avec laquelle il doit désormais composer. Ce pas, le passant entend le faire savoir. A cet effet, un dispositif spécifique lui permet d’adresser son témoignage à un jury, le cartel de la passe, alors que la transmission s’effectue de manière indirecte. Elle en passe par un intermédiaire, celui des passeurs.
Acteur essentiel du dispositif, le passeur est la passe. Se pose à lui la question du désir de l’analyste, « qu’il y soit ou non en difficulté » [2]. Son office ne se limite pas à être un messager. C’est au titre d’une double fonction qu’il est impliqué dans la procédure : témoigner de la vérité comme cause, transmettre un fragment de savoir obtenu du passant. Sans lui la passe se réduirait à amalgamer en un corps constitué un groupe de dits-dacticiens.
Comment s’effectue la désignation du passeur ?
Elle est assurée par l’AME et la responsabilité de celui-ci est, de fait, engagée dans le processus de la passe. En effet, cela suppose une aptitude à lire, chez l’analysant, le moment de la passe mais nécessite aussi de sa part une capacité à discerner la possible implication du passeur dans l’expérience de l’Ecole. La désignation du passeur est une opération composite. Elle intègre à l’interprétation qui se soutient d’un « je ne pense pas » propre à l’acte de l’analyste, le discernement qui porte sur la reconnaissance d’une disposition voire un talent.
Tel analysant peut-il contribuer à ce que la vérité d’un témoignage parvienne à la barre du cartel de la passe ? Est-il en mesure de transmettre la singularité d’un savoir ? Répondre à ces questions exige de l’AME un certain discernement. La pertinence de la désignation du passeur n’est pas sans incider sur la tenue et le déroulement de la procédure. Pour cette raison elle entretient une proximité avec l’issue de la passe, voire sa conclusion. Cela implique de la part de l’AME l’acceptation tacite de voir son acte soumis à l’examen d’un contrôle.
La désignation d’un passeur – à ne pas confondre avec une nomination ou même un « nommé à » –, ne requiert pas l’agrément de l’analysant. D’être ou non prévenu de sa désignation comme passeur par son analyste n’entame pas la dimension interprétative qu’elle prend pour le sujet. C’est une désignation qui, par ailleurs, peut être contestée voire refusée. Le risque, inéliminable du processus de désignation, indique le haut degré de confiance accordé au passeur.
De cette désignation que peut-il en résulter pour le passeur ? Il est fréquent qu’il soit sensible et même affecté, tant par la décision de son analyste que par le témoignage recueilli du passant. L’angoisse, l’inhibition, l’embarras voire l’enthousiasme peuvent accompagner le non-savoir qu’implique l’être dans la passe. L’identification à un passeur idéal n’est, en la circonstance, d’aucun secours. Seule, la naïveté reste la marque d’une certaine fraicheur dans l’expérience et signe la place tenue par le passeur, celle d’un « je ne pense pas » [3].
Par la désignation du passeur l’AME est au point de passage entre intension et extension de la psychanalyse. En vertu de la garantie qu’offre la reconnaissance de son expérience il permet que se prolonge et se renouvelle ce que pourrait être l’acte par lequel advient un analyste.
* Argument de la Soirée de la Soirée de la garantie, « Le passeur, une question pour l’AME », organisée par la commission de la garantie de l’École de la Cause freudienne, 18 mars 2019.
[1] Lacan J., « Discours à L’EFP », Scilicet, Paris, Seuil, 1970, 2/3 p. 15.
[2] Lacan J.,« Une procédure pour la passe», (1967), Ornicar ?, n° 37, avril-juin 1986, p. 7-12.
[3] Lacan J., « Note sur la désignation du passeur », 1974, inédit.