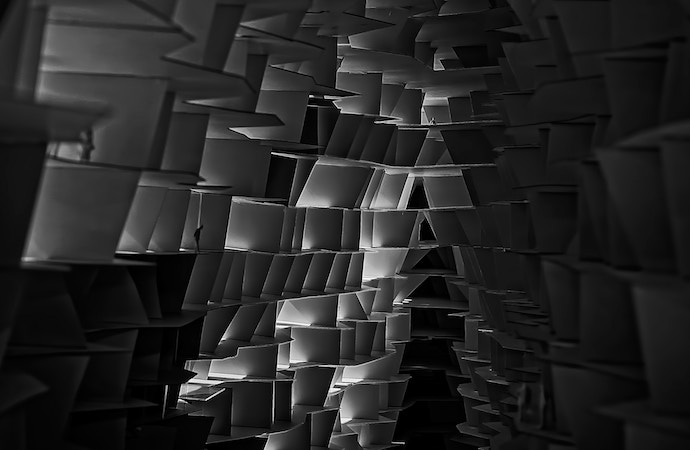Vers la fin de son enseignement, Lacan, a ouvert une nouvelle porte pour penser le trauma *, non pas uniquement comme étant cet élément en excès d’excitation qui met en échec la régulation du principe de plaisir et toutes les possibilités de liaison qui viennent avec, mais une perspective qui n’exclue pas, mais qui noue, trauma et parole, et qui fait entendre autrement ce binaire : le trauma est parole. Lacan invite à penser – Jacques-Alain Miller l’explicite bien dans « Biologie lacanienne » [1] – que le noyau de l’événement traumatique n’est pas toujours l’accident et la mauvaise rencontre, ponctuelle et repérable, mais une rencontre entre la langue et le corps. La rencontre traumatique est désormais à lire comme étant l’incidence de la langue – lalangue écrivait Lacan – sur le corps de l’être parlant.
Deux mots sur ce concept de lalangue.
Nous trouvons, dans la dernière leçon du Séminaire Encore, une élaboration de Lacan qui constitue un point de bascule : le langage devient une « élucubration de savoir », dit-il, une fiction collective et partagée, sur un réel. Ce terme d’élucubration va être très présent à la fin de l’enseignement de Lacan. Élucubration vient du bas latin elucubratio, elucubrare qui signifie « travailler à la lueur d’une lampe » comme le travail intellectuel se faisait à l’époque. Donc ce mot désignait jadis un ouvrage de l’esprit fait en veillant, un travail prolongé dans la nuit. Et en fait, ce sens va complètement disparaître pour être substitué par un sens péjoratif qui est celui qu’on utilise actuellement. On dit : « ah ça ce sont vos élucubrations ! » pour désigner une théorie pas trop sensée. Reste la marque du côté « laborieux » mais elle a pris avec le temps une forme un peu péjorative. « Le langage est une élucubration de savoir sur lalangue » [2] me semble témoigner de quelque chose qui s’ajoute, qui se superpose là où il n’y a pas de rapport préétabli d’avance. Et c’est ici le trait essentiel que ce terme d’élucubration nous permet de saisir et qui est propre à ce dernier enseignement de Lacan : élucubration est une élaboration mais qui a le caractère d’être une structure surimposée, rien ne permet de supposer qu’il existerait un lien préconçu entre deux registres, par exemple, entre le père et la perte, entre le langage et la lalangue, c’est un ajout. L’élucubration suppose surtout, la déliaison et non pas le rapport.
Alors l’antérieure conceptualisation sur l’inconscient structuré comme un langage n’est nullement abolie, elle devient une structure surimposée à lalangue. Le terme lalangue écrit en un seul mot trouve son explication en raison de son homophonie avec « lallation » qui vient du latin lallare. En fait, les Latins utilisaient « lala », une sorte de chansonnette pour endormir les enfants, équivalant de « dodo » en français ou « noninoni » en espagnol. Au fond, ce qui nous intéresse c’est que lalangue fait référence à la langue dépourvue de la syntaxe. Hors syntaxe veut dire qu’elle n’est pas une structure ni de langage ni de discours. Le passage du langage à lalangue est un passage du symbolique au réel. Il y aurait donc à la fin de l’enseignement de Lacan, l’inconscient du côté de l’élucubration, résultat d’un déchiffrage par où le sujet extrait le sens de son symptôme, les effets de vérité, et puis un inconscient pensé à partir du concept de lalangue : un inconscient réel fait des Uns, hors–sens, hors chaîne signifiante mais qui affectent le corps.
On voit bien que dans cette perspective on quitte le domaine de l’histoire, dans le sens de ce que le sujet aurait pu rencontrer au cours d’une histoire. C’est une perspective non historique, non psychologisante, et peu anecdotique.
C’est pour cela que j’aime autant ce texte de Lacan du 10 juin 1980, quand dans sa Conférence à Caracas il dit qu’au fond « Il n’y a pas d’autre traumatisme de la naissance que de naître comme désiré. Désiré, ou pas – c’est du pareil au même, puisque c’est par le parlêtre. [3]» Il n’y pas d’anecdote, il n’y a pas là d’Autre dans le sens de ce qu’il a fait ou mal fait. Il y a les mots qui percutent et affectent.
Parce que nous ne sommes pas dans le domaine des effets de vérité de ce bain de langage qui nous a précédés, par ce que cet Autre a prédit et désiré pour nous, dans le sens où on était parlés avant de parler. Nous ne sommes pas dans le domaine des effets de vérité mais des effets de jouissance sur le corps de ces signifiants avec lesquels on a été accueilli et bercé.
Nous sommes plutôt dans le domaine des marques, des S1 – signifiants-maîtres –, primordiaux qui affectent le corps du sujet. Je ne peux ici déployer le cas dans son ensemble mais j’ai pu récemment témoigner lors d’un colloque en juin dernier, du parcours d’un enfant de 8 ans lors duquel il a réussi, à la fin de ce travail qui a duré un certain nombre d’années, à construire un savoir – notamment en s’appuyant sur l’histoire de guerres mondiales – où il va traiter des signifiants traumatiques qui l’ont accueilli au moment de sa venue au monde. Ces signifiants (comme la blessure, le scalpel) venaient affecter directement son corps. C’est une trace qui produit des affects parfois mortifères.
On peut dire que ces signifiants sont traumatiques parce qu’il assiste à une valeur autre que prend le langage. Ce n’est pas le langage meurtre de la chose. Ce n’est pas non plus la perspective de penser que le langage est un ordre, qu’il est un réseau qui permet de lier, d’ordonner, de produire du sens et que le trauma, par son excès, va révéler les limites à la puissance de nomination du langage. Ici c’est autre perspective qui s’ouvre à nous comme cliniciens où le langage n’est pas ordre mais trace, trace qui dérange, perturbe et affecte le corps. Le traumatisme premier pour chacun de nous est cette rencontre primordiale des mots avec le corps.
* Texte issu d’une conférence prononcée le 9 février 2019 aux Après-midi du Collège Clinique de Lille et de l’ACF-CAPA dans le cadre du cycle Paroles et traumatismes.
[1] Miller J.-A., « Biologie lacanienne et évènement de corps », La Cause freudienne n°44, Paris, Navarin/Seuil, 2000, pp. 5 à 45 de l’édition numérique.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, (1972-1973), texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 127.
[3] Lacan J., « Le Malentendu », Ornicar ?, Paris, Navarin/Seuil, n°22/23, juin 1980, p.13.