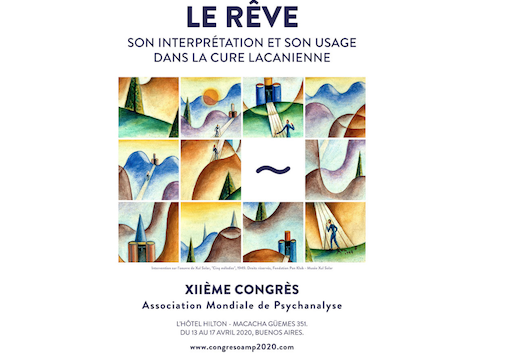Considérer le rapport entre psychanalyse et neurosciences pose des questions d’ordre épistémologique, d’une part, d’ordre éthique et politique, d’autre part.
Il est clair que le rapport entre les deux disciplines est irréductible étant donné la coupure épistémique absolue entre les dimensions mentales et cérébrales. Au niveau épistémologique, si les recherches neurologiques qui s’occupent de comprendre le fonctionnement du cerveau et la nature de notre connaissance sont nombreuses, leur compréhension des aspects mentaux de l’homme et de ses circuits cérébraux a, toutefois, des limites bien spécifiques [1]. À cela s’ajoute un préjugé épistémologique qui détermine la supériorité du savoir neurologique sur la connaissance humanistique ou qualitative du fonctionnement du cerveau. Il s’agit d’une opinion préconçue enracinée dans le sens commun et qui se fonde sur une vision épistémologique désormais dépassée parce que liée à une perspective néopositiviste de la fin du XIXe siècle qui confond l’empirique avec le scientifique [2], selon laquelle la donnée empirique est scientifiquement supérieure. C’est donc une opinion arbitraire et démentie aujourd’hui [3].
À un autre niveau, plus clinique, se pose une question politique et éthique car l’écoute psychanalytique du patient, la position analytique d’écoute de la parole permet l’émergence du sujet, c’est-à-dire de la subjectivité au-delà de l’individualité. Il y a une correspondance entre l’individualité, telle qu’elle est entendue par la psychologie, et la réduction du sujet au cerveau, mise en œuvre par la neuropsychologie. Il s’agit d’une individualité qui est différente du sujet de la psychanalyse, qui ne correspond pas aux identifications qui définissent l’individu [4] dont la psychologie s’occupe. Donc, on pourrait dire que la psychanalyse écoute ce sujet qui est méconnu, forclos, autant par la science psychologique (en le réduisant à l’« individu ») que par la neuropsychologie (en le réduisant au « cerveau »). De ce point de vue, l’écoute psychanalytique, la pratique clinique des psychanalystes reconnaît une valeur véritablement politique et éthique à l’émergence du sujet : le sujet comme celui qui a la possibilité de se désengager du discours du maître, c’est-à-dire des idéaux, des identifications imposées (les S1).
Ce n’est pas un hasard si, dans l’ensemble de son œuvre, Freud utilise plusieurs fois des métaphores politiques. Par exemple le terme « censure » qui apparaît dans L’Interprétation des rêves a une connotation politique, à propos de laquelle Freud affirme, dans une lettre du 22 décembre 1897 à W. Fliess, que dans le tsarisme : « des mots, des phrases, des paragraphes entiers sont caviardés, de telle sorte que le reste devient inintelligible » [5]. Il s’agit de métaphores politiques qui n’ont pas seulement une valeur explicative, mais plutôt une fonction de représentation et de modélisation de l’objet scientifique même [6].
Voilà que l’inconscient prend une signification politique et que la psychanalyse implique une politisation du psychique contrairement aux neurosciences qui tendent à dépolitiser l’esprit. En fait, comme l’expliquait Carl Schmitt [7] en référence au discours technique, les neurosciences tentent une opération de « dépolitisation » de l’esprit, c’est-à-dire une position qui prétend être détachée de tout jugement de valeur et donc sans subjectivité. Un esprit privé des conflits qui sont remplacés par des échanges de signaux électriques ou chimiques. Le cerveau est un espace neutralisé, purifié de questions politiques, contrairement au sujet de la psychanalyse, cette dernière, ayant une position éthique, fait coïncider inconscient et politique.
Il s’agit donc d’une position, celle de plusieurs neuroscientifiques, qui se veut « a-idéologique », mais qui sous-tend un choix théorique de champ bien précis de méconnaissance du sujet. C’est-à-dire le choix politique de dépolitiser le psychique en le réduisant à un ordre naturel, préconstitué et déjà déterminé.
[1] Velázquez L., « Teoria della conoscenza e neuroscienze », Epistemologia, n°XXXVIII, 2015, p. 200.
[2] Licitra-Rosa C., « Dall’impasse delle neuroscienze all’impasse della scienza », La Psicoanalisi, n°XXXII, 2002, p. 183.
[3] Ibid.
[4] Arreguy M. E., « La lecture des émotions et le comportement violent cartographié dans le cerveau », Topique, n°122, 2013, p. 147.
[5] Freud S., Lettere a Wilhelm Fliess. 1887-1904, Torino, Bollati Boringhieri, 2008, p. 326.
[6] Erdelyi M. H., Freud Cognitivista, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 181-185.
[7] Schmitt C., « Il concetto di politico », Le categorie del « politico », Bologna, Il Mulino, 1972, p. 178 et suivantes.