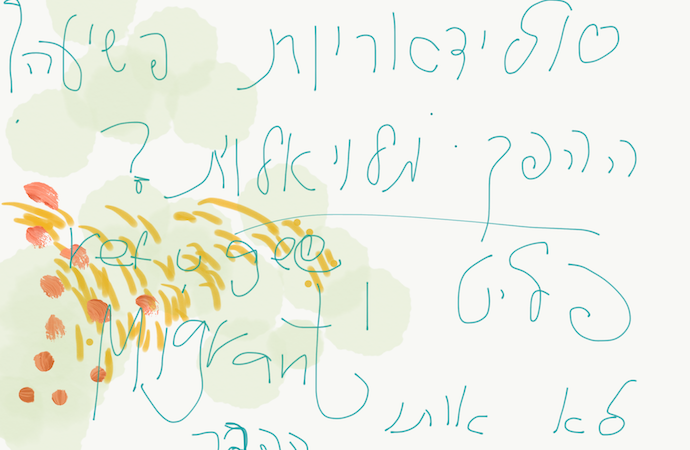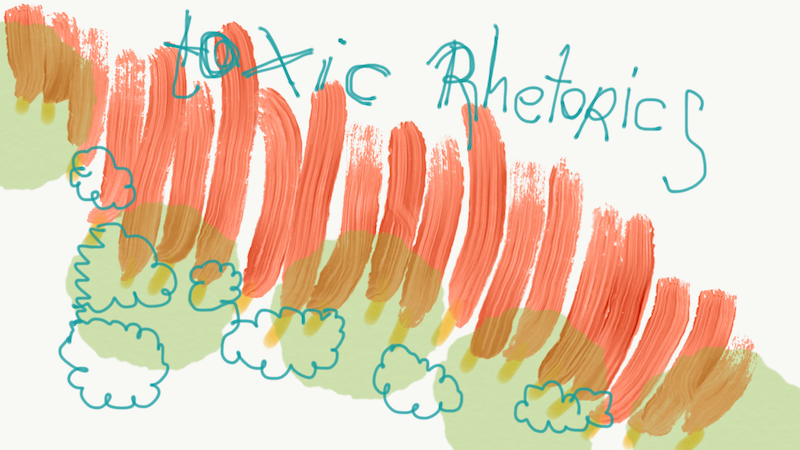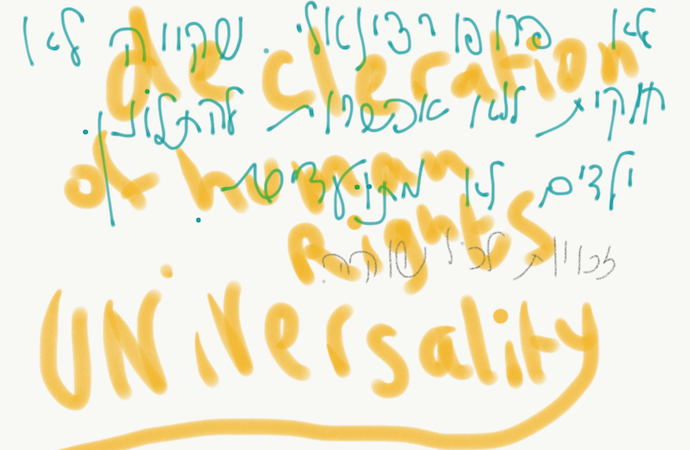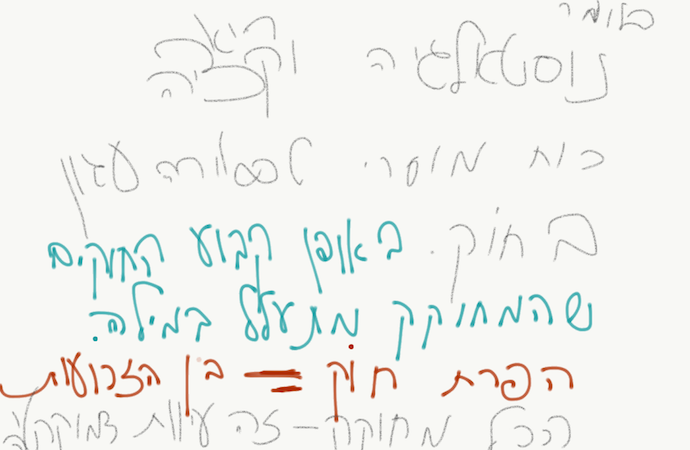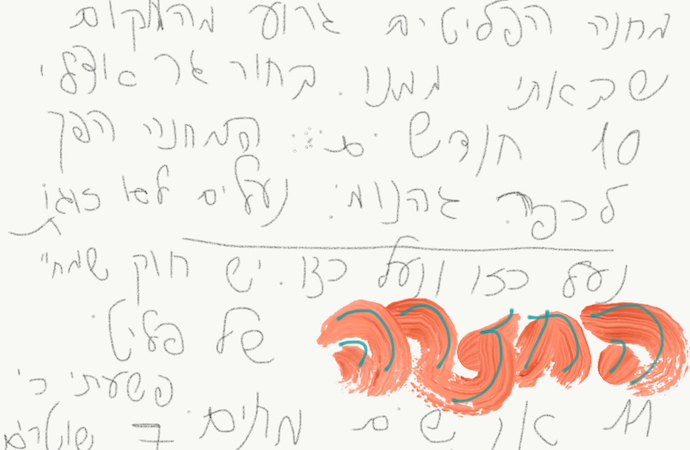Visuel : Sigalit Landau
J’aimerais essayer avec vous, et dans le bref laps de temps qui m’est imparti, de comprendre ce qui se joue dans le succès fulgurant des formations dites « populistes » – mais que, en toute rigueur, il serait plus exact de qualifier de « nationalistes » [1]. Ce succès s’est bâti au moyen d’un recours massif à des « discours qui tuent », pour reprendre l’expression qui donne son titre à ce colloque. Le politologue Jan-Werner Müller fait même de l’emploi d’un discours déshumanisant le trait distinctif du populisme. Selon ce dernier, ce qui caractérise le dirigeant populiste, c’est sa prétention à incarner la volonté unique d’un peuple homogène. Ce qui rend possible cette vision simpliste du débat politique, c’est une certaine moralisation de la vie politique. Le « vrai » peuple adhérerait à un ensemble de valeurs nobles, ancrées dans le bon sens. Et tout ce qui ne partagerait pas cette vision moralisée du monde n’appartiendrait plus au peuple, voire en deviendrait l’ennemi (le qualificatif est, par exemple, employé de façon récurrente à l’encontre des journalistes, coupables de vérifier dans leur travail au quotidien que la volonté du peuple et le programme populiste ne coïncident pas parfaitement). La revendication morale de se faire le porte-parole d’un peuple « authentique », doté rhétoriquement de toutes les vertus, autorise alors le populiste à ignorer, voire à bousculer, tous les contre-pouvoirs qui pourraient se dresser sur son chemin.
Ce qu’il me semble crucial de relever, c’est que ces discours qui tuent, faits d’unanimisme moral et d’exclusion radicale, se sont construits selon une trajectoire historique singulière. Pour le dire schématiquement, depuis les années 1980, une rhétorique antimigrant portée par les formations politiques d’extrême-droite monte dans le débat public. Elle fut dans un premier temps l’apanage des partis ethno-nationalistes. Elle a cependant été intégrée sans difficulté dans le logiciel idéologique des populistes, qui l’ont couplé à la dénonciation générique d’une élite vaguement définie. Cette élite ne peut qu’être corrompue, puisqu’elle se caractérise d’abord et avant tout par l’écart qui la sépare de la vertu prêtée au peuple. Les populistes ont alors eu vite fait d’accuser les élites corrompues de faciliter l’arrivée de migrants, supposés favoriser leurs intérêts économiques.
Mais, le fait inédit de ces toutes dernières années, c’est que cette rhétorique se prolonge désormais dans une dénonciation beaucoup plus large et radicale. Plutôt que de dénoncer telle ou telle décision démocratique prise par des élites politico-économiques et jugée aller à l’encontre de ce qui est présenté comme la volonté populaire, le discours des populistes a glissé insensiblement vers une dénonciation de la démocratie en tant que régime politique. Ce n’est donc plus tant l’issue d’un débat public que l’on conteste, mais le principe même de la délibération démocratique.
Ma thèse, pour expliquer cette trajectoire inquiétante, tient en quelques mots. Je pense que derrière cette mutation de la critique ciblée de la migration en une dénonciation sans réserve, ni nuance de la démocratie se cache une même logique : le besoin de certitudes. Ou, pour le dire par la négative, une crainte du vide, de l’indétermination qui se manifeste par le rejet de tout débat critique.
Qu’est-ce qui expliquerait que la haine des migrants des uns précède et préfigure la détestation de la démocratie ? Pour le dire vite (et sans les nuances qu’il faudrait apporter dans une intervention plus longue), tant les migrants que la démocratie partagent un lien étroit avec la notion de pluralisme.
Les premiers parce que, en rejoignant une communauté politique dans laquelle ils n’ont pas grandi, ils y apportent des manières de faire, de voir et de penser qui font mauvais genre. Leurs comportements ne sont pas toujours en adéquation étroite avec les valeurs et les normes qui tissent la trame de la culture publique nationale. Cette inadéquation peut alors contraindre les deux acteurs de cette interaction à des ajustements mutuels. En cela, « l’étranger » ne diffère guère du « jeune », puisque l’un comme l’autre sont des « nouveaux venus » à la communauté. Tant les étrangers que les nouvelles générations doivent trouver une façon de s’intégrer à la communauté politique sans pour autant trahir ce qu’ils sont et comment ils se sont construits. En retour, ils peuvent contraindre, délibérément ou à leur insu, la communauté politique à s’interroger sur la légitimité et la justice de ses pratiques collectives. L’étranger, par ce qu’il apporte de neuf, impose à sa communauté d’accueil de poser un regard réflexif et critique sur elle-même – ce qu’elle peut vivre douloureusement comme un reproche, voire comme une remise en cause de son existence (que l’on songe à la thèse du « grand remplacement » qui circule dans les milieux d’extrême droite en France). En ce sens, l’étranger est à tout le moins vecteur d’incertitude puisqu’il soulève des interrogations nouvelles. Tacitement, il est une remise en cause des fondements imaginaires et toujours discutables du mythe de la communauté nationale.
Il en va de même pour la démocratie. Entendue comme l’exercice du pouvoir qui se légitime par l’ouverture du débat public à tous, la démocratie est indissociable d’une pluralité de points de vue. Le principe même de l’alternance du pouvoir entérine ce lien entre démocratie et pluralisme. Le pouvoir n’est la propriété de personne. Il ne peut se détenir pour une durée indéfinie. Il n’est que confié temporairement aux représentants du point de vue actuellement majoritaire. La démocratie présuppose donc l’acceptation d’une diversité des visions du monde, ce qui va nécessairement de pair avec une forme de relativisme. Les participants aux débats publics ne peuvent échanger de façon constructive qu’à la condition d’admettre qu’ils ne peuvent être les seuls à détenir une vérité absolue et infaillible. Chacun doit admettre le principe même de la critique de ses arguments et positions au sein d’une délibération continue (quoique rythmée par les échéances électorales). Par conséquent, la démocratie ne peut se revendiquer ni d’une idéologie d’État, ni d’une philosophie de l’Histoire, ni d’une autorité théologique pour établir sa légitimité. Elle est le régime politique qui est suspendu à la participation – pluraliste et conflictuelle – des citoyens.
Ce qui explique que les populistes, après avoir fait des étrangers, des boucs émissaires commodes, s’en prennent aujourd’hui à la démocratie elle-même. Car l’un comme l’autre véhiculent un certain inconfort, une obligation de se soumettre à un examen critique qui est incompatible avec le postulat d’un peuple homogène et unanimement vertueux. Ils invitent à l’exercice du retour critique sur soi-même et exposent le fait que la communauté comme ensemble holistique n’existe pas. Seule la société, fragmentée et traversée par des courants diverses, peut faire état d’une existence concrète. Au risque d’apparaître pessimiste, il faut donc poser l’hypothèse que cette mutation d’une rhétorique antimigrant en une rhétorique antidémocratique ne soit que le reflet d’une intensification de son principe intrinsèque : le rejet du pluralisme critique. Les « discours qui tuent », si on ne leur oppose aucun contre‑discours, ne continueront pas uniquement à mettre en péril la vie des migrants. À terme, ils menaceront également la vitalité de la démocratie.
[1] Intervention au Forum européen Zadig en Belgique, Les discours qui tuent, qui s’est tenu le 1er décembre 2018 à Bruxelles.