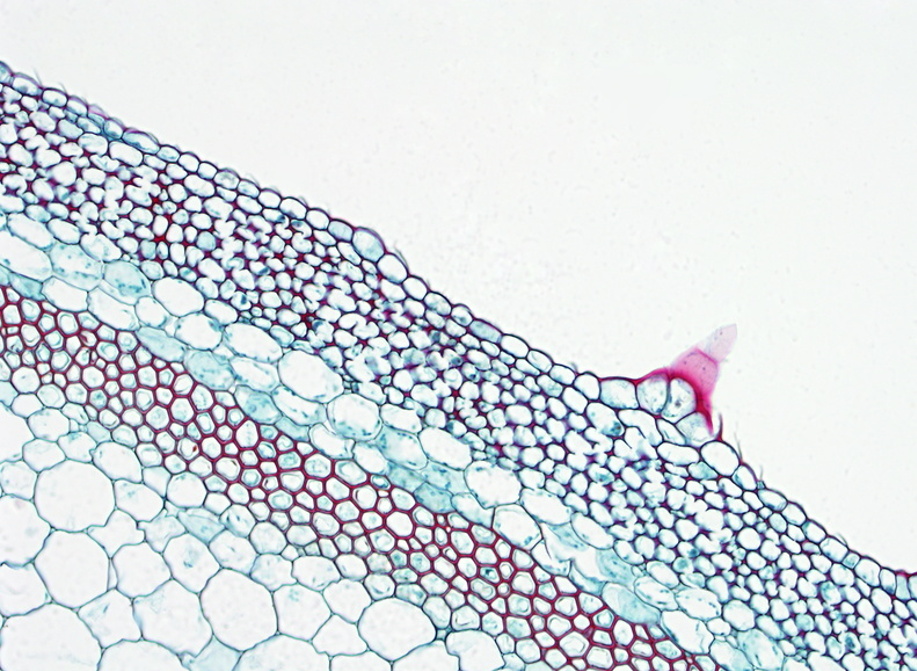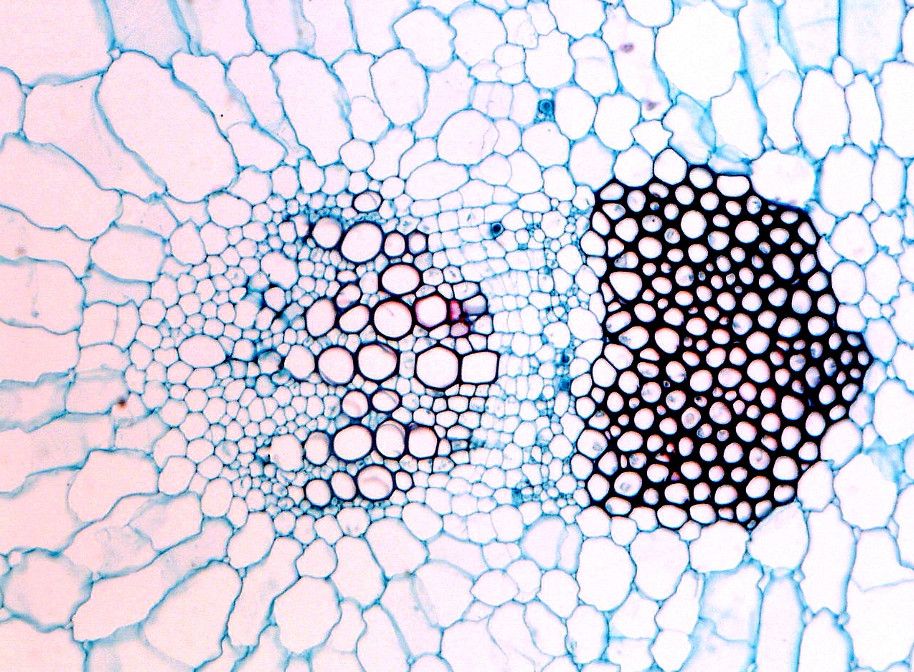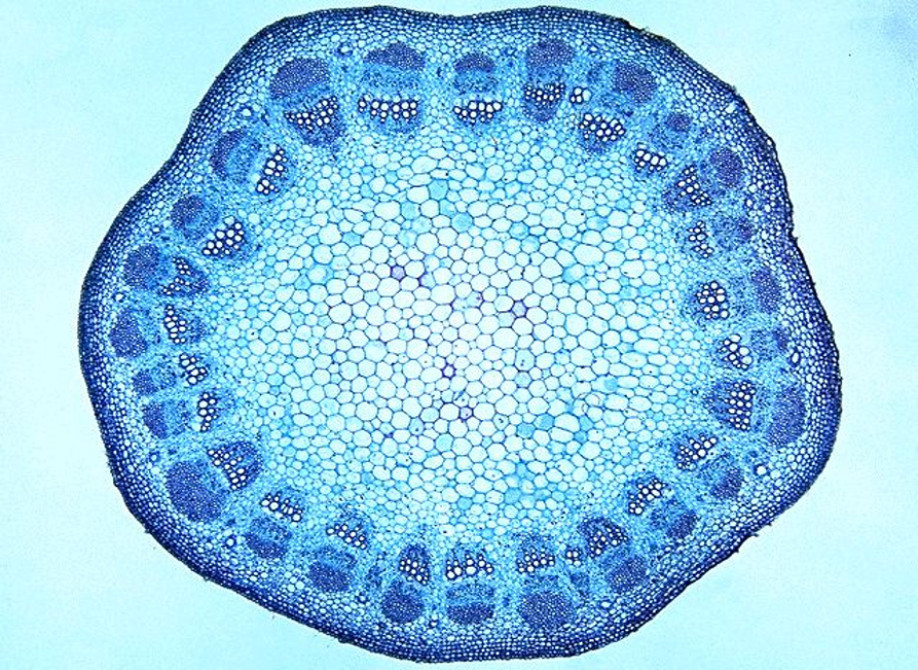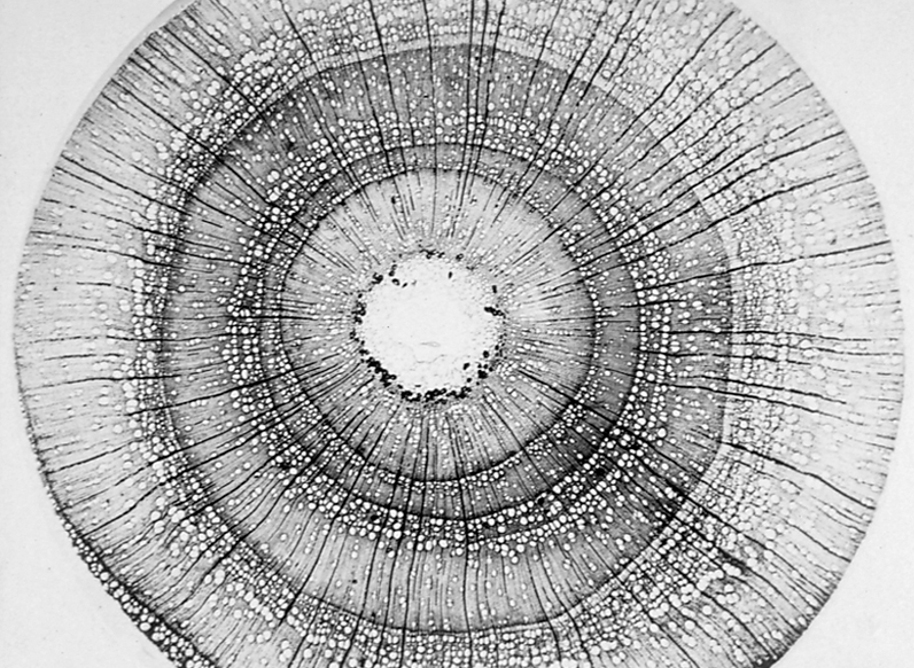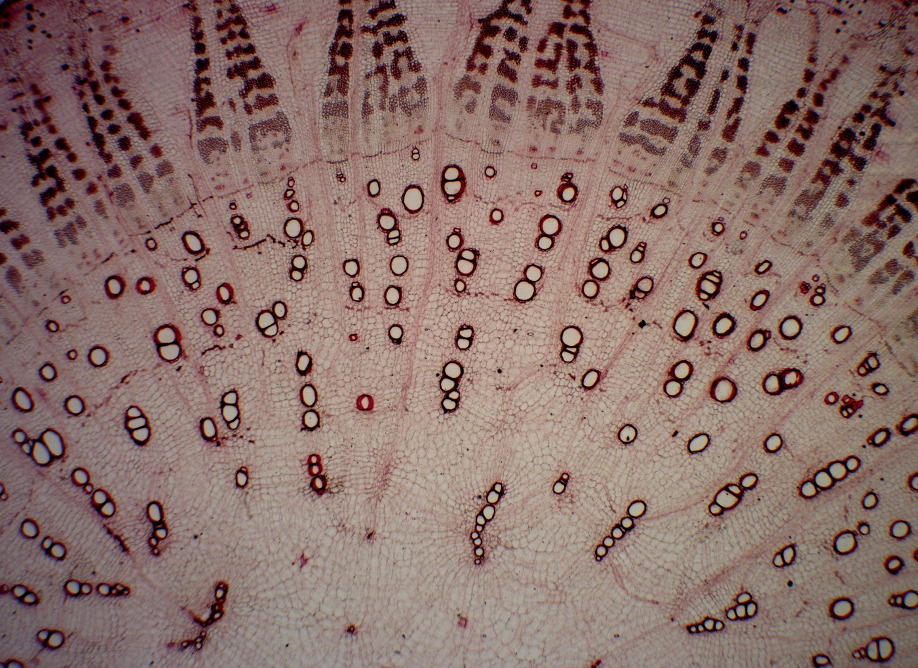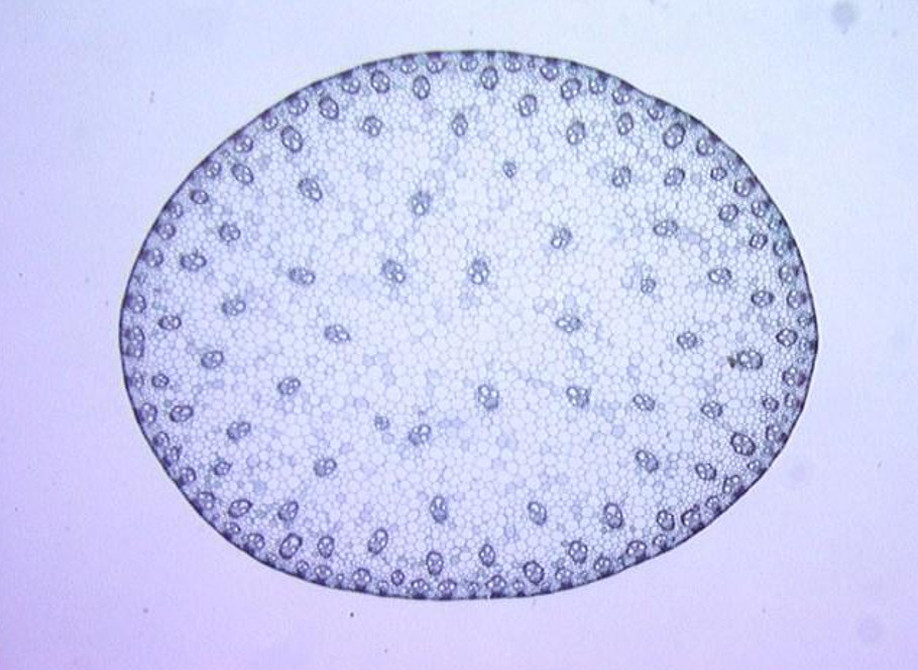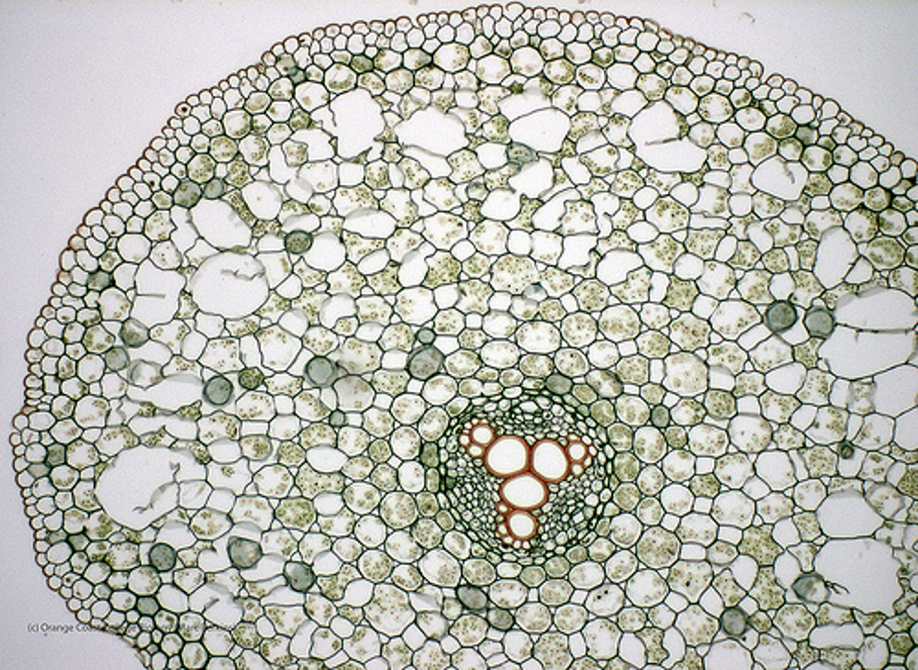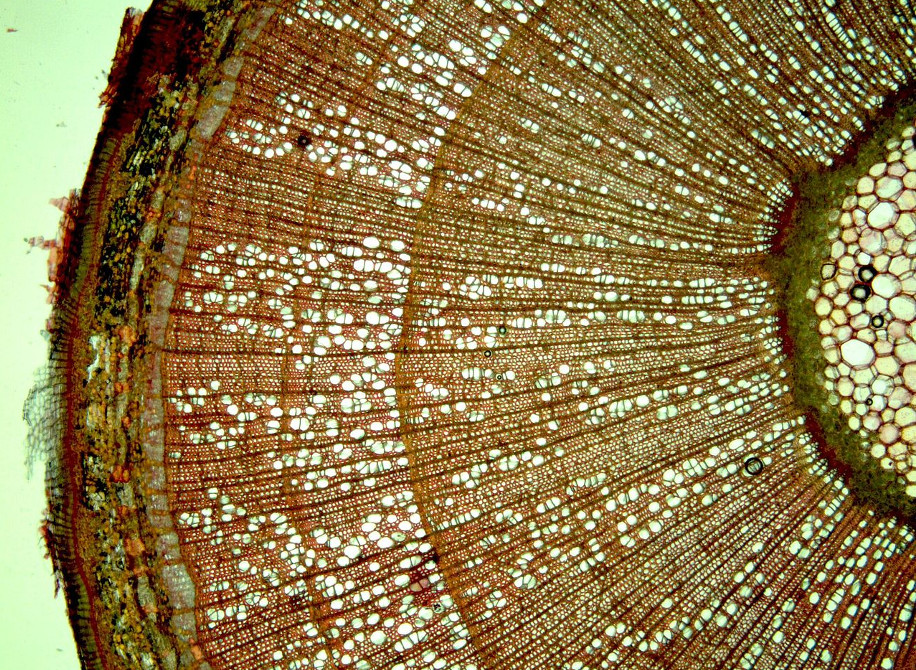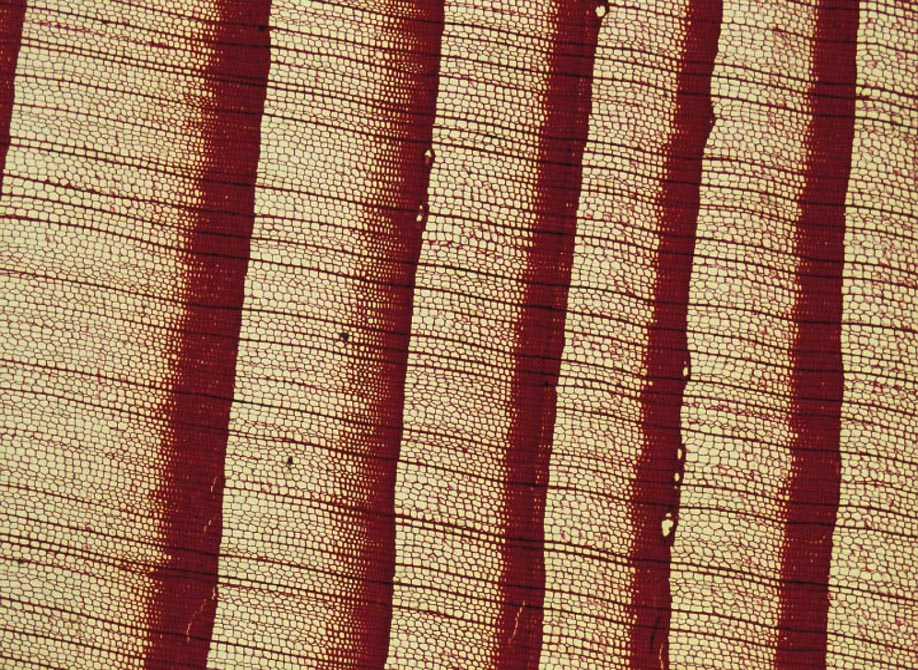La façon dont cet homme presque sexagénaire prononce « ma maman » incite à l’écrire d’un seul trait, « mamaman », d’autant plus qu’il évoque le lieu d’une haine affirmée sans vergogne à son égard dès l’aube de son existence : elle ne le voulait pas et n’a jamais consenti à ce qu’il existe. Certitude avec laquelle il a construit son existence en s’appuyant sur quelques autres : son beau-père, qui s’est montré « un vrai père » et qu’il nomme « mon papa », et son frère de six ans son aîné auquel il voue une grande reconnaissance de s’être montré « protecteur », « paternel », puis sa femme et quelques amis.
Il y a dix ans, une succession de décès viendront mettre en péril une défense toute entière construite sur le sentiment de culpabilité envers cette mère et un devoir absolu de responsabilité envers ses plus proches : les mettre à l’abri de son pouvoir de nuisance (à elle) ; ce qui a nécessité une certaine mise à distance. Adviendra la mort du beau-père, puis celle de la nièce, fille et seul enfant de son frère qui se suicidera à son tour un an après. L’ayant, trouvé pendu dans son garage, il aura à soutenir le corps lors de la « dépendaison » et le contact des lèvres du cadavre sur son cou lui fera perdre connaissance. Il découvrira ensuite qu’il lui avait caché savoir que leur père était décédé depuis peu et que ce dernier, contrairement au dire de la mère, n’avait pas déserté le domicile familial au moment de sa naissance, mais qu’elle l’avait mis dehors. Il prendra contact avec sa famille qui confirmera et l’informera que ce « père-géniteur » avait eu des velléités de reprendre contact sans pouvoir s’y décider. S’ensuivront plusieurs années d’état dépressif plus ou moins tempéré par des médicaments et le soutien de sa femme. Il devra imposer à sa mère un placement en maison de retraite. Il ne pourra s’empêcher de lui rendre visite régulièrement et d’en être à chaque fois intimement atteint : « Je mettais plusieurs jours à m’en remettre, mais il fallait que j’y retourne ! » Peu après adviendront des phénomènes de désorientation majeure qui lui imposeront l’arrêt de travail. Au bout d’un an, il est orienté vers le CPCT par la médecine du travail en raison de son état d’angoisse et de son absence de goût pour quoi que ce soit.
Le traitement aura permis deux effets principaux.
Il lui a tout d’abord permis d’envisager une femme en lieu et place de cet ensemble vide que fait résonner le signifiant « mamaman ». Il dira très vite s’être rendu compte qu’elle ne peut s’empêcher d’être méchante, non seulement avec lui mais avec tous les autres : « C’est ce qui la fait tenir ! » Ce sur quoi je m’appuierai pour lui faire trois propositions.
Après qu’il se soit questionné, « Parfois je me demande ce que j’ai pu faire au Bon Dieu pour avoir à vivre ça », je propose que ce n’est sans doute pas lui en tant que tel qui est mal tombé pour elle, mais le fait qu’elle soit tombée enceinte. Il associe : « J’ai su compenser en étant très sociable et en recevant beaucoup d’amour. » Donc en tombant bien pour d’autres.
C’est la culpabilité du survivant qui surgit ensuite dans les séances : « Mon père biologique, mon beau-père et mon frère sont morts à cause d’elle, à cause de ma maman, et je suis le seul à en avoir réchappé, et je suis le dernier à pouvoir m’en occuper ! » Je note qu’il se trouve aussi confronté à ne pas pouvoir s’en occuper parce qu’elle le lui rend impossible.
Il a pu profiter d’un séjour au bord de la mer avec sa femme. Mais il évoque un moment particulier : « J’étais sur la plage bien détendu et d’un seul coup je me suis mis à penser à ma maman, je la voyais toute seule, sans personne avec elle. J’ai éprouvé de la honte. Mais ça a pu se calmer et j’ai pu quand même profiter de ce séjour avec ma femme. ». Il note que les séances lui font du bien : « Je peux mettre des mots sur mon mal-être. » Je lui propose : « Quand vous vous faites du bien, ça ne lui fait pas de mal. ».
Deuxièmement, ce suivi lui a permis de faire de la culpabilité un symptôme. Dans le même mouvement où il distingue sa vie et celle de sa mère, et où choit l’attachement viscéral à la culpabilité associée à celle-ci sur le mode d’une faute existentielle radicale – « J’aurais dû n’être pas », il met en place première la culpabilité envers le frère, sur le mode du manque. Ainsi il est content de me dire qu’il a pu, pour la première fois, faire appel à ses enfants. Il leur a demandé de « prendre le relais » en allant aussi voir leur grand-mère et le soulager ainsi un peu. « Peut-être que je me nourrissais de souffrir ? Maintenant, j’en ai moins besoin. » dira-t-il. Mais il arrive à sa treizième séance oppressé par l’angoisse : « Alors que je ne suis plus en train de me battre et que je devrais aller mieux, je me sens oppressé ! » Puis comme je suggère que ce n’est sans doute pas sans lien avec quelque chose d’autre qui l’éprouve : « Je me sens vraiment abandonné. Avant, j’aimais bien la solitude, je prenais ma voiture et je partais faire des marches, seul. Maintenant, il (son frère) ne sera plus là pour me récupérer, comme il l’a toujours fait. Maintenant que j’ai mis de la distance avec ma mère (c’est la première fois qu’il ne dit pas « mamaman »), j’ai la place pour penser à lui, pour ressentir le manque. »
Le transfert aurait donc été la condition pour que ce sujet aborde la rive de ce qui le sépare à jamais du frère mort. Insiste, cependant, cet instant d’irruption d’un trop de réel de jouissance au contact des lèvres du cadavre. Chez ce sujet qui en aurait déjà trop vu et trop su du réel de la haine, peut-être est-ce à chasser comme un mauvais souvenir, si ce corps, affecté alors d’un dégoût radical, il peut le métaphoriser comme tel[1] ? Mais sans doute réussira-t-il à le traiter autrement dans le travail auquel il s’est désormais engagé avec un analyste.
[1] Cf. Laurent É., L’Envers de la biopolitique. Une écriture pour la jouissance, Paris, Navarin/Le Champ freudien, 2016, p. 124-125.