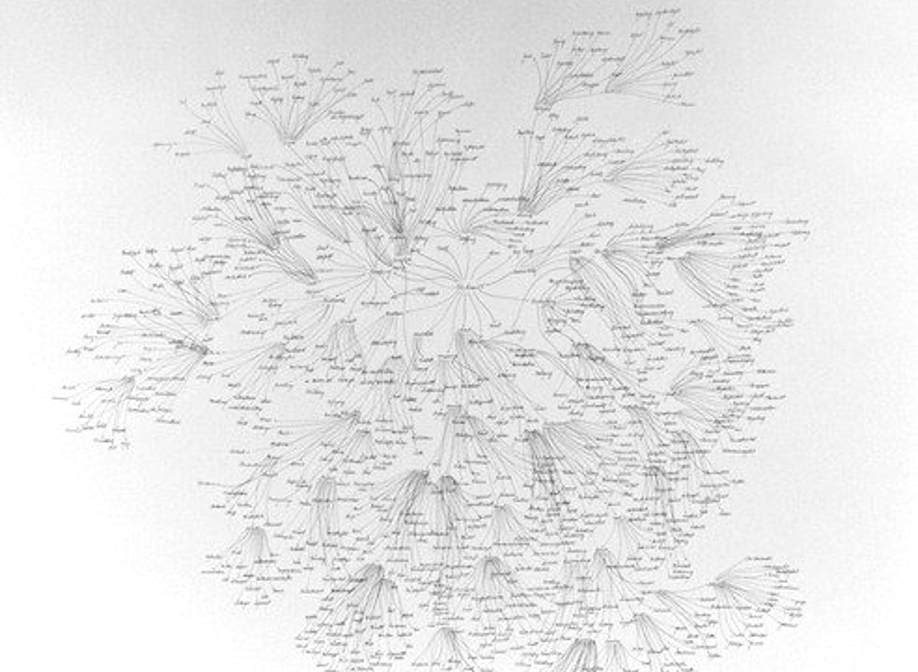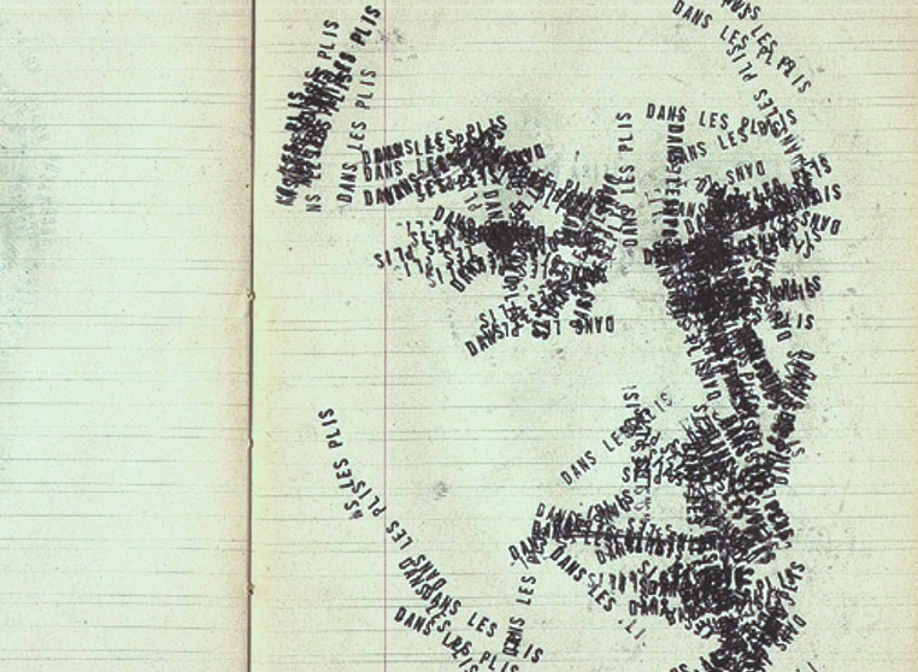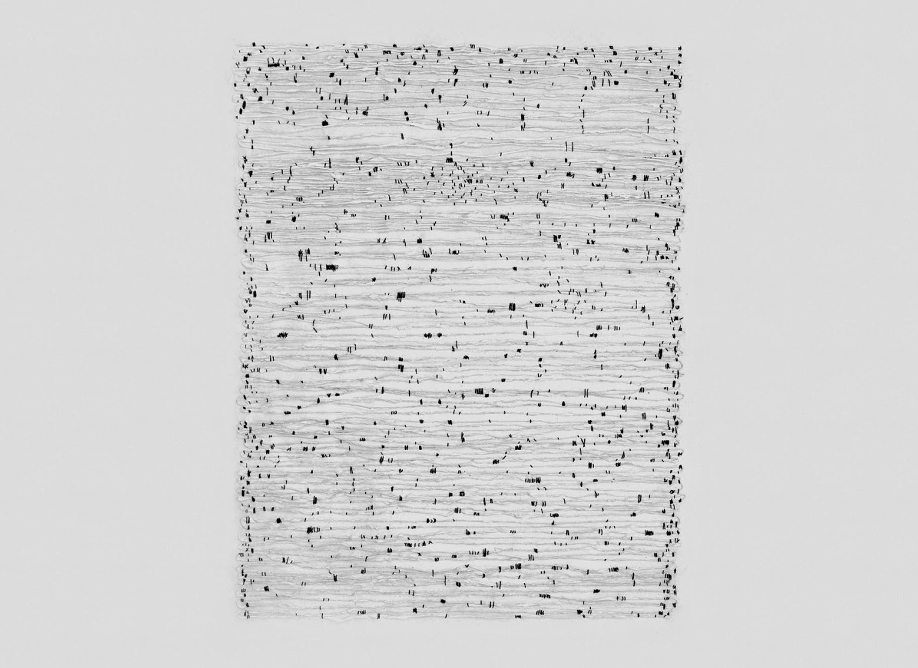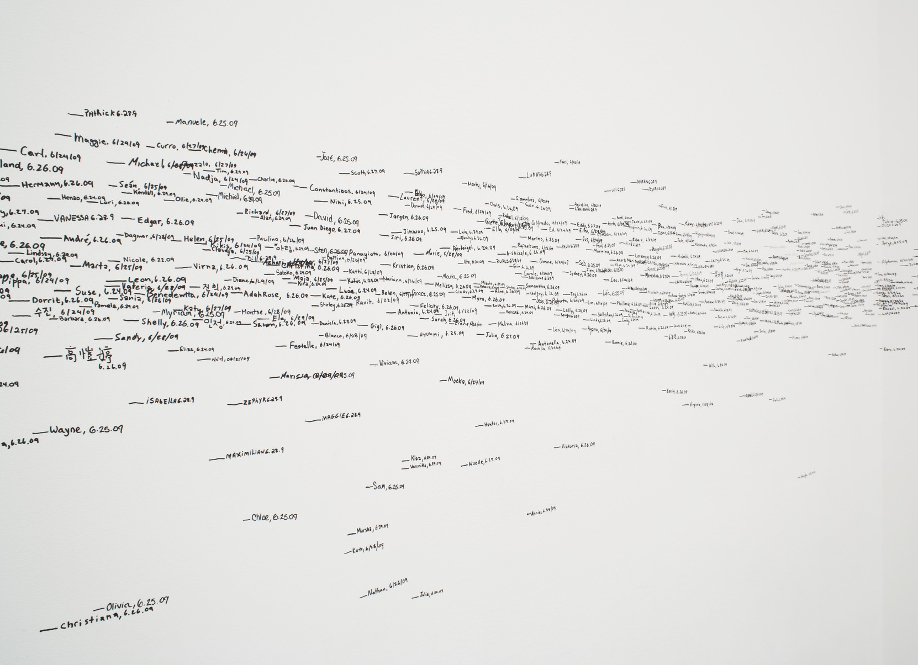L’oeil de la poupée[1], c’est le titre du livre autobiographique d’Irina Ionesco.
La fascination qu’il dégage tient au fait qu’il est écrit à la troisième personne, que tous les noms réels y sont substitués par d’autres fictifs, sans pour autant que le lecteur ait affaire à un roman. Irina se regarde vivre tout au long du livre, et nous fait participer à son regard qui dans le même temps interprète.
Et ce style, qui fait puissamment exister ce regard surplombant, est syntone au sentiment de la vie qui peine à irradier le corps de la jeune fille, puis de la jeune femme. L’immense tristesse de sa grand-mère qui l’élève, mais surtout le silence pesant de la lourde énigme de sa naissance, et encore plus ce « regard dans lequel elle ne se voit pas », et qui est celle de cette mère à l’absence irrémédiable autant qu’inconsolable pour la jeune enfant, en est le prisme mortifère.
Entendant les mots de l’amant de sa mère qui annoncent l’embarquement vers un lointain pays et l’absence de cette dernière, « A ces mots, le vertige envahit Isa et tue à jamais une partie d’elle-même. La petite grandira à même la cavité béante qui vient de se creuser au centre de son corps »[2]. Et encore « Maintenant, elle hurle. Elle a été abandonnée. Elle a perdu tout miroir. Irréversiblement ».
Se joindront à cela les absences tout aussi inexpliquées du père.
L’oeil de la poupée, ce sont les yeux verts de cette mère, jeune, belle, impassible, qui s’absentera de longues années, quatorze, pour un lointain pays. Et dont plus tard, les yeux de la maîtresse d’école d’Isa/Irina prendront le relais. Mais c’est aussi cette poupée de porcelaine offerte par le père, ou encore cette danseuse qui lui ressemblait. Pour la jeune fille s’enchaînent les maladies qui pullulent dans cette « cavité » mortifère du corps de l’enfant : hémorragies nasales qui la vident de son sang en Roumanie, pays natal où elle passe les premières années de sa vie, fièvre de la tétanie, dénutrition pendant la guerre, puis pleurésie, et incessantes angoisse et cauchemars.
Se produit à l’adolescence, en assistant à des spectacles de cabaret, un revirement subjectif, et conséquemment un « rebroussement » du symptôme par le choix de son métier. « Sa vraie culture serait le sens du corps ». Isa/Irina devenue jeune femme va ainsi domestiquer cette « cavité ».[3]
D’abord par la discipline de la danse « Son corps a besoin de vie. Ces exercices quotidiens lui apportent un bien-être »[4]. Puis comme écuyère acrobate, « Dans quelques heures, elle sera à nouveau ce point de mire, une cavalière au corps sculptural ondoyant au rythme de la musique animant le manège du célèbre Bal Tabarin. »[5]
Ensuite à dix-neuf ans, comme contorsionniste, évoluant avec deux boas accompagnant ses contorsions. « Isa est devenue une femme spectacle [….] La femme aux serpents ». Puis comme acrobate encore. Comme le dit l’auteur, « c’est grâce à cette discipline du corps, qu’elle assurait un équilibre à son errance »[6]. L’atmosphère produite à cette époque par la découverte freudienne irrigue de bout en bout le récit. Nous sommes dans la première moitié du vingtième siècle, Isa/Irina rencontre un philosophe danseur. Elle deviendra aussi la cible vivante d’un lanceur de couteaux qui la laissera pour aller finir ses études de psychanalyse en Argentine. Puis elle se lie avec un révolutionnaire professionnel. Elle parcourt le monde, passe plusieurs années en Syrie. « Dans l’espace idéal de la scène, elle devient le rêve de l’autre »[7]
Mais au cours d’un spectacle, c’est l’accident. Son partenaire n’a pu la rattraper au cours d’une voltige acrobatique. Isa/Irina, après une longue hospitalisation, commence alors à faire des croquis, et peint.
De retour à Paris, elle deviendra la photographe sulfureuse et controversée que l’on sait.
« Toujours l’effigie de cette femme. Sa mère est venue l’habiter. Pendant toute la seconde partie de sa vie, à coups de milliers de clichés photographiques, Isa désirera la reproduire ».
Transposant, sublimant ainsi, dans cette superposition, ou plutôt cette fusion, de la mère imaginaire et de sa fille qui lui servait de modèle, l’acte de son père qui fit de sa fille, la mère de leur enfant : Isa/Irina. De la couleur verte des yeux de la mère-poupée, et du corps tétanisé de la jeune fille par cet Autre au regard vide d’affect, à la discipline contorsionniste vivifiante sous le regard anonyme du public, le regard ira se matérialiser dans l’appareil photo, productions photographiques qui répèteront, dupliqueront, avec la propre enfant d’Isa/Irina comme modèle, la réelle confusion fille-mère, non sans que ses contorsions autour du vide corporel aient été stoppées net par l’accident. La trajectoire du regard, signifiant autant qu’objet réel, trouvera son ultime point d’impact dans le scandale soulevé par sa fille Eva une fois devenue adulte, après avoir fui, adolescente, le délire maternel.
[1] Ionesco Irina, L’oeil de la poupée, Paris, Editions des femmes, 2004.
[2] Ibid., p.13
[3] Lacan J., « Remarques sur le rapport de Daniel Lagache », Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p.676 : « Il est des techniques du corps où le sujet tente d’éveiller en sa conscience une configuration de cette obscure intimité ».
[4] Ibid., p.112
[5] Ibid., p.121
[6] Ibid., p.138
[7] Ibid., p.170