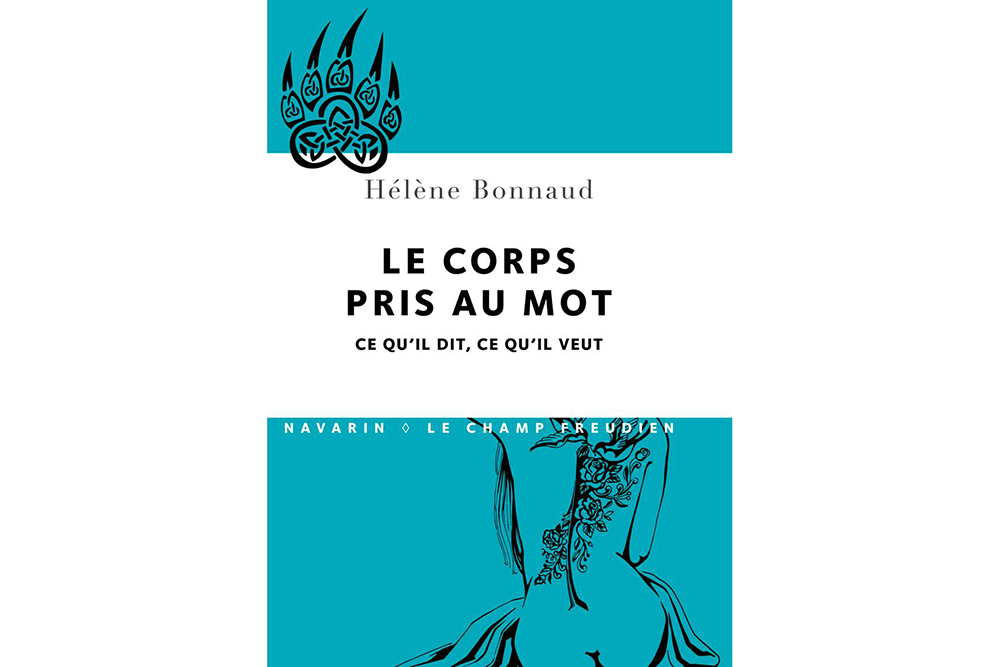En juin dernier, s’est donné aux Ateliers Berthier Liliom, de Ferenc Molnár, dans une mise en scène de Jean Bellorini, directeur du TGP[1] de Saint-Denis. Réussite théâtrale exceptionnelle qui mérite de retenir à bien des égards l’attention, des amoureux de Lacan en particulier : théâtre vivant au plus haut point, en prise sur le réel de la banlieue d’une grande ville, ici Budapest ; c’est par cette « légende de banlieue en sept tableaux »[2] qu’en 2014 J. Bellorini a choisi génialement de démarrer son mandat de directeur à Saint-Denis.
Écrite en hongrois en 1909, la pièce[3] fut retraduite en 2004 par le travail remarquable de trois jeunes gens de théâtre qui ont « essayé de reconstituer l’étrangeté fondamentale de la langue de Molnár, son agrammaticalité de principe ». Et la note de ces traducteurs de préciser : « Plus qu’un argot, la langue que parlent les personnages […] est bourrée de fautes de grammaire, d’aberrations syntaxiques ou de mots déformés, souvent restitués de manière phonétique. […] Il nous fallait donc retrouver un « mal parler » que l’on puisse quand même parler ; et cela dans une langue française rigide, à la grammaire beaucoup moins flexible que celle du hongrois »[4].
La traduction est toujours une affaire de première importance, mais elle l’est singulièrement dans Liliom (ou la vie et la mort d’un vaurien), qui est, selon les mots heureux des traducteurs, une « tragédie du langage », et même une double tragédie du langage : car derrière les difficultés langagières de ces personnages populaires qui évoluent dans une fête foraine de banlieue, sans pouvoir presque rien se dire, s’entend le traumatisme fondamental de l’être parlant, que Lacan nous a appris à reconnaître. Mais ce terme de tragédie ne doit pas ici tromper : J. Bellorini revendique de traiter Liliom sur « le mode de la varietà, avec des passages incessants du rire aux larmes »[5]. Ce à quoi il réussit, donnant une lecture de la pièce qui fait de Molnár ce poète que Socrate appelait de ses vœux à la fin du Banquet[6], en amenant Aristophane et Agathon à reconnaître qu’il appartient au même homme d’être à la fois poète tragique et poète comique.
Liliom est une fable qui raconte l’histoire d’un bonimenteur de foire, d’un pauvre gars qui travaille sur un manège à la périphérie de la ville, et se donne l’allure d’un voyou. La brutalité de la patronne du manège rapproche une petite bonne, nommée Julie, de Liliom ; ils tombent progressivement amoureux l’un de l’autre au cours du premier tableau, au travers d’un échange verbal où, à la rudesse triviale de Liliom, répond chez Julie un vouvoiement respectueux et une naïveté qui frise parfois le mutisme. Les mots leur manquent, le dialogue est entrecoupé de silences, mais dans le peu qui parvient à se dire finissent par percer une forme de tendresse généreuse chez lui et une pudeur extraordinaire chez elle, qui trouvent leur achèvement dans un grand silence.
Dans le deuxième tableau, on apprend que le chômage, la misère et les coups sont le réel de la vie de Julie et Liliom : pourtant le couple résiste malgré la violence du quotidien ; aucun des deux ne peut envisager de quitter l’autre, un fond de tendresse perdure des deux côtés, même s’il affleure différemment chez chacun, et n’exclut pas une dysharmonie foncière. La nouvelle de l’enfant qui s’annonce est accueillie avec une fierté joyeuse, mais l’émotion peine à s’exprimer, et elle explose chez Liliom en une sorte d’excitation qui le conduira à sa chute.
Pour financer le départ en Amérique dont il rêve pour sa future famille, Liliom se laisse entraîner, plutôt à contre cœur, dans un braquage manigancé par un copain, qui tourne mal au quatrième tableau : pour échapper au revolver de l’homme qu’ils devaient attaquer, au gendarme armé qui surgit, et à la perspective de la prison, Liliom plonge dans sa poitrine le grand couteau qu’il avait fini par accepter de cacher sur lui. Entre deux sanglots, il crie le nom de Julie.
Liliom meurt au cinquième tableau, en demandant à Julie de lui tenir la main, tout en refusant de lui dire pardon, ce que d’ailleurs elle n’a pas l’idée de réclamer : cette scène se déroule sans le moindre pathos, sans pleurs, avec peu de mots, mais, là, le manque de mots rejoint l’économie d’un bien dire.
Deux « détectives de Dieu » viennent réveiller le forain mort pour le conduire dans l’au-delà, où il est censé rendre des comptes, dans un commissariat qui est le lieu du Jugement Dernier : au sixième tableau, le juge céleste est un policier chargé de rédiger des rapports, que le metteur en scène a juché très haut sur la grande roue d’une fête foraine, prenant à la lettre le vœu de l’auteur : « En ce qui concerne […] les personnages surnaturels […], je ne voulais pas leur attribuer plus de signification qu’un modeste vagabond ne leur en donne quand il pense à eux »[7]. J. Bellorini y ajoute un humour iconoclaste.
Après seize années de purgatoire, quand sa fille sera devenue grande, Liliom sera autorisé à redescendre sur terre, pour une journée, et aura à inventer quelque chose de vraiment beau pour son enfant. Au septième tableau, a lieu la rencontre, irréductible occasion de malentendus : Louise, la fille de Liliom, le prend pour un mendiant et refuse le cadeau qu’il a volé pour elle ; alors, il ne peut le supporter, et la frappe. Elle ne sent rien, comme si, dit-elle, on l’avait embrassée : la voix de Julie-Louise est enregistrée. La pièce s’achève sur un mode énigmatique, avec le départ de Liliom, et un semblant de dialogue – on entend seulement la voix de Julie-Louise – entre la fille et la mère, qui donne le nom du père de Louise, sans qu’on sache si elle a reconnu Liliom, ou s’en souvient.
La pénurie des mots n’a pas la même place pour les différents personnages, et chacun y répond d’une manière singulière. Deux couples sont mis en regard dans la pièce, celui que l’amie de Julie forme de manière très convenue avec son époux, dont les propos sont entièrement stéréotypés, et celui de Liliom et de Julie, dont le lien réside dans ce qu’ils n’arrivent pas à exprimer, et dans leurs silences qui ponctuent poétiquement l’ensemble. La musique, dont l’importance s’atteste dans les didascalies, et qui joue un rôle essentiel dans le travail de J. Bellorini, se fait entendre là où les mots défaillent.
[1] Théâtre Gérard Philippe
[2] Sous-titre de la pièce.
[3] Molnár F., Liliom (Ou la vie et la mort d’un vaurien), Traduit par K. Ràdy, A. Moati et S. Vouyoucas, Éd. Théâtrales, 2004.
[4] Ibid., « À propos de la traduction », p.89.
[5] Programme de l’Odéon (35), « Communion éphémère », Entretien avec J. Bellorini, Propos recueillis par Marion Canelas, septembre 2014.
[6] Platon, Le banquet, traduction Chambry, 223c-d, Garnier-Flammarion, p.96.
[7] Molnár F., Liliom, op. cit., « À propos de la traduction », p.85.