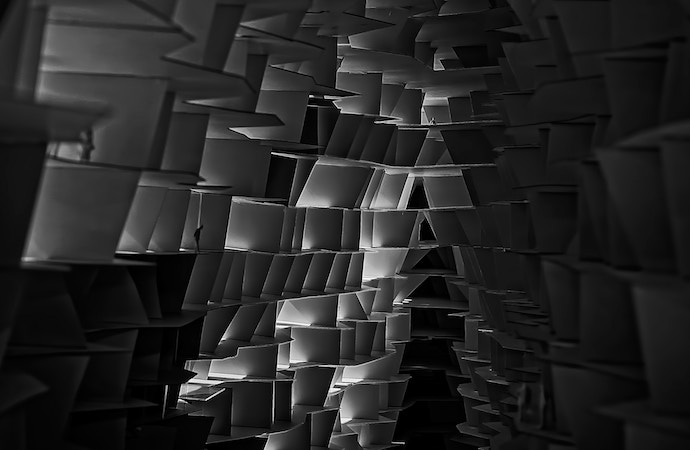« Si une civilisation qui est celle où nous vivons, a vu fleurir l’idéal, la confusion idéale, de l’amour et du conjugo, c’est pour autant qu’elle a mis au premier plan le mariage comme fruit symbolique du consentement mutuel, c’est-à-dire à pousser si loin la liberté des unions qu’elle est toujours confinant à l’inceste. » [1]
Philippe De Georges : Mais nom de Dieu ! Qu’est-ce que c’est, cette histoire ? Nous voici, Alain Merlet et moi, enrôlés pour un Duetto. Soit une petite pièce pour deux voix. Duetto n’est pas duo. Nous n’allons pas chanter à l’unisson, mais jouer chacun notre partie pour dire comment résonne pour nous une petite citation de Lacan [2].
Ce Duetto consonne avec le thème de nos journées, qui est une histoire de mariage, soit d’alliance ou de conjugo. Le titre de notre séquence est « La bague au doigt ». Les cas présentés par nos collègues traiteront de cet usage, fait pour symboliser l’alliance. Freud avait offert à ses plus proches un petit anneau de métal qui représentait le lien entre lui et ceux de son petit comité secret. Quant à la bague au doigt, c’est la formule qu’utilise Lacan lorsqu’une personne lui fait don des armoiries borroméennes et du nœud, dont il va faire ce que l’on sait. Quant à notre commentaire de Lacan, il a pour thème : la Liberté des unions.
Je cite Lacan, dans son Séminaire IV, La relation d’objet, le 6 mars 1957 : « Si une civilisation qui est celle où nous vivons, a vu fleurir l’idéal, la confusion idéale, de l’amour et du conjugo, c’est pour autant qu’elle a mis au premier plan le mariage comme fruit symbolique du consentement mutuel, c’est-à-dire à pousser si loin la liberté des unions qu’elle est toujours confinant à l’inceste. » [3]
Vous conviendrez que cette phrase unique est une fleur exquise du style de Lacan. Elle est longue, mais sa complexité et sa torsion relèvent d’un procédé qui lui est cher. Il donne le ton et la forme de ses affirmations les plus vives et les plus surprenantes : c’est la condensation de quelques mots et le nouage d’idées, de notions et de faits qu’on n’a pas l’habitude de rassembler. Le procédé confine au néologisme ou au mot valise. Les éléments montés ensemble comme les pierres d’un joyau mettent en valeur la coïncidence inattendue de termes qui sont précieux, chacun isolément : l’idéal, la confusion, le mariage et le conjugo, l’amour et le consentement, l’union et la liberté, puis le dernier et non des moindres, mot-clé de la doctrine analytique : l’inceste, qui vient briller à l’horizon.
Jacques-Alain Miller nous a appris qu’on ne peut tirer partie d’une phrase aussi riche qu’en la situant dans son contexte. De quoi s’agit-il ? D’un moment d’un Séminaire où Lacan traite d’un sujet qui tient le haut du pavé dans la communauté analytique française de l’époque : la relation d’objet. L’auteur qui porte celle-ci est un de ses collègues, Bouvet. L’idéologie en question est une lecture postfreudienne qui promeut l’autonomie possible du moi dans une perspective a-conflictuelle. Les sujets sont supposés pouvoir atteindre dans la cure une relation apaisée à leur pulsion et une harmonie dans leur couple comme dans la vie sociale, sur le fond d’une adéquation maturative. La leçon où se trouve cette phrase est nommée par J.-A. Miller « Le complexe d’Œdipe ». Le cas du petit Hans et son commentaire par Freud sont la base de cette réflexion. L’Œdipe est la structure qui établit une normativation du désir par l’intégration des interdits fondamentaux, l’assomption par le sujet des idéaux de son sexe et les identifications correctes. C’est aussi la forme épique d’un drame familial où les protagonistes incarnent respectivement objets d’amour et d’identification, et le jeu de rôle par lequel se vit ce que Freud appelle le complexe de castration. Freud nous offre sous le nom de ce complexe le récit d’un processus par lequel l’enfant surmonte ses conflits archaïques, met en place le choix de ses objets futurs et assure sa position au regard de la jouissance et de ses partenaires. Le nœud de cette affaire concerne donc aussi bien le sexe, le désir et l’amour et implique tout autant le sujet dans ses orientations, que les exigences de la société dans laquelle il est appelé à vivre.
Lacan a présent à l’esprit ce qui résonne si fort chez Freud, à savoir que la relation primitive à la mère colore indéfectiblement le choix amoureux du petit d’homme comme de l’adulte qu’il sera, et que cet attachement n’est en même temps vivable qu’au prix d’une séparation. Bien avant la psychanalyse, des auteurs remarquables ont réfléchi à ces questions et se sont demandés comment pouvaient s’articuler le désir, le mariage et l’amour. La question sous-jacente est celle de la compatibilité ou non de l’attrait personnel, et d’une institution sociale aussi lourde de conséquence que ce que nous appelons mariage. Montaigne avait sur le sujet un avis qui souvent étonne ou dérange : il lui paraissait impossible de faire place dans le mariage, qui est une affaire sérieuse dont dépend la transmission de la vie, des valeurs et des biens, à la passion amoureuse et aux élans subversifs du désir. Il ne faisait ainsi qu’exprimer ce qui est au fondement de la plupart des pratiques et des mœurs en matière d’union conjugale, car Éros est un Dieu noir qu’il vaut mieux ne pas mêler aux ressorts de l’alliance. D’où la pratique universelle des unions arrangées, par les familles, clans, castes et tribus, chefs, patriarches, pères et prêtres, mères, maquerelles et marieuses. Lacan note ainsi qu’à l’exception de notre culture tardive, la plupart ont voulu établir ou garantir la disjonction de l’amour et du conjugo.
Avec le contexte du Séminaire de Lacan, il faut interroger aussi l’intertexte explicite de ce chapitre : la recherche de Claude Lévi-Strauss d’une part, sur Les Structures élémentaires de la parenté, aussi bien que Denis de Rougemont, et son magistral ouvrage, L’amour et l’Occident. Le premier nous permet en effet de comprendre la logique des alliances telle que l’enseigne l’observation des peuples dits primitifs, avec le jeu de ce qui est proscrit et ce qui est prescrit ; et le second nous renseigne sur la civilisation où nous vivons, qui a vu l’Église inventer une règle du mariage qui se fonde explicitement sur ce que toutes les autres écartent : le choix libre des sujets et leur consentement mutuel. Lacan est explicite : à chacun sa chacune ne renvoie qu’à une harmonie imaginaire, car on ne saurait s’abstraire (sauf Roméo et Juliette ou Tristan et Iseult qui le font au prix de la mort) de l’avis impératif de la communauté. La conjonction du choix individuel à l’intérieur de la loi, de l’amour et de la loi « participe de l’inceste ».
En effet, les goûts amoureux ne peuvent être pensés indépendamment de la loi. Mais celle-ci revêt ici deux formes : il y a d’une part les règles du groupe, qui fixent les possibilités d’union (avec qui on peut coucher, se marier, faire des enfants), et la loi de la castration qui implique, je cite, que « toute femme qui n’est pas permise, est interdite par la loi », dans une société primitive comme dans la nôtre. Toute conjonction entre amour et mariage, et donc toute prise en compte du libre choix des sujets, introduit dans le couple légal la figure de la mère, comme objet primitif et idéal auquel l’homme reste indéfectiblement attaché. D’où ce que Lacan définit comme bigamie structurelle du mâle.
Le poids des objets primitifs – et de ce que Freud a défini comme complexe d’Œdipe – est tel, qu’introduire le choix dans le mariage mélange au lien social qu’est le conjugo les sources interdites du désir et de l’amour, péril que les règles communes de l’alliance se sont évertuées à conjurer.
« Le rapport sexuel, il n’y en a pas, mais cela ne va pas de soi. Il n’y en a pas, sauf incestueux. C’est très exactement ça qu’a avancé Freud – il n’y en a pas, sauf incestueux, ou meurtrier. Le mythe d’Œdipe désigne ceci, que la seule personne avec laquelle on ait envie de coucher, c’est sa mère, et que pour le père, on le tue. »[4]
La liberté des unions convoque donc les fantômes de l’inceste, aussi sûrement que l’amour courtois implique la transgression et la mort.
______________________
Alain Merlet : Comme souvent, Lacan propose à ses auditeurs une phrase suffisamment baroque pour qu’ils s’y cassent la tête, et qu’ainsi s’ouvre une issue à un savoir qui n’est pas d’évidence.
À mon tour, je vais risquer mon commentaire. « Tout mariage, […] porte en lui la castration » [5] est l’affirmation de Lacan qui m’a guidé dans le labyrinthe. Cette proposition universelle affirmative est évidente dans les structures élémentaires de la parenté, où la femme est objet d’échange entre les hommes selon la loi de la prohibition de l’inceste. Mais pour Lacan, elle est aussi valable dans les structures complexes et c’est ce qu’il argumente pied à pied.
Son raisonnement s’appuie sur deux propositions conditionnelles. La première se formule : si toute femme qui n’est pas permise est interdite par la loi, toute femme permise est prescrite et toute femme qui n’est pas prescrite est proscrite. S’il n’y a plus de règles du mariage, il n’y a plus de femmes prescrites, elles sont donc toutes interdites ou tout au moins aucune n’est sans être marquée par l’interdit.
La deuxième partie de la phrase concerne ce qui se passe dans notre civilisation qui laisserait croire à la possibilité d’une harmonie imaginaire dans le couple. Si l’on s’en tient à l’évolution du mariage par consentement mutuel, l’amour, qui a pris la place de la règle impérative du mariage, nous conduit à une tout autre logique que celle du permis et de l’interdit, celle du possible et de l’impossible, la liberté des unions confinant à la limite à l’inceste du fait de la confusion des registres de l’imaginaire et du symbolique. Ce que souligne Lacan : « l’idéal, la confusion idéale de l’amour et du conjugo ».
Avant Lacan, outre le débat théologique, la question du mariage n’a pas cessé d’infiltrer la littérature sur un mode épique ou comique. Pour ma part, je me limiterai au scepticisme éveillé de Montaigne, pour lequel le mariage est une contrainte nécessaire quoiqu’il soit plus doux de vivre sans corde au cou. Il y a incompatibilité entre le mariage et l’amour ainsi qu’il l’écrit : « Aussi est-ce une espèce d’inceste, d’aller employer à ce parentage vénérable et sacré, les efforts et les extravagances de la licence amoureuse. » S’il y a plaisir dans cette « religieuse liaison » qu’est le mariage, il est plat et doit être retenu au service de la génération. L’auteur des Essais s’est marié sur le tard et, tout licencieux qu’il ait été, il s’est conformé aux usages de ce contrat, car « C’est une trahison de se marier sans s’épouser ». À la construction sérieuse mais sans charme et cimentée par l’amitié de l’union permise du mariage, il oppose la poésie de l’amour comme une « agitation éveillée vive et gaie ».
L’intérêt de la lecture des Essais est de poser la question du conjugo eu égard à ce que Montaigne met déjà en jeu de la jouissance illimitée des femmes par rapport à la limitation de la jouissance masculine phallique.
Pour illustrer la réponse que les partenaires apportent à la crise de leur conjugo, compte tenu de leur mode de jouissance, je vais vous donner deux exemples.
Le premier concerne le cas d’un écrivain qui a fait de la question du mariage le thème majeur de son œuvre en quarante volumes, sans compter ceux de son épouse. Cet écrivain, Marcel Jouhandeau, célèbre en son temps avec la publication de son livre Chaminadour, est mort en 1978 à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Au départ, rien ne semblait prédestiner Marcel et Élise, sa femme, à se rencontrer, lui modeste professeur de sixième en apparence bien rangé et homosexuel, et elle une danseuse excentrique et fantasque, connue pour ses foucades amoureuses. Le hasard voulut que leurs amis communs manigancent de vouloir marier ces deux quadragénaires, si bien que leur rencontre s’effectua dans un état de pré-adoration imaginaire. Pour Marcel, le coup de foudre survient quand il entend la voix grave d’Élise et surtout lorsqu’elle exhibe un crucifix offert par son dernier amant. Ils couchent ensemble, Marcel se croit délivré de son penchant homosexuel alors qu’Élise pense l’en avoir sauvé. De fait, elle ne sera qu’une proie brûlante pour son chroniqueur de mari qui ne cessera d’en faire la matière de ses livres dans un éternel procès. Il restera bien sûr homosexuel tandis qu’Élise se tournera vers l’amour mystique. L’indissolubilité de ce mariage infernal aura eu pour fondement leur incompatibilité foncière, un « désaccord parfait » comme n’a cessé de le commenter Marcel. Il faudra la publication tardive de sa correspondance avec sa mère, qui lui écrivait tous les jours en cachette, pour s’apercevoir que dans son inconscient sa véritable épouse c’était elle et que le mariage avec Élise n’avait été qu’une barrière et un exorcisme contre la tentation de l’inceste.
Le deuxième exemple, tiré de ma pratique, est bien fait pour témoigner du temps où l’Autre n’existe pas. Ici la logique à l’œuvre est celle du contradictoire plutôt que celle du contraire, comme nous allons le voir.
Au départ, Virginia d’origine anglaise a choisi un partenaire français porteur des idéaux parentaux. Le mariage a eu lieu en France à l’église. Tout va bien jusqu’à la naissance d’un premier enfant. Le mari décompense alors sur un mode paranoïaque et devient violent envers son épouse. Elle finit par le quitter après avoir entamé une analyse où elle ne cesse de pleurer. Son mari s’opposant au divorce, la procédure est longue et elle lui abandonne tous ses biens à l’exception de sa robe de mariée qu’elle jettera à la poubelle. Dans le cours de l’analyse, elle retrouve sa joie de vivre et rencontre un nouveau partenaire avec lequel elle forme un couple sexué solide et enjoué. Elle le compare souvent à celui d’une amie mariée tristement à un sexologue se disant expert du conjugo. Récemment elle a rapporté ce rêve : Elle va se marier, elle qui se dit mariée avec le non-mariage pour préserver le vif de son couple, elle a une belle robe jaune avec une longue traîne. Ainsi parée, elle se rend seule à l’église mais en franchissant le porche, la queue de sa robe, selon ses propres termes, se détache pour ne laisser apparaître qu’une robe de cocktail. Parvenue à l’hôtel, point de mari, elle est, dit-elle, jilt, mot spécifique de sa langue maternelle pour dire larguée, délaissée. Mais au grand scandale de l’assistance, elle éclate de rire et rejoint son partenaire pour fêter ce non-mariage.
Ces deux exemples sont bien faits, me semble-t-il, pour illustrer la crise et le maniement de la castration dans l’exercice du conjugo. Pour Jouhandeau, le sacrement du mariage, exorcisme raté de son homosexualité, n’aura fait que sceller un mirage. Pour l’analysante, il y a eu émergence de tout autre chose, comme le dit si bien son rêve qui met en scène ce qui constitue le plaisir qu’elle a de vivre au quotidien un nouvel amour.
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La relation d’objet, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1994, p. 213.
[2] Duetto lors des 48e Journées de l’ECF, le 16 novembre 2018.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La relation d’objet, op. cit., p. 213.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIV, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », leçon du 15 mars 1977, Ornicar ?, n°17/18, Paris, Navarin, printemps 1979, p. 8-9.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La relation d’objet, op. cit., p. 213.