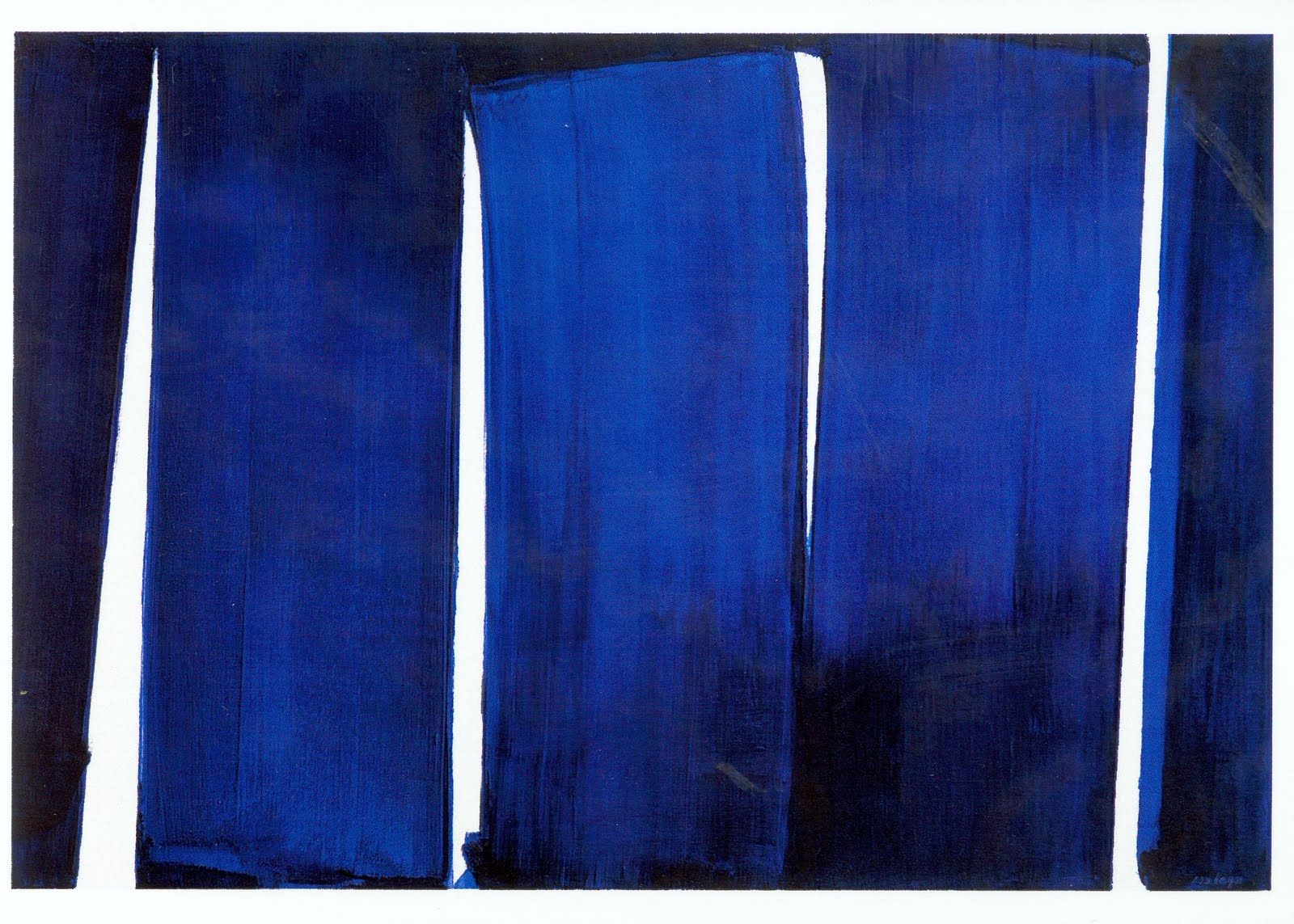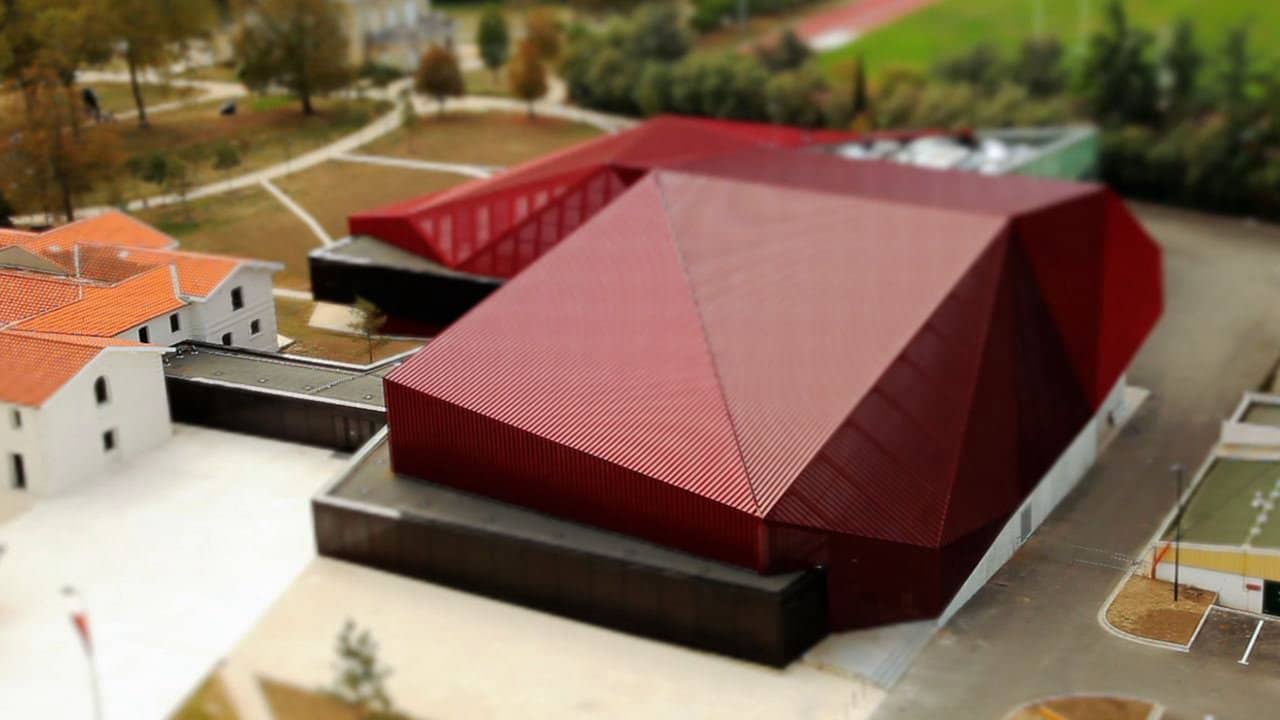Dans l’expérience analytique avec le jeune enfant, on est souvent amenés à se poser la question : Qui parle ?, à partir du moment où se constate dans cette période de la vie la fonction de partenaire porte-parole, de la personne qui est amenée à s’occuper de cet enfant : le parent.
Ce dernier est en effet appelé à parler pour faire valoir les éléments de l’existence – besoins, demandes, désirs – de l’enfant. Aussi, comme l’indique J.-A. Miller, « concernant l’enfant, on ne prend pas seulement les messages de bien-être négatif du sujet, mais également les messages de bien-être négatif, les malaises, venant des parents, venant des voisins, venant de l’école… Si, pour les adultes, on met la pédale douce, pour les enfants, on prend en compte les messages venant de l’entourage. »1
Ce constat fait apercevoir que parler, pour un sujet, relève d’abord de l’Autre : c’est d’abord l’Autre qui parle. L’énoncé « j’ai faim » par exemple, a d’abord été de l’Autre. L’Autre interprète, en effet, les cris de l’enfant avant qu’un sujet ne les assume par sa propre énonciation. Dans un premier sens, le parent est pour ainsi dire l’Autre de l’enfant, que l’analyste est amené à rencontrer.
Dans cette structure élémentaire où c’est d’abord l’Autre qui parle, c’est-à-dire qui demande, le sujet supposé est alors dans une position particulière : à la fois il lui faut une place dans cet Autre pour s’instituer comme sujet d’une énonciation possible, et en même temps, le langage étant toujours de l’Autre, il en conservera comme un sentiment d’illégitimité : on n’est pas propriétaire du langage.
Le sujet va donc osciller entre le fait de parler et d’être parlé, ce que Jacques-Alain Miller précise ainsi : « Quelque chose (…) n’a pas précipité, au sens de Lacan, dans le rapport du sujet de l’énoncé et de l’énonciation. »2
Pourtant il s’agit, dans la perspective d’une expérience analytique, de faire surgir le sujet dans l’enfant, et pour cela, on peut être amené à « interpréter les parents »3, c’est-à-dire introduire l’équivoque, le malentendu en un Autre qui parfois est asphyxiant4.
L’effet est alors double : que l’enfant assume sa propre énonciation ; que le parent soit rendu, lui aussi, à son statut de sujet, se délestant d’incarner l’Autre de l’enfant.
Les exposés cliniques que nous entendrons le samedi 12 mars sous le thème : « Les parents, partenaires de l’expérience », nous permettront d’explorer ces différents cas de figure.
1 – Miller J.-A., « Interpréter l’enfant », Interpréter l’enfant, col. La petite Girafe n°3, Paris, Navarin, 2015, p. 22.
2 – Ibid.
3 – Ibid.
4 – Miller J.-A., « L’enfant et le savoir », Peurs d’enfants, col. La petite Girafe n°1, Paris, Navarin, 2011, p. 18-19.