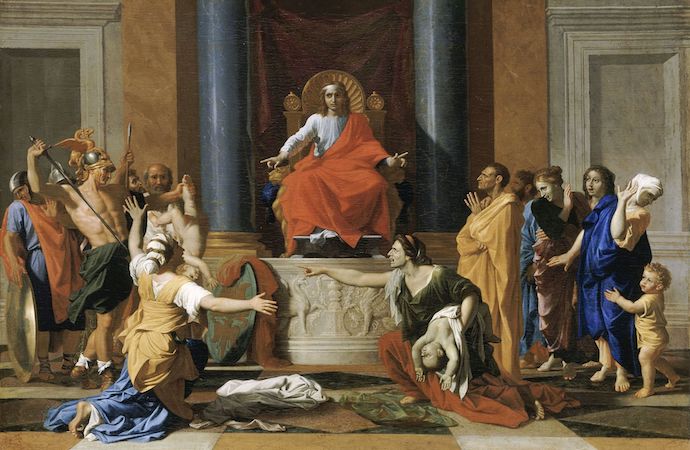Exilé de sa propre vie.
Innommable, impensable, indicible, insensé, les mots ne manquent pas pour désigner une expérience qui n’en relève pas moins du registre de l’impossible : témoigner de l’horreur et de la barbarie, traiter ce réel par la parole et enfin, y survivre. Dans ces expériences exceptionnelles, survivre au traumatisme ne se présente pas d’emblée comme un choix : au contraire, les survivants auraient bien souvent préféré la mort. Car vivre n’est pas survivre, assurément. Et ce n’est qu’au détour d’une opération, d’un traitement du réel, que survivre peut devenir un choix. Pour que, comme l’écrit Philippe Lançon, la survie vaille d’être vécue.
Les Exils : c’est sous cette formule que nous avons choisi d’orienter notre nouvelle saison de travail, parce que c’est la dure condition du parlêtre que de ne parler que d’une position d’exilé. Si le sujet ordinaire se berce de l’illusion qu’il peut en revenir, le survivant est sans doute celui qui, plus que tout autre être au monde, n’en est plus dupe.
Traiter l’énigme, « avancer dans le brouillard équivoque et sanglant » [1], « donner forme à ce qui n’a aucun sens », voilà l’impossible auquel Philippe Lançon décide de se confronter en écrivant puis en publiant Le Lambeau. Ce témoignage de 510 pages, livre de « salive et de sang », sorti en 2018 chez Gallimard et pour lequel il obtint le Prix Femina, démontre toute sa puissance littéraire. Philippe Lançon fut un des rares rescapés de la tuerie du 7 janvier 2015, survenue en pleine conférence de rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, et qui emporta dans un bain de sang les regrettés Cabu, Wolinski, Charb, Bernard Maris et leurs compères.
Philippe Lançon fut sévèrement blessé, touché au visage par un tir de Kalachnikov, une arme de guerre, qui lui troua le visage, lui détruisit la mâchoire et une bonne partie de la bouche. Il en sort défiguré et anéanti. Il restera hospitalisé de longs mois, à La Salpêtrière d’abord, qui deviendra son refuge, sa maison, et aux Invalides, ensuite, pour y poursuivre sa convalescence. Il ne subira pas moins de dix-sept interventions chirurgicales.
Le Lambeau est le récit de sa reconstruction, celle de son corps, de son visage, de sa bouche mutilée et perforée, mais aussi celle de sa subjectivité, car l’attentat fut un événement qui marque un avant et un après. Il ne sera plus jamais le même homme. Écrire fut, dès le départ de cette nouvelle vie, une absolue nécessité : écrire, puisqu’il ne pouvait plus parler, sur une ardoise Velleda, sur des cahiers, sur son ordinateur, mais aussi écrire, pour tenter de dire, de traiter, de cerner l’horreur, qu’il ne pourrait jamais qu’approcher, en se tenant au bord du gouffre, et sans jamais parvenir tout à fait à la dire.
Car le traumatisme fait l’effet d’une déflagration et produit un trou. C’est ce que Lacan souligne en parlant du troumatisme. Ce trou que produit l’effraction d’un réel est un trou dans la chaîne signifiante et donc dans la parole.
Le jour d’avant.
La veille de l’attentat contre Charlie Hebdo, Philippe Lançon est allé au théâtre voir La Nuit des rois, de Shakespeare, avec son amie Nina. Il y est allé « les mains dans les poches et le cœur léger » [2] et sans intention d’en écrire un article. Philippe Lançon est critique littéraire, mais il a d’abord été reporter. Il est devenu critique « par hasard » et l’est resté « par habitude et peut-être par insouciance » [3], écrit-il. Ecrire était son métier, à lui qui regardait parfois ses anciens articles avec l’étrangeté de celui qui en a perdu tout souvenir.
Quel est donc le rapport de l’écrit au souvenir et à l’oubli ? N’écrit-on que pour oublier ? Telles étaient ses questions avant le jour du 7 janvier 2015. « Ce que j’ignorais, c’est que l’attentat allait me faire vivre chaque minute comme si c’était la dernière : oublier le moins possible devient essentiel quand on devient brutalement étranger à ce qu’on a vécu, quand on se sent fuir de partout » [4] .
C’est par le jour d’avant que Philippe Lançon choisit de débuter son récit, en cherchant auprès de son amie Nina, « la dernière personne avec qui [il a] partagé un moment de plaisir et d’insouciance » [5], de quoi il avait été fait, pour tenter de raccrocher l’après à l’avant de cette « vie interrompue, désormais presque rêvée, et qui s’est arrêtée ce soir-là » [6]. Nina est « un souvenir vivant » et il l’interroge sur l’homme d’avant, l’homme de ce soir-là, celui du jour d’avant. « Tu étais ravi, m’a-t-elle écrit des mois plus tard, tu venais d’apprendre que tu allais partir à Princeton enseigner la littérature pour un semestre […] ». Je ne me souviens ni de cette joie, ni même de leur en avoir parlé » [7] .
Entre les deux amis, depuis l’attentat, un « pont détruit ». Leurs rencontres et leurs conversations ont bien permis aux deux rives de se rapprocher, mais, « il reste un trou au milieu » que rien ne pourra reboucher.
Dans son carnet, qu’il retrouve après la tragédie, une phrase, notée pendant la représentation de La Nuit des rois indique : « Rien de ce qui est, n’est » [8] . Cette phrase lui évoque une réplique d’Orsino dans la pièce, qui l’a saisi. Il n’en trouve pourtant nulle trace, ni dans sa mémoire, ni dans celle de Nina, ni même dans la traduction que le metteur en scène lui envoie dès le lendemain de la représentation. Rien de qu’il retrouve dans son carnet, ne lui apporte « la révélation » tant attendue.
« La réplique d’Orsino qui m’a trotté dans la tête pendant des mois, qui a bercé mes jours et mes nuits hospitalières, la phrase que j’avais sur le bout de la langue et dont la vérité m’avait saisi et comme foudroyé, cette phrase n’existe pas. » [9]
« J’ai lu et relu La Nuit des rois pour comparer mes notes au texte. Peut-être dans le noir et sous la pression, avais-je écrit de travers ? Non. Je n’ai pas trouvé la phrase que je cherchais. On aurait dit l’une de ces phrases si nettes dans un rêve, et que le réveil efface, quand il ne la rend pas banale, idiote ou incompréhensible. » [10] Le premier chapitre du livre est la découverte d’un premier trou, l’expérience d’une béance dans la mémoire et d’un dire qui échappe. Ce trou le met au travail car il a la lucidité de penser, tout branché qu’il est sur son inconscient, qu’il y a là quelque chose d’une vérité.
« Si j’ai à peu près tout oublié du spectacle, sauf certains détails qui ne sont pas sans importance, je n’ai cessé de lire et relire depuis La Nuit des rois. Je l’ai sans doute lue de la plus mauvaise façon possible, comme une énigme, pour y trouver des signes et des explications à ce qui allait arriver. Je savais que c’était stupide, ou du moins assez vain, mais cela ne m’a jamais empêché de le faire et de penser malgré tout, de sentir plutôt, qu’il y avait dans ce concours de circonstances quelque chose de plus vrai que dans le constat de son incohérence. Shakespeare est toujours un excellent guide lorsqu’il s’agit d’avancer dans le brouillard équivoque et sanglant. Il donne forme à ce qui n’a aucun sens et, ce faisant, donne sens à ce qui a été subi, vécu » [11] .
Le jour où « tout l’ordinaire a disparu »
Dès lors, il n’aura de cesse de tenter de reconstruire l’avant, jour après jour, heure après heure, minute après minute, jusqu’à ce qu’ « un bruit sec, comme de pétard, et les premiers cris dans l’entrée » interrompent définitivement, et tranchent, comme d’un coup de ciseau, le fil de sa vie. « Et tout l’ordinaire a disparu » [12] .
Le 7 janvier, Philippe Lançon hésite à aller directement à Libération, son journal, pour lequel il veut écrire sur La Nuit des rois ou passer par Charlie où se tient la conférence de rédaction. Il va à Charlie, découvre la une : « Les prédictions du mage Houellebecq : en 2015, je perds mes dents… En 2022, je fais ramadan ! » Précisons que le 7 janvier est la date officielle de la sortie du roman Soumission, dont Philippe Lançon a écrit une chronique dans Libération. L’ouvrage et les propos de son auteur font alors polémique. On l’accuse de croire un peu trop au futur proche qu’il décrit dans sa fiction, d’une France aux mains d’un président musulman. Lançon et son ami Bernard Maris, (il a écrit le formidable Houellebecq économiste) défendent l’auteur avec conviction. En face, leurs camarades le trouvent réac. Les échanges sont vifs, les gens râlent, s’engueulent (on est à Charlie), Lançon est de mauvaise humeur (aucun de ses détracteurs n’a lu le roman). Tout y passe, les musulmans, les banlieues, la politique. Bref, c’est un débat d’idées, du genre de ceux qu’on tient entre gens libres.
A 11h25, Philippe Lançon enfile son caban pour partir vers Libération, mais il s’arrête pour montrer à Cabu, cet amateur de jazz, une photo d’Elvin Jones en 64, tirée de son livre sur le label Blue Note. Cabu connait le livre qu’ils feuillettent ensemble. Bernard Maris approche et propose à Philippe Lançon de faire une chronique du dernier Houellebecq pour Charlie. Philippe Lançon refuse, il n’est pas question qu’il fasse une « resucée » de ce qu’il a déjà écrit dans Libé. Charb insiste : « S’il te plaît, fais-nous une resucée… » [13] C’est à ce moment précis que le monde va basculer en laissant la mort faire irruption et tout emporter sur son passage.
Le récit de l’attentat est bouleversant, quarante et une pages sidérantes de l’horreur en train d’advenir. Philippe Lançon comprend sans comprendre, s’accroupit puis s’allonge à terre et fait le mort. Il entend les « Allah Akbar », les détonations sourdes. Deux jambes noires le frôlent et l’enjambent. Deux êtres cohabitent alors encore quelques instants après le massacre : celui qui était déjà mort et « celui qui allait devoir vivre » [14] . « Celui que je devenais a voulu pleurer, mais celui qui n’était pas tout à fait mort l’en a empêché »[15] . Ou encore : « je ne pouvais déjà plus tout à fait comprendre celui que j’avais été, mais je ne le savais pas. Je l’écoutais parler et je pensais : mais qu’est-ce qu’il dit ? » [16]
« Et tout est devenu silencieux. La paix est descendue sur la petite pièce, chassant peu à peu la menace d’une prolongation ou d’un retour des tueurs. Je ne bougeais plus, je respirais à peine. La brume se levait. Je ne sentais rien, ne voyais rien, n’entendais rien. Le silence fabriquait le temps et parmi les blessés et les morts, les premières formes de la survie » [17].
Il est blessé mais il ne le sait pas, il ne le sent pas, il ne souffre pas. Il ne sait pas encore qu’il n’a plus de bouche, plus de menton. Ces sensations qui ne parviennent pas à sa conscience convoquent pourtant des sensations du passé. Les dix-sept dents qu’il perd alors tintent dans sa bouche comme des osselets qui le propulsent en enfance. Il aperçoit un bras, ouvert, comme au couteau et la chair sanguinolente. Il ne sait pas que c’est le sien. Il attrape son téléphone et c’est sur l’écran qu’il aperçoit son reflet et le trou béant que son visage est devenu. Les secours arrivent et il entend crier « là, mort, là, mort, là, mort » en désignant une à une toutes les victimes au sol. Embarqué par des hommes vers la sortie, l’un d’eux, hurle à son propos : « ça, c’est blessure de guerre ! » .
L’instant d’après
Philippe Lançon se réveille à l’hôpital mais ne le comprend pas de suite. Une odeur de café parvient à ses narines, alléchante, jusqu’à ce qu’il réalise qu’il n’a pas mis en route sa cafetière puisqu’il dort. Il vient de subir une intervention qui a duré sept heures. Couvert de pansements, de bandages, de tuyaux, il est faible et ne peut pas parler. « Mon ancien corps s’en allait pour laisser place à un encombrement de sensations précises, désagréables et inédites, mais assez bien élevées pour n’entrer que sur la pointe des pieds » [18] . Son frère est là, abasourdi de chagrin mais heureux de le trouver vivant. Lui, se demande pourquoi il n’est pas mort. Il saisit la tablette Velleda et y écrit avec peine, en majuscules « c’est foutu avec Gabriela ». C’est un homme nouveau que cet acte d’écriture fait surgir : « athlète en chambre » et « dandy », autant de nominations qui le décollent du « je suis la souffrance » de ce tas d’os brisés et de chair sanguinolente.
« C’est foutu avec Gabriela. […] Je l’ai écrite pour me soulager du chagrin que je pressentais : écrire c’était protester, mais c’était aussi, déjà, accepter. […] Je me trouvais dans une position où le dandysme devenait une vertu. »
Contraint au mutisme, privé de parole, il accepte cette nouvelle condition sans protester, comme un châtiment mérité, comme une épreuve à endurer et comme s’il en avait toujours été ainsi. « Quelque chose te punit d’avoir tant parlé, tant écrit pour rien. Quelque chose te punit de tes bavardages » [19] . Ce silence imposé dure plusieurs mois. D’abord impossible, la parole lui sera ensuite interdite à des fins de cicatrisation. Il fait, de ce vœu de silence, son affaire, en expérimentant un nouveau rapport à la parole, et aux autres. Pas de blabla et n’en passer que par l’écrit pour s’adresser ou répondre à l’autre. C’est ce qu’il appelle « le journalisme à l’envers » (le journaliste interroge oralement et prend en note la réponse). Cette contingence permet qu’un traitement opère, sur le mode de la restriction, avec le silence, puis de la soustraction, avec l’écriture.
Ses premiers mots (écrits donc, de la salle de réveil) sont des vers. Il s’agit « d’appliquer son talent résiduel aux circonstances ».
« J’ai touché
Bras et visage Parmi
Les morts et
compris
Adieu Princeton ! »
Un autre poème, qu’il rédige en espagnol et traduit pour l’occasion : « comme un rêve qu’on note en demi-sommeil, le croyant déterminant, et qui au réveil, apparaît pour ce qui est : la trace médiocre et incompréhensible d’une émotion vitale, mais enterrée ; le hiéroglyphe d’une personnalité disparue » [20].
« La folle habitude d’écrire reprend ses droits et s’impose au corps blessé » [21] . Mutilé, démantibulé, dépossédé de sa lèvre inférieure, son corps n’est que blessure, il fuit. Il est une gueule cassée, et qui bave. Sa bouche silencieuse est devenue béance, un immense trou qui ne fait plus bord, qui saigne et bave.
« Le tueur a blessé l’homme mais il a raté le témoin » [22] . Il est d’emblée pris par la nécessité de trouver « le sens d’une expérience [qu’il n’a] pas encore assimilée, ni même, à vrai dire, vécue » [23] . « C’était comme un rêve » [24] , voici les premiers mots qu’il dira au sujet de l’attentat.
« Si écrire consiste à imaginer tout ce qui manque, à substituer au vide un certain ordre, je n’écris pas : comment pourrais-je créer la moindre fiction alors que j’ai moi-même été avalé par une fiction ? Comment bâtir un ordre quelconque sur de telles ruines ? » [25]
Lors de sa première nuit à l’hôpital, il fait un rêve, des gitans célèbrent la fête de la pastèque. Ce rêve convoque un souvenir d’enfance [26]. Sur un marché d’Espagne, il a sept ans, et il porte dans ses bras une énorme pastèque, comme on porterait un précieux ballon, dit-il. La pastèque lui échappe et elle explose à ses pieds : le liquide rouge et les pépins se répandent sur le sol en une épouvantable flaque. Il se souvient d’avoir pleuré et d’en être resté inconsolable, d’autant plus que les gens riaient autour de lui. La tentation est grande pour l’auteur d’y voir la préfiguration de l’horreur du 7 janvier. D’une autre manière, l’émergence de ce souvenir fait de lui cet enfant de sept ans épouvanté par l’horreur qui le saisit, alors même qu’il est l’objet du rire des passants.
Ce souvenir (-écran) est l’occasion de saisir, ainsi que nous invite Jacques-Alain Miller, que « l’événement lacanien au sens du trauma, celui qui laisse des traces pour chacun, c’est le non-rapport sexuel » [27]. Car ce souvenir nous montre, que si rapport il y a, c’est bien entre le sujet et son objet, et entre le sujet et ses trous.
La chambre : « le lieu où l’expérience [est] vivable » [28]
La chambre 106 devient sa maison, son cocon. Il y éprouve « presque un certain bonheur » [29], car à cet endroit, « le sens du combat s’était simplifié ». « Ce bonheur était le bonheur fragile d’un petit roi impuissant, immobile et improvisé, mais d’un roi malgré tout, enfin livré à lui-même et à ses ressources, sans distractions ni rencontres inutiles, avec pour seul accompagnement, outre l’équipe soignante, la famille et quelques amis, des livres, un ordinateur et de la musique ; le bonheur d’un roi qui ne rendait compte, finalement, qu’à un seul dieu, son chirurgien, et à un seul Saint-Esprit, sa santé. C’était presque le bonheur du capitaine Nemo dans le Nautilus, mais un bonheur sans amertume, sans colère. Mon chagrin était compatissant envers mes hôtes et je n’avais aucun compte à régler avec le genre humain. » [30]
La présence continue des soignants et des policiers qui montent la garde à la porte de sa chambre lui impose une certaine tenue. A devoir vivre sous leur regard, il s’imagine tel le jeune roi du film de Rosselini sur Louis XIV.
Il noue un lien avec chaque soignant, en dresse le portrait tout en en découvrant l’histoire ou la blessure singulière de chacun. La rencontre opère et c’est lui qui l’initie, partageant avec les uns et les autres la musique de Bach, ou quelques vers d’un poème, un film. Quelques amis et son frère se relaient pour dormir dans sa chambre, près de lui chaque nuit.
Parmi ses compagnons du quotidien, Proust, Kafka, Thomas Mann et leurs personnages qu’il connaît intimement. Il se tourne vers les passages qui traitent de la médecine et de la maladie. A chaque descente au bloc, il relit la mort de la grand-mère de la Recherche. « À défaut de trouver des mots suffisamment vierges et fluides, je relisais sans cesse ceux des autres, toujours les mêmes, Proust, Mann, et plus encore Kafka » [31] . Les Lettres à Milena qu’une amie lui offre un jour, alors qu’il est au bloc et qu’il trouve à son retour, deviennent le « talisman » qui ne l’a dès lors plus quitté.
« Ces phrases me servaient depuis lors de bréviaire […] Je les aurais lues sur le billard » (la « magnificence de l’enfer » selon Kafka)
Bientôt, il fera de sa chambre d’hôpital une scène de théâtre sur laquelle se joue la pièce de son propre drame. Ceux qui y pénètrent deviennent ses personnages. Parmi ces personnages, l’un d’eux occupe une place de choix et leur relation relève du transfert. Chloé, sa chirurgienne est celle dont il se plait à dépendre et dont il devient « le chroniqueur en chambre » [32] . Il lui adresse ses craintes et ses pensées, tandis que ses réponses font parfois interprétation. « Elle était la fée imparfaite qui, penchée sur mon berceau, m’avait donné une seconde vie. Cette seconde vie m’obligeait » [33] . « La chirurgie est un livre qui n’en finit pas » [34] .
Les journées se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait, entre les pansements, les soins quotidiens, assurés par les infirmières, les aides-soignants, les descentes au bloc. Suspendu aux avis des uns, des autres, il apprend à nommer précisément les endroits touchés de son corps, mais aussi les techniques et les outils de sa prise en charge. Il devient un spécialiste de son propre cas, se métamorphose en reporter de lui-même, en metteur en scène de sa propre histoire. Devenir le chroniqueur de sa reconstruction lui permet de sortir de son rôle de patient. Son corps et son visage sont un champ de douleur, et écrire lui permet d’échapper à sa « condition ». Approcher le réel de son corps, dans le récit qu’il en fait, met à l’épreuve la vérité, pour en faire une fiction : « tout était fiction puisque tout était récit » [35] . Sept jours après l’attentat, Philippe Lançon écrit un article dans Libération dans lequel il donne de ses nouvelles, dans un récit à la première personne, une première en trente ans de métier. Cet article s’est écrit tout seul, indique-t-il, « comme un rêve ».
« Après plus d’un mois d’interruption, Charlie venait de reparaître […] Sur quoi pouvais-je bien écrire dans cette chambre, sinon sur mon voyage autour de la chambre ? […] reporteur et chroniqueur d’une reconstruction »
Réécrire un bord au trou : le lambeau
Ecrire est aussi bien une affaire de corps : bouger la main, le bras, les doigts, ces gestes si ordinaires ne le sont plus pour celui dont le bas du visage s’électrifie, tandis qu’une « fourmilière » s’y installe et fait surgir une infinité de « démangeaisons souterraines qui auraient mérité d’avoir leur propre nom ». Voilà l’inconfort et l’inextricable de sa nouvelle et douloureuse condition, être pris entre la nécessité de dire et d’écrire ce qui n’a pas de nom, et l’impossibilité de le faire, pour se soulager un tant soit peu.
« Je n’existais plus que comme un corps qui n’était pas tout à fait le mien, dans une vie qui n’était plus tout à fait la mienne, et dont la conscience accueillait sans morale, sans résistance, tout ce qui se présentait. Je n’avais pas été un bien grand journaliste, sans doute par manque d’audace, de ténacité et de passion pour l’actualité, mais peut-être étais-je en train de devenir, ici, une sorte de livre ouvert : aux autres, et pour les autres. Je n’avais rien à refuser et rien à cacher. » [36]
Le lambeau est le nom qu’il se donne à un moment pour désigner son corps, « en lambeaux », mais c’est aussi le nom de l’opération par laquelle la chirurgie, et son incarnation, sa chirurgienne, reconstruira sa bouche détruite et rebouchera le trou béant. C’est enfin le nom de la solution singulière qui fera de son témoignage une œuvre littéraire en rebouchant le trou produit dans la chaîne signifiante. Ces deux opérations sont aussi imparfaites l’une que l’autre, mais elles constituent des bricolages qui démontrent une certaine efficacité.
Ecrire lui permet de traiter dans le symbolique cette « sensation de n’être plus qu’un corps » [37] , « cet amas de chair couvert de tuyaux et de plaies qu’on appelait Monsieur Lançon » [38], ce « morvif » [39] , terme emprunté à la novlangue de George Orwell dans 1984. L’écriture opère comme des greffes de symbolique, de langage sur le trou du réel comme l’indiquait Sonia Chiriaco lors de sa conférence à Lille du 12 janvier 2019 sur l’indicible [40]. Ecrire est aussi l’alternative à la parole, car parler menace la cicatrisation. Retrouver la voix progressivement, l’usage de la parole, n’est pas simple et sa propre voix lui paraît étrangère.
Pour conclure
Le Lambeau est bel et bien un témoignage inédit et une œuvre littéraire hors-normes. Mais qui en est le véritable auteur ? « L’homme qui triait les souvenirs comme si un siècle le séparait de la minute précédente, était-ce celui qui était déjà presque mort, ou celui qui commençait à le remplacer ? Je ne savais pas lequel des deux vivait et je ne sais pas lequel des deux écrit. » [41]
Comme l’indique Serge Cottet, dans un article intitulé « Freud et l’actualité du trauma », il s’agit de traiter ce reste de jouissance, le soustraire au sens inconscient, le réinvestir dans une œuvre. « Une fiction vient donner vie à ce réel impossible à supporter. Cela n’est certes pas un paradigme, mais une orientation qui, avec d’autres écritures de l’horreur, restitue un sujet, là où il n’y avait, jusque-là, que mortification et inertie. » [42]
Le 13 novembre 2015, c’est à New York qu’il apprend l’attentat du Bataclan. Il indique : « et j’ai senti que tout recommençait, ou plus exactement continuait, en moi et autour de moi, parallèlement à tout ce qui sous mes yeux défilait » [43] .
[1] Lançon, P., Le Lambeau, Gallimard, Paris, 2018, p. 20.
[2] Ibid., p. 11
[3] Ibid., p. 12
[4] Ibid., p. 27
[5] Ibid., p. 13
[6] Ibid., p. 13
[7] Ibid., p. 16
[8] Ibid., p. 12
[9] Ibid., p. 25
[10] Ibid., pp. 24-25
[11] Ibid., p. 20.
[12] Ibid., p. 74.
[13] Ibid., p. 74.
[14] Ibid., p. 91.
[15] Ibid., p. 87.
[16] Ibid., p. 84.
[17] Ibid., p. 80.
[18] Ibid., p. 119.
[19] Ibid., p. 163.
[20] Ibid., p. 170.
[21] Ibid., p. 128.
[22] Ibid., p. 126.
[23] Ibid., p. 124.
[24] Ibid., p. 125.
[25] Ibid., p. 93.
[26] Ibid., p. 141.
[27] Miller J.-A., « Biologie lacanienne et évènement de corps », La Cause freudienne n°44, Paris, Navarin/Seuil, 2000, p. 39.
[28] Ibid., p. 343.
[29] Ibid., p. 133.
[30] Ibid., pp. 133-134.
[31] Ibid., p. 383.
[32] Ibid., p. 241.
[33] Ibid., p. 227.
[34] Ibid., p. 231.
[35] Ibid., p. 365.
[36] Ibid., p. 374.
[37] Ibid., p. 332.
[38] Ibid., p. 333.
[39] Ibid., p. 135.
[40] Un extrait en a été publié ici : https://www.hebdo-blog.fr/de-lindicible/
[41] Ibid., p. 95.
[42] Cottet S., « Freud et l’actualité du trauma », La Cause Du Désir, Paris, Navarin, vol. 86, no. 1, 2014, pp. 27-33.
[43] Lançon, P., Le Lambeau, op. cit., p. 509.