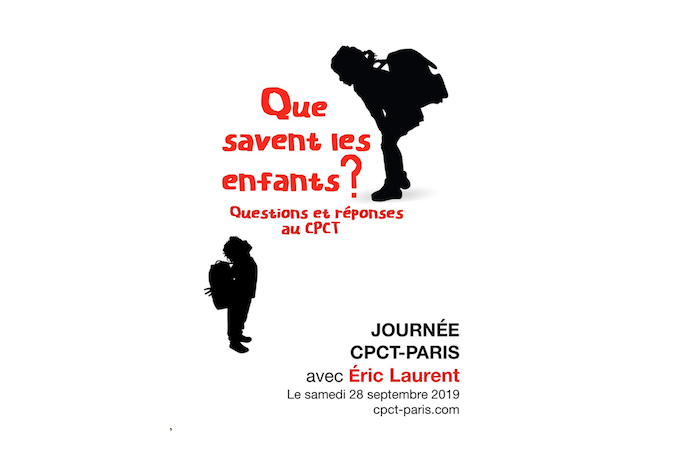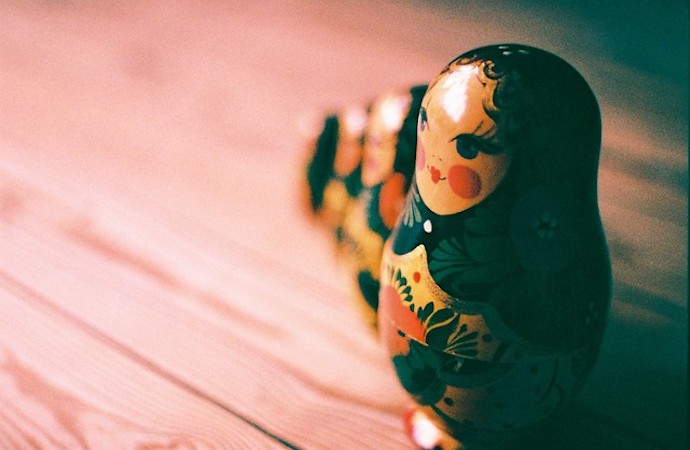« Que savent les enfants ? », nous interroge le CPCT. L’enfant saurait donc quelque chose, que nous ignorons, dont nous voulons nous enseigner ? C’est en effet l’hypothèse de la psychanalyse, que de situer le savoir du côté du sujet, logé en lui sous la forme de son symptôme, de ses rêves… Pourtant, lorsque l’enfant arrive devant nous, c’est d’abord bardé d’un discours qui prétend savoir quelque chose de lui : son école, ses parents, l’affublent de tel ou tel nom d’oiseau, « dys… », TDA-H, précoce, etc. On sait semble-t-il comment un enfant doit fonctionner, à quelle norme il doit correspondre, mais celui-ci excède la case, ça ne va pas. On fait alors appel au spécialiste, pour rectifier le défaut.
Ce défaut, c’est son savoir, à l’enfant. Son savoir que cette norme, ce rôle d’enfant qu’on lui attribue, n’est qu’un savoir fantoche auquel veulent croire les grandes personnes et sous lequel circule leur jouissance dont ils font de l’enfant le support.
Par exemple, une jeune femme se plaint d’avoir toujours eu comme une « débilité », un empêchement à savoir qui ne l’a pourtant pas empêchée de réussir ses études. Mais non, elle ne sait pas, ne comprend jamais rien. Et puis, elle ne sait même pas quoi dire, elle n’a rien à dire. Déjà enfant, lorsqu’on lui demandait son avis, elle restait coite. Pas d’idée, un vide. Elle découvre que cette « débilité » qui la rend muette, est la forme que prend sa réponse au malentendu dans le couple parental : l’une veut un partenaire pour parler toute seule, l’autre veut qu’on lui demande pour se dérober. Leur fille, qui s’analyse, démontre donc par sa « débilité » le savoir précis qu’elle détient sur l’affaire, mais y perd au passage la parole, car sa réponse prétend obturer, par un « rien », la béance du rapport sexuel qu’il n’y a pas – or sans cette béance, nulle parole possible.
En effet, pour l’enfant, il y a deux versants à la rencontre de l’analyste : repérer en quoi il fait symptôme pour l’Autre, « réponse du réel [1] » à la jouissance de l’Autre qu’il polarise en tant qu’il est toujours quelque peu en place d’objet. Mais gare ! Car ce versant-là pourrait nous pousser à vouloir rectifier l’Autre pour en dégager l’enfant « victime ». Certes, il y a parfois lieu d’ « interpréter les parents [2] », pour desserrer un peu l’étau, mais sans trop croire, pour autant, que l’enfant puisse ainsi nous passer un savoir dont il suffirait d’éclairer ses Autres pour les remettre à leur place !
Car l’autre versant, c’est la modalité singulière choisie par l’enfant pour répondre : ce choix est en effet conditionné par l’Autre qu’a rencontré l’enfant, mais c’est l’Autre du langage tel qu’il a percuté son corps vivant.
Ainsi notre analysante, qui déjà remarque que toute petite, très curieuse, elle n’en passait pas par la demande pour satisfaire son désir de savoir mais grimpait, se hissait, pour apercevoir ce qui miroitait toujours plus loin. Il s’agit donc sans doute, pour elle, d’inventer en analyse une nouvelle façon d’habiter ce « toute seule » – pas sans le dire.
[1] Laurent É., « En finir avec l’enfant comme objet a libéré », Hebdo-Blog no10, 20 novembre 2014.
[2] Miller J.-A., « Interpréter l’enfant », in Le savoir de l’enfant, Paris, 2013, Navarin Éditeur, coll. La petite Girafe, p. 24.