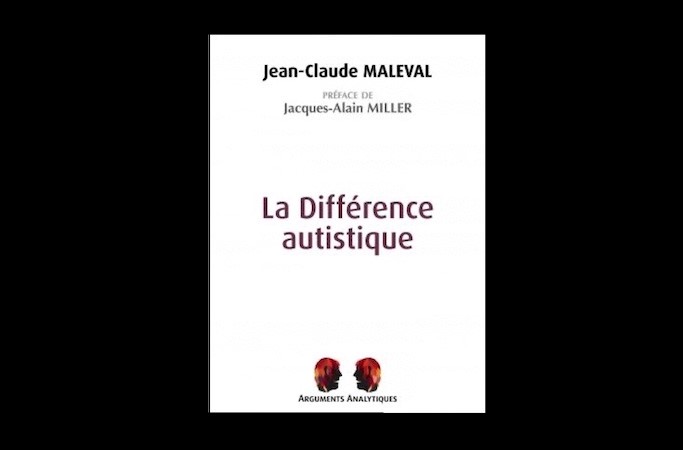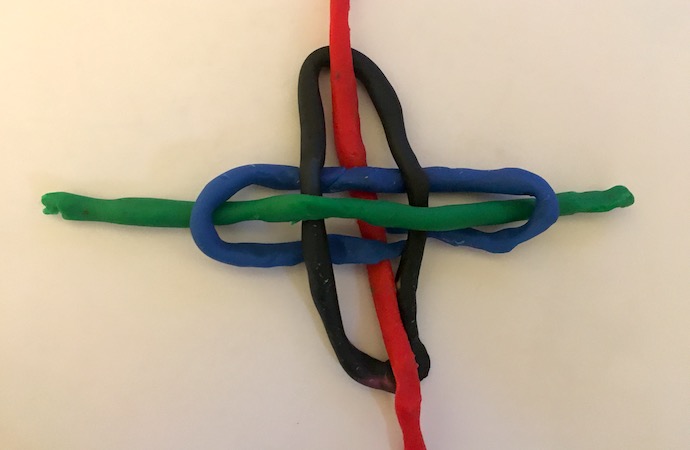Aujourd’hui une thèse, drapée de la légitimation des méthodes des sciences naturelles, tend à devenir dominante dans les départements universitaires de psychiatrie. Les départements de psychologie, craignant d’être en reste, les suivent : c’est la thèse neuro – entendre neurobiologique. Hégémonique, elle promeut une causalité : elle veut expliquer l’intégralité de la vie psychique devenue mentale[1], donc cérébrale. À s’y référer, ce qui fait symptôme et mal-être doit être construit comme un trouble (disorder) qui trouve sa localisation matérielle dans les mécanismes neuronaux du cerveau. Ce dernier est une boîte ou mieux une machine dans laquelle circule de l’information et rien que de l’information. En liquidant la causalité psychique au profit d’une organogenèse neuronale, cette thèse fonde une nouvelle pathologisation de la clinique dont l’opinion s’accommode.
Quelles sont les conséquences thérapeutiques qui découlent de ces thèses matérialistes ? Comment se spécifient-elles pour les maladies mentales ? Par exemple, le diabète, bien étudié par la médecine, sert de modèle au neurobiologiste pour penser les affections psychiatriques : « Il faut maintenant obtenir des critères quantitatifs. Le quantitatif est indispensable au diagnostic. Peu importe la méthode à condition qu’elle conduise à une réponse non ambiguë. On détecte le diabète en mesurant la réponse à une injection de glucose. Il faut disposer de tests similaires pour la maladie mentale. […] les tests biologiques paraissent indispensables. Une fois qu’on a établi une carte des troubles, on fait ensuite un diagnostic, comme un neurologue »[2], affirme Jean-Pierre Changeux en réponse à une remarque de Jacques-Alain Miller. La référence date de 1978. Elle était grosse de promesses aujourd’hui promues, valorisées, généralisées. Les neurosciences n’en démordent pas : la psychiatrie, et a fortiori la psychanalyse, est une discipline métaphysique. Elle doit, pour devenir scientifique, être fondue dans la neurologie : « Le neurologue, lui, dit : “Je donne un coup de marteau ici, et tel neurone dans la moelle épinière disparaît.” Eh bien, à partir de ce diagnostic, le psychiatre dira – j’anticipe sur l’avenir – : “Il y a tel trouble dans le domaine du cerveau, dans tel ensemble, sous-ensemble ou ensemble d’ensembles de neurones du cerveau, qui fonctionnent avec tel neurotransmetteur. Il y a sous-emploi ou suremploi. Je donne telle drogue qui va rééquilibrer le système.” Puis on enlève la drogue ; et l’individu redevient normal, il peut repartir. »[3] Cet exemple sur le modèle du traitement du diabète est simpliste : la drogue est au trouble mental ce que l’insuline est au diabète. Le trouble résulte d’un plus (« suremploi ») ou d’un moins (« sous-emploi ») des neurotransmetteurs et des diverses réactions chimiques engagées dans les communications synaptiques entre neurones. Si le système est rééquilibré, la normalité revient. Cette dernière est donc réductible à l’équilibre. Si l’individu redevient normal, est guéri et repart, alors la prise en charge psychiatrique a trouvé sa fin. Ce modèle est valable seulement pour une maladie dont la gravité est légère ou modérée, c’est-à-dire un état du système cérébral dont les neurones ne sont pas détruits – seules les organisations synaptiques doivent être réparées. Pour illustrer, J.-P. Changeux cite une angoisse passagère, une névrose légère. Mais, dans certains cas, des neurones sont détruits. Les maladies qui en découlent sont graves, car « on ne remplace pas un neurone manquant »[4]. C’est le cas notamment pour la dépression mélancolique, la schizophrénie, l’autisme, etc. Comment se mesure la « gravité » ? À l’« [i]rréversibilité de la trace qui est engagée. »[5] Autrement dit, les maladies mentales sont, par définition, lésionnelles. Ce qui fait la différence, c’est de déterminer si la lésion est réversible ou pas. En neuropathologisant névrose et psychose, cette nouvelle clinique se médicalise jusqu’à exclure la psychanalyse qui, elle, se propose, en suivant l’orientation de Lacan, de dépathologiser l’inconscient[6]. Telle est la nouvelle clinique hégémonique qui doit, pour les psychanalystes, être combattue dans ses présupposés idéologiques, concept contre concept[7] – pour éviter le pire.
___________________________
[1] Sur l’expression « vie mentale », cf. Dehaene S., Vers une science de la vie mentale, Paris, Collège de France/Fayard, 2006. Disponible également sur internet en openedition : https://books.openedition.org/cdf/2854?lang=fr
[2] Changeux J.-P., « L’homme neuronal », entretien avec J.-A. Miller, A. Grosrichard, É. Laurent et J. Bergès, in Foucault – Duby – Dumézil – Changeux – Thom. Cinq grands entretiens au Champ freudien, Paris, Navarin, 2021, p. 168.
[3] Ibid.
[4] Ibid., p. 166.
[5] Ibid., p. 167.
[6] Miller J.-A., « Conversation d’actualité avec l’École espagnole du Champ freudien, 2 mai 2021 (I) », La Cause du désir, n°108, juillet 2021, p. 37 & sq.
[7] Nous déplierons cette démonstration, ici à peine esquissée, dans un livre à paraître chez Navarin début 2022.