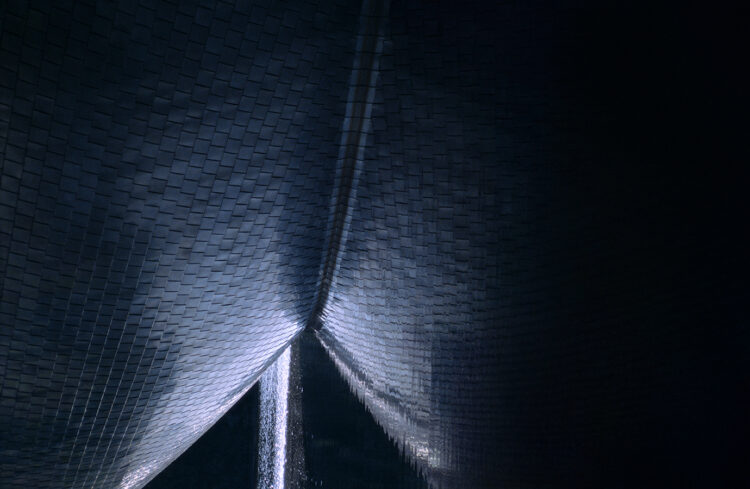À l’heure de l’impérialisme des troubles neuro-développementaux (TND), qu’en est-il des diagnostics dans la pratique[1] de la psychanalyse ? Comment les situer eu égard à la pratique contemporaine du diagnostic dans le champ de la santé mentale ? Si la psychanalyse vise à ce que le sujet assume sa part la plus singulière, sa radicale altérité, comment dialectiser cela avec la pratique de classification catégorielle, guidée par les protocoles, les normes et évaluations de la psychiatrie actuelle ?
À suivre Lacan, le diagnostic de l’enfant peut s’entendre de façon équivoque. Selon la valeur donnée au génitif, le sens de la formule se renverse radicalement. Avec le génitif objectif, le diagnostic de l’enfant s’entend comme le diagnostic fait sur l’enfant. L’enfant est ici en place « d’objet » du diagnostic. C’est ainsi que procède le champ de la santé mentale et ses Centres experts. Les outils dont ils usent, notamment pour le diagnostic de TSA et de TDAH, se veulent objectifs, oblitérant la dimension subjective aussi bien des évalués que des évaluateurs. Ils se revendiquent comme tels alors que certains outils ne requièrent même pas la présence de l’enfant. Les parents, proches ou enseignants sont estimés davantage en mesure de répondre aux items. Si l’enfant peut être objet d’inquiétude, d’incompréhension, voire d’exaspération pour ses parents, en Centre expert il sera « objet d’étude » – la réalisation du diagnostic permettant un recueil de données alimentant la recherche. « L’étiquette diagnostique », signifiant-maître, est donc assignée à l’enfant par l’Autre de la santé mentale, omettant la singularité de sa souffrance et ce qu’il peut en dire.
La psychanalyse s’inscrit à l’envers de cette pratique. À lire le diagnostic de l’enfant avec le génitif subjectif, il s’entend que c’est l’enfant qui produit, qui est sujet de son diagnostic. C’est là que réside l’éthique de la psychanalyse. Elle suppose un savoir insu à l’enfant sur son symptôme, et, s’il y a un diagnostic à produire, c’est d’abord à lui de s’y atteler. Nous pourrions dire que le symptôme de l’enfant est la réponse inconsciente qu’il formule là où se présente le trou dans les classes et dans les règles. Il procède d’un effort d’invention pour s’inclure dans un « universel bien particulier qui consiste en l’absence d’une règle précisément[2] ». C’est le rapport sexuel qu’il n’y a pas face auquel chaque sujet se trouve devoir inventer une réponse. Le symptôme est cette invention, ce que l’enfant a de plus intime, de plus réel, et la psychanalyse lui offre la possibilité de tenter d’en savoir plus sur ce qui fait sa signature diagnostique, ce qui le distingue, le constitue comme « exception à la règle[3] ». La psychanalyse, par son offre de parole, élève la singularité de la souffrance du parlêtre qu’est l’enfant au rang de symptôme comme défense contre le réel. Le diagnostic en psychanalyse participe d’un art, « d’un art de juger d’un cas sans règle et sans classe donnée[4] ».
Anaïs Adam
[1] « Des diagnostics dans la pratique », titre du colloque UFORCA (Union pour la Formation en Clinique Analytique) pour l’Université Populaire Jacques-Lacan qui s’est tenu le 15 juin 2024 à la Maison de la Mutualité à Paris.
[2] Miller J.-A., « La signature des symptômes », La Cause du désir, n°96, 2017, p. 118.
[3] Ibid., p. 119.
[4] Ibid., p. 117.