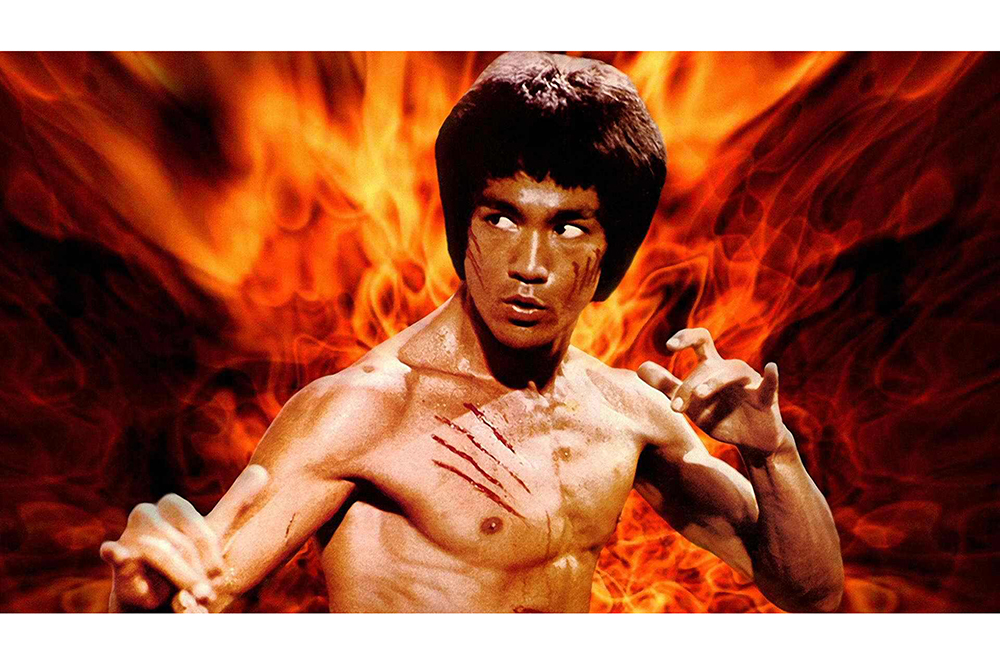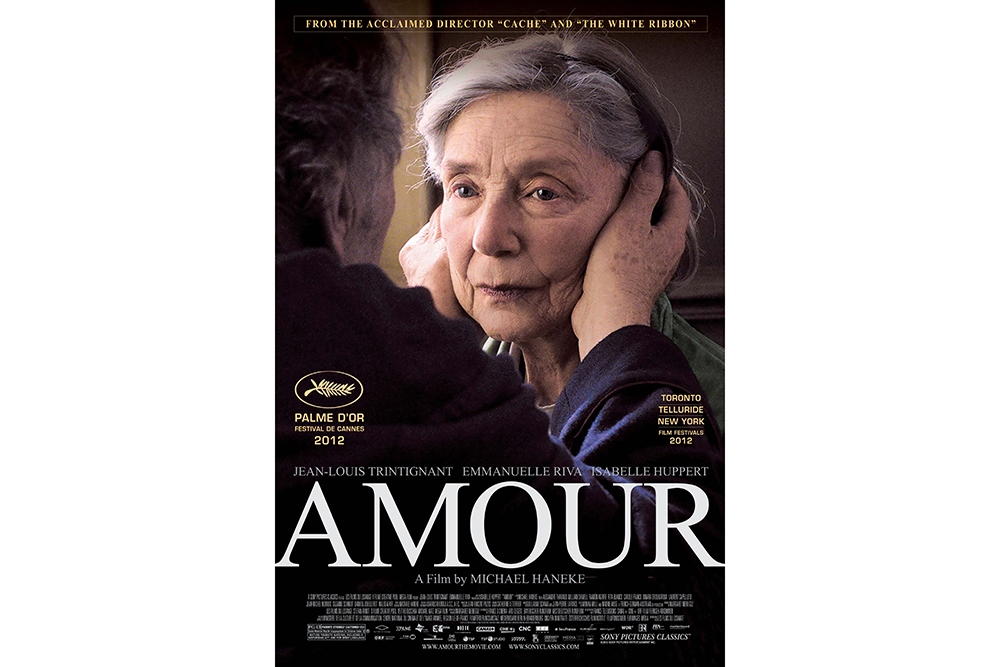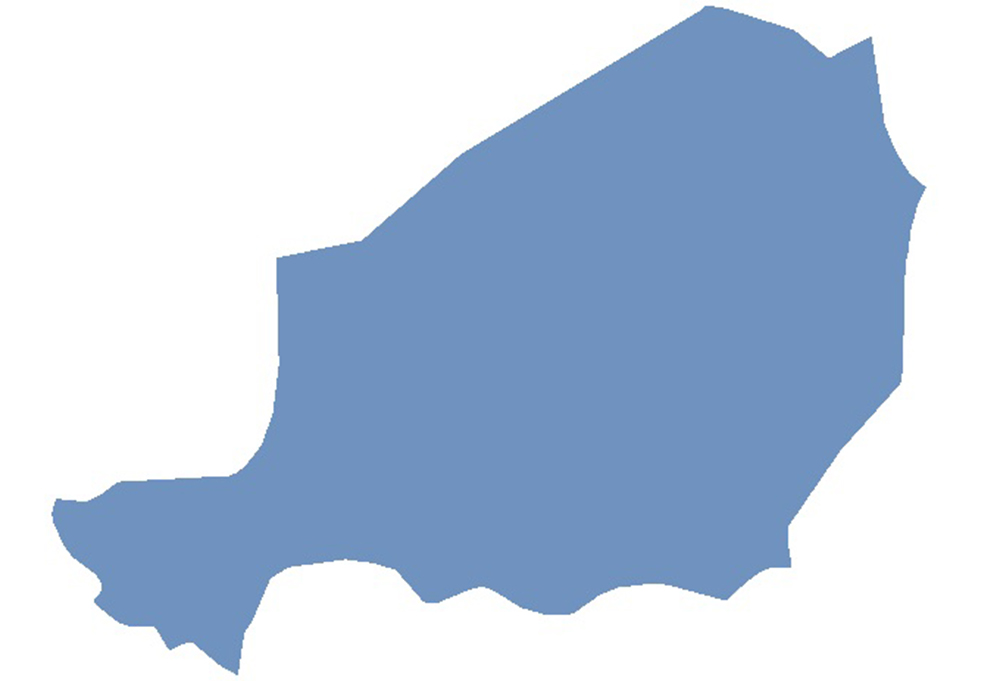Nous avons le plaisir de vous transmettre ici un premier entretien réalisé autour du dernier livre d’Hélène Bonnaud Le corps pris au mot. Vous retrouverez l’auteure dans notre HB du 27 septembre, avec de nouvelles questions.
Marie-Christine Baillehache – À l’encontre de notre XXIe siècle qui fait croire que le corps peut se désarrimer de l’Autre et boucher toute la jouissance du corps avec un objet plus-de-jouir mondialisé et prêt-à-consommer, la psychanalyse enseigne que les pratiques contemporaines du corps ne parviennent pas à contenir toute la jouissance. Elle soutient que le corps est un objet particulier, condensateur d’une jouissance qui échappe toujours au sujet, le dépasse et l’angoisse. De quelle manière la psychanalyse s’occupe-t-elle de ce corps qui veut jouir ?
Hélène Bonnaud – Eh bien justement, elle ne s’en occupe pas ! Elle s’occupe du sujet parlant et de son corps, que Lacan a nommé « parlêtre » à la fin de son enseignement. Elle ne sépare pas le sujet de son corps car elle postule que le sujet qui vient parler de ce qui ne va pas dans sa vie, qui vient demander à un analyste d’éclairer le ou les symptômes qui le perturbent, qui vient dire sa souffrance, a un corps qui réagit, pâtit de ce dont il se plaint. Il n’est pas, ce corps, hors circuit de la parole, même si vous avez raison de noter que la jouissance qui s’éprouve dans le corps échappe au sujet. Cette jouissance n’est pas totalement insensible au travail d’analyse, car, de fait, parler de ce corps perturbé, de ce qui s’y joue, ce qui s’y passe, déplace la jouissance, même si elle ne peut totalement se résorber. Mais il est vrai qu’aujourd’hui, on considère que le corps est un objet à lui tout seul, indépendant de la pensée, parce qu’on est soumis aux diktats de notre monde contemporain, qui ne cessent de nous dire qu’avoir un corps en bonne forme est la clé du bonheur et qui vantent les moyens d’y accéder en proposant toutes sortes de produits et de méthodes allant du simple massage à des techniques sophistiquées, le but étant d’obtenir un sentiment de bien-être, d’harmonie, ce que Freud avait déjà décrit comme le moyen d’atteindre le plaisir et qui fonde un des grands principes de la vie psychique sous le nom de « principe de plaisir »[2]. Le plaisir, en effet, n’est pas, comme chez l’animal, lié à la satisfaction pure et simple des besoins. Chez l’être parlant, le plaisir est toujours contrarié du fait que nous sommes parasités par le langage, et les symptômes qui s’en manifestent prennent leur source dans le corps, dans ce que Freud a appelé la pulsion. Ce qu’on appelle le stress aujourd’hui n’est autre que la présence dans le corps d’une manifestation de l’angoisse qui agit du fait que la parole et le corps sont noués.
Ce qui est consommé depuis plusieurs décennies, ce sont certes les objets qui servent à la jouissance immédiate, mais ce sont aussi les effets du discours actuel sur les bienfaits psychologiques liés au fait de prendre soin de son corps, de le masser, de le choyer, de le « faire beau » etc. Le corps est devenu un objet de traitement de masse. Il est à noter aussi que tout ce qui est vendu pour satisfaire le corps se fait sur le mode du Un, chacun pour soi, chacun sa méthode, chacun son sport, etc. Il y a bien une convergence entre cette mode du corps et le Un tout seul propre à notre époque que Jacques-Alain Miller a déplié dans son cours, « l’Être et l’Un »[3].
M.-C. B. – Vous nous rappelez que Jacques Lacan, dans son tout dernier enseignement, fait valoir que le corps est « radicalement marqué par une jouissance inéliminable »[4]. Tout du corps ne peut être symbolisé. Le savoir bute sur un reste réel que J.-A. Miller nomme « événement de corps »[5]. Entre la jouissance de la parole et ce reste de jouissance du corps, il y a un hiatus irrémédiable faisant trace dans un symptôme de corps irrésorbable. Pouvez-vous nous éclairer sur ce que la passe témoigne de ce point crucial de la cure analytique ?
H. B. – La passe est l’examen qu’a inventé J. Lacan pour savoir comment l’analysant qui pense avoir fini son analyse témoigne de la façon dont s’est conclue l’expérience pour lui auprès d’un jury qui écoutera son témoignage et le nommera, ou pas, AE de l’École. Il s’agit toujours d’un moment important, celui où on décide que l’analyse a atteint son point de finitude, mais cela ne suffit pas en soi, il faut aussi pouvoir dire en quoi cette fin démonte en quelque sorte le montage qui était en jeu dans la jouissance propre du sujet. Il y faut une démonstration ou, au moins, l’idée qu’on a aperçu quelque chose de nouveau, quelque chose qui marque un point d’irréversibilité.
Dans les pages que vous citez de mon livre, nous sommes quasiment à la fin de l’ouvrage, celui où je traite, dans un chapitre intitulé « L’événement de corps », la façon dont le corps a subi la percussion d’un signifiant tout seul, désarrimé de la chaîne signifiante, un signifiant refoulé, ou encore détaché, ou figé. Du moins, c’est ce que mon propre travail de passe m’a permis de vérifier comme étant le ressort même de mon mode de jouir. Cette solution a marqué la fin de mon analyse. J’ai commencé ce livre au moment où allait se terminer mes trois ans de témoignage. Ce n’est certainement pas un hasard. Sans doute voulais-je mettre les analyses que je conduis à l’épreuve de cette nouvelle lecture qu’est l’impact du signifiant dans le corps.
M.-C. B. – Entre l’homme et la femme, J. Lacan introduit la répétition du réel de la différence des sexes. Leur « faire couple » peut s’en trouver marqué par l’illimité de la pulsion de destruction qui habite chaque sujet. Le partenaire est alors choisi pour représenter jusqu’au pire cette part de jouissance du corps hors-sens qui se répète en excluant la parole. Quelle éthique la psychanalyse soutient-elle pour rendre vivant son lien à son partenaire symptôme ?
H. B. – En matière de couple, le choix du partenaire est toujours un choix singulier, difficile à cerner, à saisir, à connaître. Pourquoi ? D’abord l’amour est quelque chose qui reste mystérieux. C’est un sentiment dont personne ne peut dire de quoi est faite sa matière, sa texture, et les psychanalystes, s’ils tentent de le découvrir, de l’approcher, de le serrer, n’ont jamais totalement accès à la couleur du sexe, pour reprendre la façon dont Lacan en parle dans le Séminaire Le sinthome[6]. Lacan a joué de l’équivoque entre le mot amour et le mot amur dans Encore[7], indiquant ainsi, en effet, le mur qui sépare l’homme de la femme. Il y a donc des murs de divers matériaux. Le mur en bois, le mur en plâtre, et le mur en papier… C’est comme les noms que l’on donne au nombre d’années de vie des couples ! Tout le monde connaît cette évaluation de la longévité des couples mesurable au temps passé ensemble et qui va du coton à l’or. Ça pourrait être du même tonneau sauf que l’amour doit toujours faire avec la jouissance, et c’est ce que l’analyse nous apprend.
L’éthique de la psychanalyse est complexe en matière de relation amoureuse. À la différence des psychologues, le psychanalyste n’appréhende pas le couple comme une structure idéale, normée par la société, et apprend de l’expérience qu’entre deux partenaires, la jouissance est l’enjeu primordial sur lequel ils s’apparient. Si un sujet souffre de son partenaire, si celui-ci est un ravage, l’analyste accompagne le sujet pour analyser quelle part il prend dans le déchaînement de cette jouissance. Il n’y a pas d’autre position pour l’analyste, sauf exception. Nous savons bien que la jouissance illimitée peut conduire au pire, vous avez raison de l’introduire dans votre question. Sans doute tout cela est-il affaire de senti-ment, et il faut avoir fait une longue analyse pour ne pas se laisser piéger par les passions amoureuses, même les plus destructrices, mais c’est aussi une affaire de corps. Ni dit-on pas « avoir quelqu’un dans la peau ? » L’éthique du psychanalyste, c’est d’être dépassionné et de soutenir le pari de la parole en tant que le corps et sa jouissance y sont noués.
[1] Bonnaud H., Le corps pris au mot, Paris, Navarin-Le Champ freudien, 2015.
[2] Freud S., Au-delà du principe de plaisir, Petite Bibliothèque Payot, 1920.
[3] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’être et l’Un », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris VIII, 2010/2011, inédit.
[4] Bonnaud H., Le corps pris au mot, op.cit., p. 190.
[5] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’être et l’Un », op. cit., leçon du 4 mai 2011, inédit.
[6] Lacan J., Le séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Paris, Seuil, 2005, p.116.
[7] Lacan J., Le séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 11.


![Le corps pris au mot[1] Hélène Bonnaud répond aux questions de Marie-Christine Baillehache](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/09/BonnaudHD.jpg)