L’HB – Vous n’avez pas voulu écrire une psychobiographie (début du livre). Pouvez- vous nous éclairer sur ce qui vous a poussée à écrire ce livre et à enquêter ?
NJ – Ce livre est né d’une rencontre contingente : l’émission de radio, fin 2009, au cours de laquelle Élisabeth Roudinesco a donné à Raphaël Enthoven une interview à propos de la réédition au Livre de poche des trois volumes remaniés de son Histoire de la psychanalyse en France et de la biographie qu’elle a consacrée à Jacques Lacan. Lorsque je l’ai entendue acquiescer au fait que, de Dalí ou de Lacan, le plus fou des deux n’était pas celui qu’on croit, ou dire que si Lacan pratiquait la séance courte c’était, entre autres, par amour de l’argent, je me suis dit qu’il était temps de se pencher sur la biographie. Dès le prologue, j’ai été stupéfaite par sa façon de procéder. Au prétexte de planter le décor et de replacer la famille de Lacan dans son contexte historique, celui de vinaigriers originaires d’Orléans, ce qu’elle amenait d’entrée de jeu, c’étaient les termes de « légende noire », d’ « excréments » et d’« escroquerie ». Cela disait quelque chose des intentions qui animaient l’auteure. La suite de ma lecture n’a pas démenti cette première impression. De là est née l’idée de poursuivre la recherche en m’attachant à repérer les traces de son énonciation pour cerner la place d’où elle écrivait. Même si un portrait de Lacan se dégage de ce travail, mon intention n’a en effet jamais été d’écrire une contre-biographie, ni de me livrer à la psychobiographie d’Élisabeth Roudinesco.
L’HB – Pourriez-vous reprendre en quelques mots la distinction dont vous vous servez entre rhétorique mémorielle et rhétorique historique ?
NJ – Ce dont je me suis rendue compte assez vite au cours de ma lecture et des recherches que j’ai entreprises sur la méthode historique, c’est que la position de témoin et celle d’historien sont, depuis que l’histoire est devenue une discipline à part entière, incompatibles. On ne peut pas se faire l’historien de sa propre histoire. La position de l’historien requiert une distance par rapport aux événements qui est impossible à qui les a vécus personnellement. Or, Élisabeth Roudinesco est la fille d’une proche de Lacan, et elle-même a été membre de l’École freudienne de Paris et partie prenante à la dissolution. Derrida l’avait avertie dès l’origine de son projet : elle ne pouvait pas l’écrire à la troisième personne ; il fallait dire « je ». Elle s’y est refusée, et le résultat est que son transfert négatif, ses jugements tous azimuts, à l’égard de Lacan comme de son entourage, infiltrent tout ce qu’elle écrit ; elle en use légèrement avec les règles de la méthode historique, avec les documents, avec les sources, avec les témoignages ; elle interprète toujours à charge, tout en prétendant à l’objectivité du chercheur dépassionné.
L’HB – Selon vous, à quoi devrait tendre une biographie éclairée par la psychanalyse ?
N’y aurait-il pas chez l’historienne le désir de construire une histoire complète, intelligible, sans part d’ombre de l’être d’un sujet ?
NJ – Je ne sais pas si l’on peut parler de biographie éclairée par la psychanalyse… en dehors des récits de passe, peut-être ! Le plus bel exemple que j’ai rencontré de ce vers quoi pourrait tendre une biographie orientée par la psychanalyse, c’est le Michelet de Roland Barthes. Il porte d’ailleurs un sous-titre qui illustre bien ce dont il s’agit puisqu’il s’intitule : Michelet… par lui-même. C’est un portrait fait de fragments, de morceaux mal ajointés. C’est l’histoire d’un corps parlant, dont les événements qui l’affectent sont au cœur de l’ouvrage. Il n’émane pas d’un historien ; il ne rétablit pas la continuité ; il ne raconte pas, si ce n’est en creux, la vie de cet homme de sa naissance à sa mort. Pour moi, le résultat est non seulement plus heureux, mais, pour autant qu’il existe quelque chose comme une « vérité du sujet », il est aussi beaucoup plus vrai.
D’une certaine manière, on pourrait estimer que la biographie de Jacques Lacan par Élisabeth Roudinesco est éclairée par une certaine vision de la psychanalyse. En tout cas, l’auteure s’en réclame, d’autant plus qu’il s’agit pour partie d’une biographie intellectuelle qui se donne pour ambition de retracer ce qu’elle appelle « l’histoire [du] système de pensée » d’un psychanalyste. Mais si l’on prend les récits de passe, et donc le tout dernier enseignement de Lacan, comme boussoles de ce vers quoi devrait tendre une biographie, la visée serait le moins d’hystoire et le plus de logique possibles, en s’orientant à partir des dits du sujet biographié : c’est sur ces points même que le projet d’Élisabeth Roudinesco échoue. Non seulement n’accorde-t-elle aucun intérêt à ce que Lacan dit de lui-même, mais encore plaque-t-elle sur ses actes, ses paroles, sa vie, diverses interprétations psychologisantes qui vont toutes dans le même sens : rabaisser sa personne et son enseignement et le faire apparaître comme un vulgaire Rastignac dont l’ambition le portait à rechercher avant tout la gloire et la reconnaissance générale, parfois servile, avide d’argent et qui, après une période de puissance intellectuelle indéniable ayant culminé dans les Écrits, aurait sombré dans la décadence néologique, prélude à une véritable « implosion crépusculaire » de sa pensée.
Dès lors, le tout dernier enseignement de Lacan, dont Jacques-Alain Miller nous a appris à comprendre tant l’importance que le caractère novateur, est absolument étranger à Élisabeth Roudinesco ; elle le considère comme pure divagation d’un esprit dérangé. Elle n’accorde de valeur qu’au Lacan structuraliste, celui du Nom-du-Père et du rapprochement entre la psychanalyse et l’histoire. D’où l’importance qu’elle accorde à la tradition, aux généalogies, à l’histoire des idées, aux filiations intellectuelles. D’où aussi son désintérêt pour toute tentative de saisir le sujet par le biais du réel, de la contingence, du fragment, de l’éclat. D’où, enfin et surtout, le fait qu’elle passe complètement à côté du personnage.
L’HB – Le Jacques Lacan d’Élisabeth Roudinesco tient-il du roman ou du récit ?
NJ – La vision généalogique que j’évoquais plus haut oblige Élisabeth Roudinesco à faire prévaloir la continuité sur la discontinuité, la narration sur le fragment : ce qu’elle nous livre n’est pas de l’histoire, pas même une hystoire. C’est d’autant plus vrai qu’elle n’accorde pas le moindre intérêt à ce que Lacan a dit de lui-même, à de nombreuses reprises, au cours de son enseignement tant oral qu’écrit. Résultat : elle prend appui sur la supposition de savoir impliquée par le fait de se réclamer de la discipline historique et sur la garantie qu’emporte l’exercice de cette profession, pour produire une biographie qui n’est en réalité qu’un roman – plus proche de Balzac que de Marc Bloch ou de Jacques Le Goff.
L’HB – Et qu’en est-il de son Freud qui vient de paraître ?
NJ – Elle vient de recommencer avec Freud, mais cette fois-ci, les jurys littéraires ne s’y sont pas trompés puisqu’ils n’ont décerné à l’historienne ni le Médicis essais ou le Femina essais, ni le prix du Sénat du livre d’histoire ou le Grand prix des rendez-vous de l’histoire de Blois ; mais elle s’est vue remettre deux prix généralement attribués à des ouvrages de fiction : romans ou biographies romancées. À ma connaissance, c’est une première pour un historien ! Sans doute à leur insu, et au prétexte de l’hommage, ces jurys ont renvoyé Élisabeth Roudinesco à la vérité de sa position d’écrivain : romancière et non pas historienne. C’est un point crucial, car eût-elle affirmé écrire une biographie romancée et s’y fût-elle mise en scène à la première personne comme l’ont fait, récemment, Emmanuel Carrère dans Limonov ou Patrick Deville, plus discrètement, dans Peste et choléra, il n’y aurait rien eu à redire.
Son Freud est cependant un peu différent de son Lacan : elle ne l’a pas connu, son transfert négatif est moins présent et sa propre histoire interfère moins. Par ailleurs, grâce aux archives, elle apporte un démenti à nombre d’affirmations plus ou moins outrancières des détracteurs de la psychanalyse. Mais de nouveau, c’est un personnage de fiction qu’elle construit – et d’une fiction à la mode d’aujourd’hui. En faisant de Freud un « romantique noir » fasciné par Faust, Méphisto, l’occultisme et les « Lumières sombres », en qualifiant l’inconscient de « monde souterrain du chaos et des Titans », elle évacue la particularité essentielle de son apport, qui consiste à avoir dégagé l’inconscient de sa gangue romantique pour en définir les lois rigoureuses de fonctionnement. Ce Freud « gothique » est séduisant, à l’époque de séries télévisées comme Penny Dreadful, mais il est à côté de la plaque. Plus grave : non seulement fait-il manquer à ses lecteurs non avertis l’essence même de la révolution dans le savoir dont il a été l’initiateur, mais encore rend-il incompréhensible et superfétatoire le « retour à Freud » de Lacan.


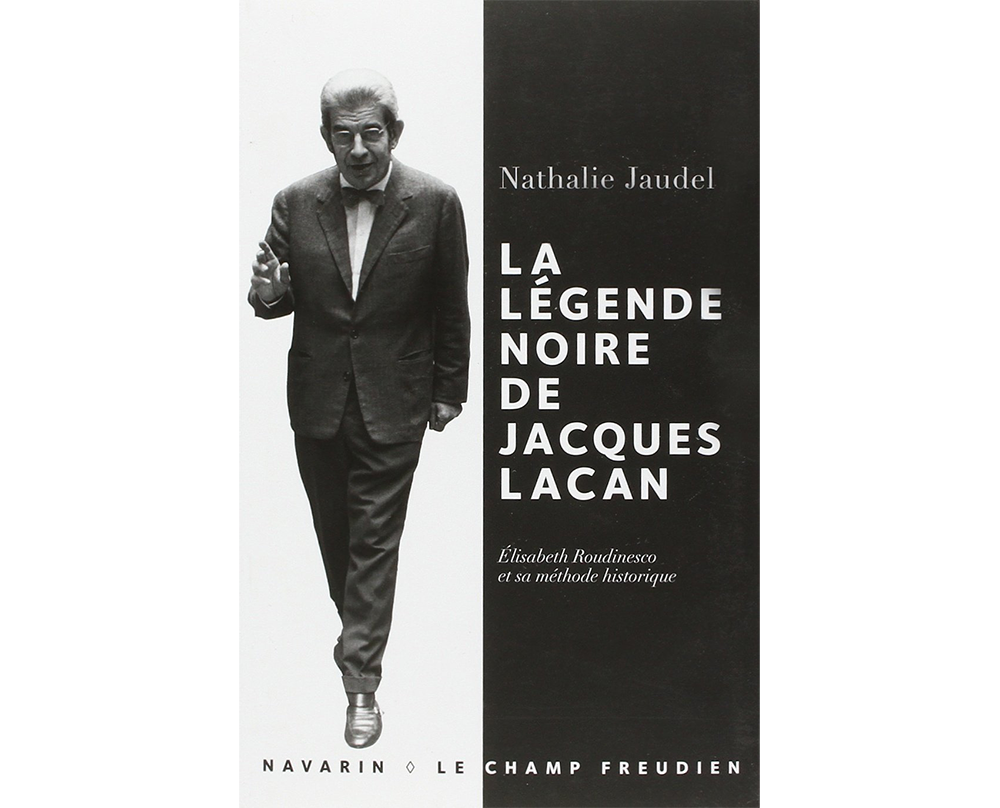



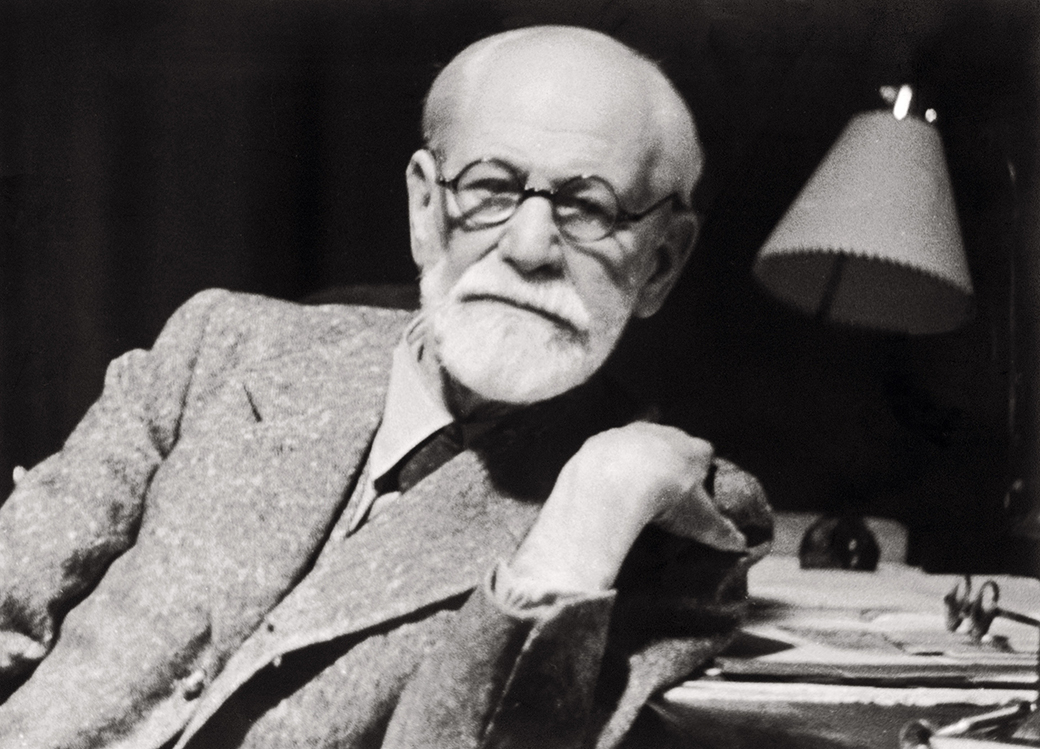



![« Un traitement modificateur de structures »[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/01/Belghomari.jpg)