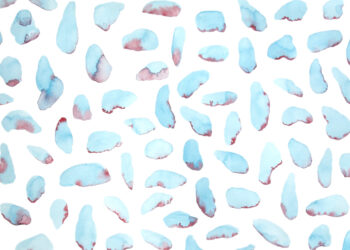Roman classique s’il en est, le premier de l’ère moderne puisqu’il paraît en novembre 1830, Le Rouge et le Noir de Stendhal a donné forme à nos sentiments – c’est la fonction que reconnaissait Lacan aux classiques en un temps où leur lecture faisait encore partie de l’instruction publique1.
La fin des grandes passions
Le sentiment concerné ici est celui de l’amour dont la place n’allait plus de soi à l’heure de la mort de Dieu, de la royauté constitutionnelle et du capitalisme naissant. La grande idée de Stendhal, partagée par Tocqueville, était que la tyrannie de l’opinion avait remplacé après la Révolution française, celle de Dieu. Autrement dit, il ne s’agissait plus de plaire au grand Autre mais au petit, fut-ce au pluriel, ce qui avait pour conséquence l’avènement du conformisme – Stendhal considérait ainsi que « le convenable est le grand malheur du XIXe siècle », que le despotisme n’est plus que celui du ridicule, ou encore que « nous ne sommes que des pièces de monnaie effacée »2. Dans le même fil, les grandes passions selon lui s’étiolent et avec elles, les forces qui les équilibrent. Au nœud de l’amour et de l’honneur qui faisait le drame de la Princesse de Clèves à la cour des Valois succède celui de l’amour et de la vanité qui étouffe les héros du Rouge et le Noir sous la Restauration. En vrai précurseur, Stendhal ouvrait un discours que d’autres reprirent ensuite, tel Balzac, dont les personnages, peu divisés, n’étaient plus commandés que par la pulsion, souvent sordide, comme le seront toujours plus ceux de Flaubert ou de Zola.
Honteux et éhontés
Les principaux personnages du Rouge et le Noir sont tourmentés parce qu’ils sont encore sensibles à la honte dans un monde qui ne l’est plus beaucoup. Quelques honteux font face aux canailles et aux sots – la « chasse aux canailles obsède Stendhal3 », écrit d’ailleurs Jacques-Alain Miller. Ils éprouvent à un moment ou à un autre la honte de vivre, soit celle de jouir, et cherchent à s’en défendre4.
Julien Sorel déteste tant son charpentier de père, lequel le lui rend bien, qu’il est dévoré d’une ambition sans bornes, et se rêve à la fois en héros napoléonien tout comme en disciple de Rousseau. Relevons aussi combien père et fils Sorel ne s’entendent que dans la honte réciproque – comme le remarque J.-A. Miller, la honte est amboceptive de prendre sa source soit dans le sujet soit dans l’Autre5.
Mme de Rênal est tellement gênée par les passions viles de son industriel de mari, sa richesse, ses charmes, qu’elle se contente d’être mère en rêvant à l’amour de Dieu – elle n’avait jamais connu l’amour avant Julien Sorel, et sa position fondamentale était celle de l’abnégation.
Mathilde de la Môle jeune aristocrate voltairienne, appelée à régner après son mariage sur les salons parisiens, se désespère de n’y avoir jamais rencontré d’homme qui vaille, mais seulement des fats élégants, spirituels et prévisibles. Le seul héros qu’elle distingue est son ancêtre du XVIe siècle, Boniface de la Môle, amant de Marguerite de Navarre, la fameuse reine Margot épouse d’Henri IV, que Catherine de Médicis fit décapiter – Marguerite l’aurait tant aimé qu’elle en a recueilli la tête après son exécution : « Quelle femme actuellement vivante n’aurait horreur de toucher à la tête de son amant décapité ?6 » lance Mathilde à Julien, lui annonçant sans le savoir encore ce qui l’attend. Moyennant quoi Mathilde Marguerite porte ostensiblement le deuil de Boniface chaque 30 avril, jour anniversaire de son exécution. C’est un caractère, une forte tête aimant d’un amour de tête et non de cœur, comme l’écrit Stendhal, amour dont le but est de garder le contact avec l’Autre capable de faire honte – elle se défend d’une jouissance honteuse par l’honneur, même si elle ne le retrouve qu’en un passé lointain7.
Honte et castration
Julien séduira comme on sait successivement l’une et l’autre, Mme de Rênal et Mathilde, en croyant les aimer, mais n’étant, en fait, poussé que par son ambition dont il n’a du reste jamais vraiment honte. Le Rouge et le Noir est ainsi le roman d’un homme qui veut arriver par les femmes – « Son amour [pour Mme de Rênal] était encore de l’ambition ; c’était la joie de posséder, lui pauvre être si malheureux et si méprisé, une femme aussi noble et aussi belle8 ». Ses amours avec Mathilde obéissent à la même logique, celle de séduire une femme puissante qui satisfera sa vanité. Et lorsqu’il sera démasqué par cette même Mme de Rênal, il se précipitera alors en un passage à l’acte qui le mènera à l’échafaud. Il ne mourra pas pour rien puisque la honte qui pèse sur le trio qu’il forme avec Mme de Rênal et Mathilde se dissipera à l’approche de son exécution. N’est-ce pas dire que l’on ne peut s’aimer tranquille, sans honte, qu’à l’ombre du couperet, soit de la castration ?
Philippe Hellebois
[1] Cf. Lacan J., « Le mythe individuel du névrosé ou Poésie et vérité dans la névrose », texte établi par J.-A. Miller, Le Mythe individuel du névrosé, Paris, Seuil, 2007, p. 37.
[2] Stendhal, Le Rouge et le Noir, in Œuvres romanesques complètes, t. I, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 2005, p. 1093.
[3] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le partenaire-symptôme », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 17 juin 1998, inédit.
[4] Le terme de honte se retrouve du reste un peu partout dans le roman surtout lorsqu’il est question de jouissance. Pour Mme de Rênal : cf. Stendhal, Le Rouge et le Noir, op. cit., p. 360, 427 & 451 ; Julien, cf. ibid., p. 474-475 le dîner chez Valenod, & p. 542 ; Mathilde, cf. ibid., p. 619, 650-653.
[5] Cf. Miller J.-A., « Note sur la honte », La Cause freudienne, n°54, juin 2003, p. 9.
[6] Stendhal, Le Rouge et le Noir, op. cit., p. 623.
[7] On retrouve ce paradoxe temporel dans ce qui fait le charme du style de Stendhal qui décrit le monde de la Restauration avec une plume trempée dans l’encre du XVIIIe siècle – c’est Voltaire s’amusant de Louis XVIII et de Charles X.
[8] Stendhal, Le Rouge et le Noir, op. cit., p. 430.