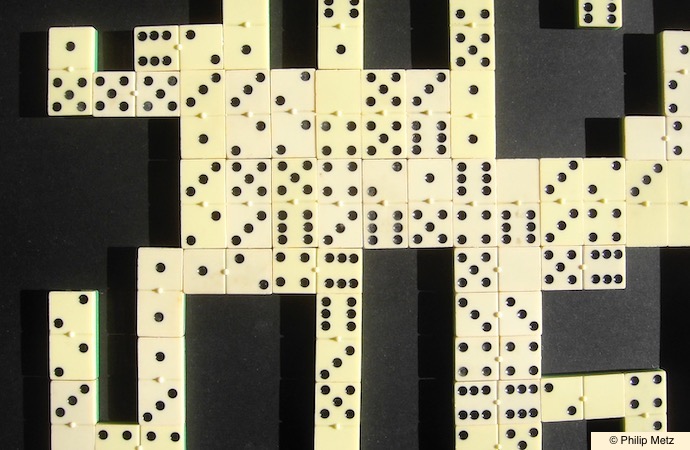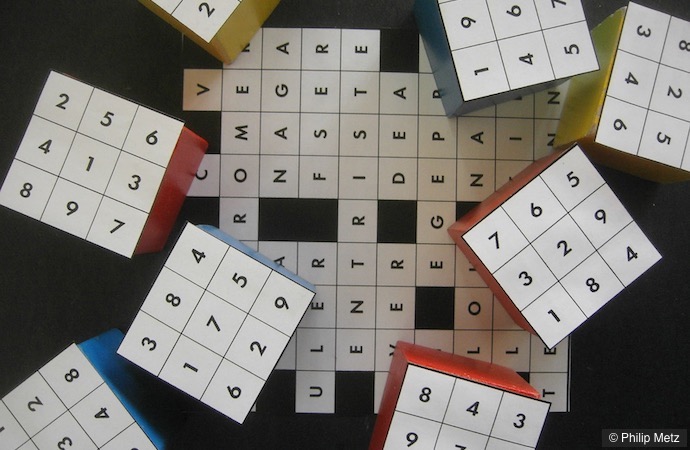Qu’est-ce qui différencie une institution de soins d’une autre institution de soins orientée par la clinique psychanalytique ? À première vue, rien. Quand on y rentre, on y voit souvent les mêmes photos de séjours et d’activités. On y voit une occupation en cours souvent scandée par le temps des repas. Au premier regard, pas de différence visible.
Il faut déciller le regard, selon l’heureuse expression de Mariana Otero, dans la préface au livre qui accompagne son magnifique documentaire « À ciel ouvert » [1]. En quittant le champ des apparences, on peut alors tenter d’attraper ce qui pourrait aussi s’énoncer dans un « ça se sent ».
Le point essentiel est la place centrale des sujets accueillis et donc de leur(s) histoire(s), de leurs soucis, de leurs demandes. Leur écoute est une évidence et les réponses des intervenants sont ajustées à ce qu’ils en ont appris. Le savoir n’est donc pas du côté de l’institution, mais des sujets. Le confort pour les intervenants n’est évidemment pas au rendez-vous, mais l’ennui non plus !
Un autre élément est commun à toutes les institutions orientées par la psychanalyse, c’est leur volonté et leur effort de s’extraire de la logique éducative et punitive qui règne dans le discours du maître. Pas question de reproduire ce qui a déjà démontré son échec avec les enfants psychotiques ou autistes ou encore qui n’a plus de raison d’être avec les adultes. Chaque intervenant est amené à trouver d’autres manières d’interdire, en inventant un « dire que non » plutôt qu’en scandant une injonction toujours prête à se retourner en pousse-à-jouir.
Mais la condition préalable et essentielle à celles déjà énoncées est celle du lien à l’École et à la psychanalyse qui soutient le désir de savoir auprès de ces sujets dont le rapport au corps et à la langue est si mystérieux. D’une part, il y a l’institution et les intervenants qui y travaillent, d’autre part, il y a l’École, lieu vivant de la psychanalyse. Entre ces deux univers différents, il y a celui ou celle qui soutient le discours psychanalytique, l’analyste. L’analyste est courroie de transmission entre ces deux lieux : il apporte dans l’institution les éléments du savoir élaboré dans l’École qui aide à la construction des cas et à l’orientation du travail et il rapporte dans l’École la récolte des éléments du réel pour contribuer à l’élaboration continue du savoir. En tant que courroie de transmission, l’analyste génère du mouvement dans ces deux lieux, une dynamique de recherche sur la langue et la manière dont elle opère sur les corps. La psychanalyse, en tant qu’elle troue l’imaginaire, amène du vivant dans l’institution. Elle bouscule les idées toutes faites, dérange les logiques éducatives, fait vaciller les idéaux humanistes. Grâce à ces trouées, l’air peut rentrer et l’atmosphère y devient respirable. Sans la psychanalyse, l’ennui suinte des murs des institutions. Sans la psychanalyse et la parole de Lacan [2], il n’y a pas moyen de penser à solliciter l’avis d’une autiste mutique par exemple ou de supporter des conversations répétitives sans commutation pronominale. Mais la psychanalyse elle aussi a besoin des institutions pour alimenter sa recherche clinique, son aggiornamento continuel [3]. Elles sont les lieux où le psychanalyste peut se confronter à d’autres discours et mettre en œuvre une pratique à plusieurs, à l’opposé de sa pratique solitaire en cabinet.
Katty Langelez-Stevens
_______________________________
[1] Otero M., Brémond M., À ciel ouvert, entretiens. Le Courtil, l’invention au quotidien, Paris, Buddy Movies, 2014, p. 9.
[2] « C’est bien justement ce qui fait que nous ne les entendons pas. C’est qu’ils ne vous entendent pas. Mais enfin, il y a sûrement quelque chose à leur dire. », répond Jacques Lacan au Dr Cramer après sa « Conférence à Genève sur le symptôme », La Cause du désir, n° 95, avril 2017, p. 17, consultable à https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2017-1-page-7.htm
[3] Comme Jacques Lacan le soutient dans l’« Acte de fondation » : Lacan J., « Acte de fondation », Autres écrits, Seuil, Paris, 2001, p. 231.