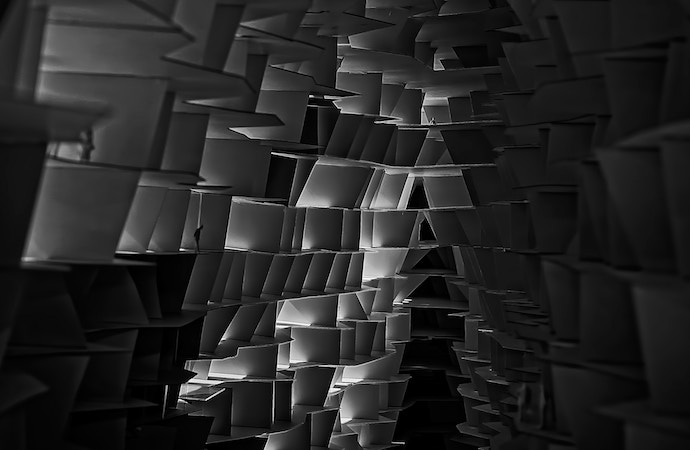« La désillusion mentale et la privation physique qui deviennent ainsi le destin de la plupart des mariages ramènent les deux époux à leur situation d’avant le mariage : ils se trouvent seulement appauvris d’une illusion. » [1]
Pierre Stréliski : Bonjour Pierre-Gilles, bonjour à tous. Nous avons le plaisir d’ouvrir cette matinée de travail dans cet atelier des 48e Journées de l’École de la Cause freudienne « S’aile amourre, gai, gai, marions-nous, la sexualité et le mariage dans l’expérience analytique », dont le thème initial, très balzacien, était : « Illusion perdue », avant que nous n’apprenions qu’il s’était transformé en un plus moderne et anglo-saxon : « No sex » ! On pourrait gloser sur ce titre, qui est peut-être l’ébauche d’une solution contemporaine radicale aux illusions en question, mais nous allons nous contenter de vous proposer un commentaire à deux voix sur la phrase de Freud qui va servir de « chapeau » à cette matinée et qu’on nous a demandé d’interpréter chacun à notre façon [2].
Cette phrase, là voici : elle date de 1908, c’est juste après le moment où Freud s’est intéressé à l’amour et à ses mirages, en lisant et commentant le roman de Jensen sur Gradiva, une fantaisie pompéienne, et c’est juste avant qu’il ne commence sa trilogie célèbre sur la « Psychologie de la vie amoureuse ».
C’est une phrase qui se trouve au début d’un texte qui s’appelle « La morale sexuelle ‘‘civilisé’’ et la maladie nerveuse des temps modernes ».
Cette phrase, là voici : « La désillusion mentale et la privation physique qui deviennent ainsi le destin de la plupart des mariages ramènent les deux époux à leur situation d’avant le mariage : ils se trouvent seulement appauvris d’une illusion » [3].
Quoi ? Nous aurait-on changé subrepticement le thème de nos Journées ? Serait-il devenu « Triste, triste, ne vous mariez pas ! » ? Le pessimisme de cette phrase de Freud pourrait le faire croire. Gageons qu’il s’agit plutôt de faire miroiter ce thème sous toutes ses facettes, et pas seulement sous celles, iréniques, du bonheur dans le conjugo.
D’ailleurs, en d’autres occasions, Freud comme Lacan ont des propos moins acérés sur le mariage. Le premier concède en 1918 qu’il ne faut pas se décourager et que si les premières unions sont vouées à l’échec, pour des raisons qu’il explique en détail et qui peuvent se résumer par un mot : le complexe d’Œdipe, « les seconds mariages sont souvent meilleurs que les premiers » [4]. Explication : « dans un nombre considérable de cas, la femme reste frigide dans son premier mariage [because l’attachement au père] et s’y sent malheureuse [because le penisneid], tandis qu’après la rupture de celui-ci elle devient pour son second mari une épouse heureuse et tendre »[5].
Lacan lui aussi peut à l’occasion dire du bien de l’institution du mariage. Par exemple quand il souligne que c’est un pacte de parole, un pacte symbolique, qui a ses vertus. « L’amour à proprement parler sacré, celui qui constitue le lien du mariage, écrit-il, […] est une fonction universelle » [6]. Même si cette vertu – quasi romaine – de l’ordre qu’institue le mariage est, note-t-il aussitôt après, en conflit avec les relations imaginaires [7].
Mais revenons à notre phrase. Son pessimisme, Freud le revendiquera toujours. À la fin de sa vie, il écrira au pasteur Pfister : « La pulsion de mort n’est pas pour moi un besoin du cœur ; elle m’apparaît seulement comme un destin inévitable. C’est de là que découle le reste. Mon pessimisme me semble donc être un résultat, l’optimisme de mon adversaire un pré-supposé. Je pourrais dire encore que j’ai conclu avec mes sombres théories un mariage de raison tandis que les autres vivent avec les leurs un mariage d’inclination. Espérons, ajoute-t-il, qu’ils seront ainsi plus heureux que moi » [8].
Soit. Mais en 1908, Freud n’a pas encore aperçu la pulsion de mort, la guerre est encore loin, et c’est la libido qui règne dans la théorie de Freud : alors, pourquoi ce tir à boulets rouges sur le mariage ? Notez qu’on a édulcoré la suite de la réflexion de Freud dans la phrase qu’on nous a proposé. Si l’illusion perdue de la femme la laisse, au mieux, réduite à s’occuper de ses bambins, au pire, ravagée par une névrose, la désillusion masculine trouve une autre issue : la tromperie – le bordel ou la maîtresse –, les retrouvailles avec une satisfaction dérivée grâce à ce que Freud nomme joliment une « ‘‘double’’ morale sexuelle » [9].
Non que Freud défende cette hypocrisie de la société de son temps, il l’attaque au contraire vertement et c’est même là tout le sens de ce texte sur « La morale sexuelle ‘‘civilisée’’ et la maladie nerveuse… ». La vérité est que la conjonction de coordination mise entre les deux parties du titre peut bien se lire comme un verbe : la morale sexuelle civilisée est [la cause] de la maladie nerveuse. Voilà un texte qui est dans son fond un violent pamphlet contre le carcan qu’impose cette civilisation aux pulsions. Un peu plus tard, Freud écrit d’ailleurs : « La morale sexuelle telle que la société – et au plus haut degré la société américaine puritaine – la définit me paraît extrêmement méprisable. Je suis partisan d’une vie sexuelle beaucoup plus libre, même si je n’ai pour ma part que fort peu usé de cette liberté » [10].
En effet, la seule liberté que Freud s’octroyait semble avoir été, outre ses cigares, les quelques vacances prises sans celle qu’il appelle « ma vieille bien-aimée », Martha, son épouse. Celle-ci a alors 47 ans quand, en 1908, Freud part l’été à Londres visiter la National Gallery puis se reposer au bord du lac de Garde. Il s’enchante de la liberté de se promener dans Hyde Park et de la liberté qu’il perçoit dans ce pays où « rien est interdit et où pourtant tout se passe de la manière la plus convenable qui soit » [11]. Et il s’agace un peu des lettres de son épouse qui voudrait qu’il rentre vite à Vienne : « le ton de tes lettres commence à ressembler à une mise en demeure » [12].
Mais laissons cela et revenons à notre texte. Sa trame est simplissime. Elle est la conséquence de ses Trois essais sur la théorie de la sexualité. Il y a la libido ; la restriction de la vie amoureuse génère l’angoisse ; la femme insatisfaite devient névrosée ; l’homme abstinent perd toute énergie et alimente la troupe de « ces honnêtes gens faibles qui disparaissent dans la grande masse ».
Impuissance côté mâle, frigidité côté femme sont les conséquences de la morale viennoise que dénonce Freud ici, de façon véritablement révolutionnaire. Et la psychanalyse qu’il invente est l’outil qui va permettre à celui qui s’y engage de briser ces chaînes. « Un homme dans la trentaine nous apparaît, écrit-il comme un individu juvénile, plutôt inachevé dont nous attendons qu’il utilise vigoureusement les possibilités de développement que lui ouvre la psychanalyse » [13]. Pour la femme, Freud est moins optimiste, ce « continent noir » le laisse perplexe. « Une femme du même âge nous effraie fréquemment par sa rigidité psychique et son immuabilité » [14]. On sait qu’il sera contredit par ses jeunes consœurs qu’il aura contribué à former, dans le grand débat sur la féminité qui explosera au tournant des années 20. On sait aussi que Lacan reprendra cette question à nouveaux frais, soulignant au contraire la plasticité de la position féminine et l’itération obstinée de la jouissance chez l’homme, seule fidélité à laquelle il soit véritablement lié.
Alors finalement, oui : gais, gais, marions-nous, mais libérés ou au moins un peu dénoués des mâchoires cruelles de l’Œdipe.
______________________
Pierre-Gilles Guéguen : Dans cette séquence qui-m’a-ton dit s’intitule « No Sex », je vais tenter de vous parler d’amour puisque selon le dicton Lacanien « quand on parle d’amour il ne s’agit pas de sexe ».
Nous avons donc accepté de jouer à commenter une phrase, chacun dans son style.
C’est une phrase qui se trouve au début d’un texte qui s’appelle « La morale sexuelle ‘‘civilisée’’ et la maladie nerveuse des temps modernes ».
Cette phrase, je la répète : « La désillusion mentale et la privation physique qui deviennent ainsi le destin de la plupart des mariages ramènent les deux époux à leur situation d’avant le mariage : ils se trouvent seulement appauvris d’une illusion » [15].
Cher Pierre, tu m’as confié la tâche d’explorer si Lacan nous donnait sur le mariage une perspective plus optimiste que celle de Freud. Je relisais ces jours derniers le très beau livre de Catherine Millot intitulé La vie avec Lacan [16]. Il pétille comme elle d’une intelligence lumineuse et d’une simplicité vraie doublée d’une retenue pudique. Elle y parle du temps où elle a « accompagné » Lacan – c’est son expression. Il était septuagénaire elle entrait dans la trentaine. J’ai relevé pour notre entretien de ce matin quelques bonheurs d’expression qui sont aussi des caresses, des paroles d’amour pour le partenaire de cette relation vécue hors des conventions, c’est le moins qu’on puisse dire. Non pas qu’elle n’ait pas eu ses orages mais il me semble d’après ce récit que ce couple hors-mariage a pu à sa façon « faire l’amour plus digne » [17].
Ainsi dans le portrait de Lacan qu’elle dessine, sa jeune amante d’alors ne laisse paraître aucune privation physique ni de son côté ni de celui de son partenaire – ces deux-là sont joyeux et heureux d’être ensemble – ni nostalgie ni culpabilité due à la différence d’âge.
Entre 1908 et 1973 on peut observer deux styles, deux modes de vie et de jouissance opposés chez deux hommes à peu près du même âge : Freud « l’uxorieux » nostalgique et Lacan « l’homme à femmes » nullement déçu – semble-t-il – de ses mariages ratés pas plus que des femmes qu’il avait aimées.
Lacan a souvent moqué Freud pour son attachement excessif à son épouse et aussi à Marie Bonaparte, que lui détestait. Martha Bernays, que les biographes décrivent comme la mère attentionnée de six enfants et aussi comme une ménagère hors pair incarnait au début l’idéal féminin de Freud puis la ménagère bourgeoise qui lui pesait. Néanmoins, s’il avait semble-t-il, fait le deuil de leur couple par une sorte de divorce interne, Freud n’a pas quitté son foyer ni poursuivi une autre femme n’en déplaise à ceux qui auraient tant aimé lui reprocher une aventure avec sa belle-sœur Mina.
Pourtant Lacan lui aussi s’était marié et même deux fois… Une fois avec Malou Blondin et une autre fois en 1953 avec Sylvia Bataille. Sans entrer dans la discussion de savoir qui de Freud ou de Lacan a raison je rappellerai seulement que dans L’envers de la psychanalyse on trouve cette remarque : « C’était vraiment un type charmant que Freud. Il était vraiment tout feu, tout flamme. Il avait aussi des faiblesses. Son rapport avec sa femme, par exemple, est quelque chose d’inimaginable. D’avoir toléré une pareille morue toute son existence, c’est quelque chose » [18] ! Morue : femme facile et conne mais sure d’elle et hargneuse, fouteuse de merde, terme souvent utilisé par Audiard, dit un dictionnaire d’argot trouvé sur internet.
« Le point où Lacan se tenait dans son rapport à l’Autre, rapporte Catherine Millot, était celui de l’irréductible solitude de chacun, voisin du lieu où l’existence confine à la douleur ». Mais Lacan, à la différence de Freud « savait y faire avec les femmes ».
La jeune femme amoureuse avait, tout au début de leur rencontre un été en Italie, éprouvé une énamoration qui surévaluait le partenaire comme il est fréquent – « Il fut un temps où j’avais le sentiment d’avoir saisi Lacan, l’être de Lacan de l’intérieur […] ce sentiment de l’avoir saisi de l’intérieur allait de pair avec l’impression d’être tout entière incluse dans une sienne compréhension dont, l’étendue me dépassait ».
Elle ne tarda pas à saisir que pour Lacan ce n’était pas la déception nostalgique de Freud qui était en cause mais ce qu’elle appelle plusieurs fois dans le livre sa recherche absolue du réel et qui seule le faisait courber. Elle le signale notamment ainsi : « De retour à Paris, nous ne nous étions […] plus quittés. Mais quand je dis ‘‘nous’’, j’ai le sentiment d’une fausse note. Il y avait lui, Lacan, et moi qui le suivais […]. D’ailleurs, si le ‘‘nous’’ ne m’a jamais été tout à fait naturel, à Lacan, il était profondément étranger » [19]. Elle confie aussi qu’elle a rapidement saisi que « Lacan n’avait pas de psychologie. Il n’avait pas d’arrière-pensées, il ne prêtait pas d’attention à l’autre. Sa simplicité tenait aussi à ce qu’il n’hésitait pas à demander ce qu’il voulait de la manière la plus directe. »
Il me semble que ces brèves notations rapportées de ce livre si extraordinaire illustreraient, non seulement que la singularité de Freud n’était pas celle de Lacan bien sûr, mais aussi qu’après la grande mise en forme effectuée par Freud pour libérer hommes et femmes de son temps des contraintes d’une moralité étroite, Lacan, en faisant passer la psychanalyse au-delà de l’Œdipe a mis au monde une forme d’appréhension nouvelle de la rencontre entre les sexes : celle où le (la) partenaire est averti du non-rapport sexuel. Peut-être est-ce ce que Dominique Laurent nommait récemment au-delà encore du partenaire-symptôme le partenaire-jouissance. Peut-être aussi est-ce quelque chose de cet ordre que Lacan tentait d’exprimer à Catherine lorsqu’il lui disait qu’il avait pour elle un « Amour-goût ». Le récit de cet amour-là, hors de la norme, nous signale à quel point les remaniements actuels de la famille patriarcale dépassent nos préjugés mais rien n’interdit de se servir du mariage pour pouvoir éventuellement aussi s’en passer qu’il soit homo ou hétérosexuel. Les semblants façonnent nos vies et les arrangements possibles de nos jouissances. Alors marions-nous gaiement mais tâchons de savoir-faire avec le non-rapport sexuel entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les femmes et entre les hommes et les hommes. Comme il vous plaira…
[1] Freud S., « La morale sexuelle ‘‘civilisée’’ et la maladie nerveuse des temps modernes », La vie sexuelle, Paris, PUF, 1970, p. 39.
[2] Duetto lors des 48e Journées de l’ECF, le 16 novembre 2018.
[3] Freud S., « La morale sexuelle ‘‘civilisée’’ et la maladie nerveuse des temps modernes », op. cit., p. 39.
[4] Freud S., « Contributions à la psychologie de la vie amoureuse », La vie sexuelle, op. cit., p. 80.
[5] Ibid., p. 78.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre II, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1978, p. 302-303.
[7] Ibid., p. 303.
[8] Freud S., Correspondance avec le pasteur Pfister 1909-1939, Paris, Gallimard, 1966, p. 44.
[9] Freud S., « La morale sexuelle ‘‘civilisée’’ et la maladie nerveuse des temps modernes », op. cit., p. 39.
[10] Putnam J. J., L’introduction de la psychanalyse aux États-Unis. Autour de J. Putnam. Correspondance de James Jackson Putnam avec Freud, Jones, Ferenczi, William James et Morton Prince, Paris, Gallimard, 1971, p. 88.
[11] Freud S., Notre cœur tend vers le Sud. Correspondance de voyage 1895-1923, Paris, Fayard, 2005, p. 229.
[12] Ibid., p. 230.
[13] Freud S., Nouvelles conférences sur la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1984, p. 145.
[14] Ibid.
[15] Freud S., « La morale sexuelle ‘‘civilisée’’ et la maladie nerveuse des temps modernes », op. cit., p. 39.
[16] Millot C., La vie avec Lacan, Paris, Gallimard, 2016.
[17] Lacan J., « Note italienne », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 311.
[18] Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 200.
[19] Millot C., La vie avec Lacan, op. cit., p. 27.