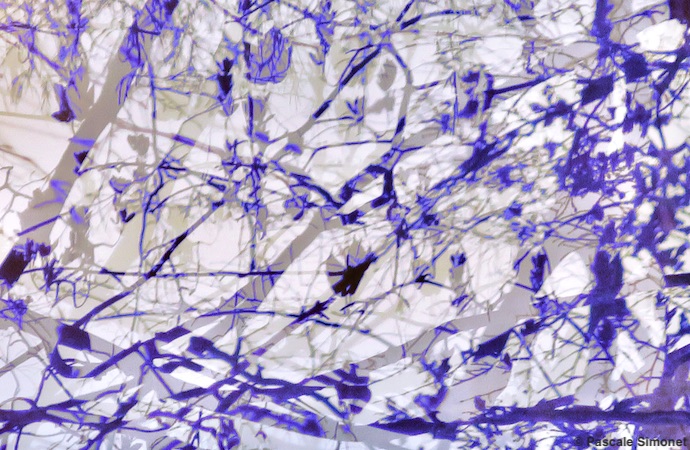La « pluie d’objets » [1] tombe sans discontinuer. Elle ruisselle sur les fantasmes et se branche sur cette parure de vérité qui « s’y accroche, l’entoure, et s’accumule » [2] à l’objet a. Certains, branchés, se déconnectent de la jouissance, autiste. D’autres filtrent l’Autre envahissant. C’est le vrai grand remplacement : « le mensonge de la civilisation, écrit Éric Laurent, […] dans cet échange entre la singularité de l’extraction [de l’objet a] et ce qui est proposé industriellement » [3].
En addictologie, on substitue les opiacés autorisés à d’autres, interdits ou détournés. On vante leur cinétique lente, évitant le manque. Ils auraient aussi un effet favorable sur des symptomatologies psychotiques. Or c’est une substitution de substitution puisqu’on supprime la pulsation artificielle du manque inhérent aux drogues de demi-vies plus courtes, sans parler de l’animation produite par la quête du produit : un battement, évanouissement et renaissance, évoquant une fonction phallique nativement carente à l’origine d’un sentiment de la vie défaillant. D’où la dépression qui, sans le transfert et un désir thérapeutique nettoyé de ses scories, réapparaît. Car, comme le disait Lacan aux psychiatres, « il se produit là des choses nouvelles : on obnubile, on tempère, on interfère ou modifie… Mais on ne sait pas du tout ce qu’on modifie, ni d’ailleurs où iront ces modifications, ni même le sens qu’elles ont ; puisqu’il s’agit de sens » [4].
Il n’en va pas autrement dans la consommation courante – gadgets et plus-de-jouir en toc : la substitution de ces bimbeloteries déçoit et l’on consomme… de l’espoir. Car l’infini de la production, au principe du capitalisme, reste dénombrable, comme le Un de l’addiction, et ne saurait se hausser au même cardinal d’infini – continu – que la jouissance propre du corps. Le concept de « substance jouissante » [5], inventé par Lacan dans son Séminaire Encore, dissout le dualisme cartésien de la substance étendue et de la substance pensante, pas sans rapport, remarque Miquel Bassols, avec la troisième substance cartésienne, justement infinie : la res infinita [6]. Ce Un de la consommation est même plus faible que ça, car si 1+1=1, comme le formule Jacques-Alain Miller [7], la consommation ne peut faire métaphore et pas même métonymie.
Il ne reste plus alors qu’à dénigrer la concurrence : ce sont les passions, le sexe et les sujets qui sont désormais qualifiés de toxiques. Où le wokisme s’avère l’idiot utile du capitalisme…
The truth is not in the pudding : pas dans les produits, si appréciés des addictologues, mais bien dans l’articulation du sujet et de la jouissance ; il n’y a pas de jouissance des substances : que de la substance jouissante ; et seul l’acte de parole pour l’a-border.
Pierre Sidon
_______________________________
[1] Miller J.-A., « Tombeau de l’homme-de-gauche », Le Monde, 3 décembre 2002.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XIV, La Logique du fantasme, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil/Le Champ freudien, p. 13.
[3] Laurent É., « Métamorphose et extraction de l’objet a », La Cause freudienne, n° 69, septembre 2008, p. 43.
[4] Lacan J., « Petit discours aux psychiatres », Conférence donnée au Cercle d’études psychiatriques, le 10 novembre 1967, inédit, retranscription disponible sur internet.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 26.
[6] Cf. Bassols M., « La substance jouissante », La Cause du désir, n° 94, novembre 2016, p. 171-176, disponible sur internet : https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-3-page-171.htm#re6no6
[7] Cf. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Un tout seul. », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 4 mai 2011, inédit.