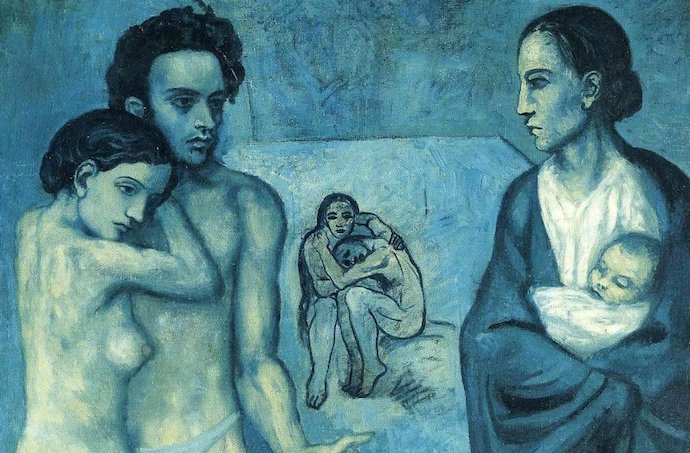« Des dissensions entre les parents eux-mêmes, les malheurs conjugaux de ceux‑ci conditionnent la prédisposition la plus grave à un développement sexuel perturbé
ou à une affection névrotique des enfants ».
Freud S., Trois essais sur la théorie de la sexualité
Daniel Roy : Chère Lilia, nous prenons Freud au sérieux, n’est-ce pas, et nous nous demandons comment accueillir ce verdict freudien sur l’avenir des enfants qui ont connu des querelles entre leurs parents ou, disons, toutes formes de manifestations de leur désunion au cœur de leur union [1]. En effet, en relisant cette phrase dans son contexte, nous saisissons qu’il s’agit d’un temps que les moins de cent ans ne peuvent pas connaître, un temps où l’union religieuse et civile du mariage se rompait dans de très rares occasions.
Alors, dans ce cadre, qui est celui de l’ordre patriarcal, c’est celui-ci même qui se trouve subir une grave distorsion quand ce qu’il paraît garantir, à savoir l’union d’un homme et d’une femme comme support des identifications et de l’amour pour leurs enfants, se trouve désavouée par cet homme et cette femme. En effet, dans la perspective œdipienne qui est la sienne, Freud conçoit de façon très explicite dans ce troisième essai sur la théorie sexuelle que « la découverte de l’objet », c’est-à-dire du partenaire sexuel, au cours de la métamorphose de la puberté prend appui sur ce qui s’est joué pour l’enfant, dans sa prime enfance. À savoir d’un côté, les liens d’amour et d’identification qu’il a pu nouer avec père et mère. Et de l’autre, comment il a pu s’en détacher, pour leur substituer des liens d’amour et de désir qui autorisent le sujet devenu grand à un libre exercice de « son besoin sexuel ».
La thèse de Freud dans ce chapitre est que « le lien qui unit (le sujet) à la famille est le seul qui soit déterminant » au temps de l’enfance et que, à l’adolescence, le sujet s’affronte à cette tâche complexe de se détacher de ce lien, de cette « inclination infantile », tout en prenant appui sur les traces qu’elle a laissées.
Et c’est dans ce contexte que cette inclination infantile, voie nécessaire, peut fonctionner comme un toxique violent en l’absence de « liens d’amour et de respect de la parole » entre cet homme et cette femme.
Alors chère Lilia, j’aurai envie de vous demander si, aujourd’hui, nous pourrions soutenir un tel verdict, alors que l’ordre patriarcal, qui réglait dans le social et dans le discours les unions des hommes et des femmes, n’offre plus sa supposée garantie et n’exerce plus sa loi de fer ?
Lilia Mahjoub : Ce passage se trouve en effet dans la partie intitulée « La découverte de l’objet » [2] et dans le sous-paragraphe « Effet ultérieur du choix d’objet infantile »[3].
Freud parle de la relation de l’enfant avec sa mère mais aussi avec ses deux parents. Pour Freud, « si les relations de l’enfant avec ses parents ont une telle importance pour le choix futur de l’objet sexuel, on comprend facilement que toute perturbation de ces relations de l’enfance ait les conséquences les plus graves sur la vie sexuelle après la maturité […] »[4]
Ceci concerne donc non pas les relations entre les parents mais surtout celles de l’enfant avec ceux-ci et les fantasmes inconscients qui se fomentent à cette période concernant la question de la sexualité, lesquels ont été refoulés et seront ravivés pour qu’émerge un fantasme articulant un objet sur lequel se fixera la libido.
Vous mettez l’accent sur les identifications qui en effet s’appuient sur les personnes de l’entourage et au premier plan le couple parental. Si l’on en reste au seul niveau de la relation triangulaire de l’Œdipe, bien sûr que ces identifications peuvent s’étayer (ou non) sur ce couple, mais cela n’est pas suffisant pour ce qu’il en sera de la question de l’objet dans le fantasme. Ici les identifications, si l’on prend les identifications articulées par Freud, s’appuient plutôt sur des traits signifiants, symptomatiques, comme il en va dans la névrose. Par exemple chez Dora le trait de la toux prélevé sur le père aimé.
Ce sont des identifications qui perturbent le choix de l’objet. Freud s’est là-dessus trompé avec Dora, en restant pris dans le modèle œdipien. Et en effet, c’est un modèle pris dans les préjugés de l’époque.
Quelques pages avant, Freud ajoutera en 1920 une note qui mérite d’être signalée. Il y parle des fantasmes de la puberté qui se greffent sur les recherches sexuelles infantiles abandonnées. Il y fait référence à l’homme aux rats et au roman familial du névrosé. J’ai relu la note [5] à laquelle il renvoie dans ledit cas. L’accent est mis sur le fantasme dans sa version imaginaire.
Ce patient de Freud est un grand névrosé et a un désir qu’on peut qualifier pour le moins d’impossible quant au choix d’objet féminin. Ce qui a déclenché sa névrose, c’est le réveil d’un conflit qui prend appui sur des identifications au père. Voici ce qu’on peut lire sous la plume de Freud : « Par des taquineries entre les époux, qui vivaient d’ailleurs dans une parfaite entente, notre patient apprit que son père, quelque temps avant de connaître sa mère avait courtisé une jeune fille d’une famille modeste, pauvre mais jolie. » [6] C’était la fille d’un boucher.
De son côté, devait-il rester fidèle à son amie pauvre ou bien suivre les traces de son père et épouser la jeune fille, belle, distinguée et riche qu’on lui destinait ? C’est un conflit qui s’étendra à bon nombre de ses relations, et qui montre bien, pour ce qu’il en est du fantasme inconscient, une fixation à l’érotisme anal, ce qui se révèlera dans et par le transfert.
Lacan commentera ce roman familial qu’il appellera « le mythe individuel du névrosé » [7] ou encore « la constellation originelle qui a présidé à la naissance du sujet » [8] et mettra en relief que le mythe et le fantasme se rejoignent. Il s’agit d’une situation de quatuor et non pas seulement réduite à celle de l’Œdipe qui, elle, est ternaire. L’objet est ici dédoublé (soit un dédoublement du partenaire sexuel) et empêche le sujet d’assumer quoique ce soit quant à ses responsabilités ou ses choix.
Comme l’écrivait une petite fille dans son journal, lu à l’époque par Freud, à propos de l’expression qu’elle avait entendue, soit « relations sexuelles » : « lorsqu’on parle de relations on sait déjà que cela a un sens, mais sexuel, voilà la question. » [9]
Ainsi, cher Daniel, ce n’est pas tant des dissensions, même à cette époque (l’homme aux rats a des parents qui s’entendent au mieux), qui ont un impact sur sa sexualité mais bien plutôt la façon dont la libido de ce sujet s’est fixée dans un fantasme pour répondre à l’insondable question du rapport sexuel. Qu’en pensez-vous ?
D.R. : Chère Lilia, vos remarques et la mise en valeur des enjeux de ces questions pour ces deux patients de Freud résonnent de façon très précise avec une petite phrase qui suit la nôtre, où Freud énonce que « d’autres éléments de même origine (c’est-à-dire infantile) permettent à l’homme de développer plus d’une série sexuelle, de forger pour son choix d’objet des déterminants tout à fait différents ». Ainsi c’est souvent dans l’après-coup, dans le moment où le sujet a relevé le gant de sa valeur sexuelle, qu’apparaît la position qu’il a prise, enfant, face aux évènements auxquels il a été confronté et le nouage qui s’est opéré avec une valeur de jouissance pulsionnelle qui lui est tout à fait singulière (ce que le fantasme recueillera).
Mais si vous voulez bien, prenons les choses sous un autre angle. Aujourd’hui, les dissensions et les séparations sont le lot quotidien, hommes et femmes s’unissent et se désunissent à leur gré, bon gré – mal gré ; le malentendu est devenu la règle dans la rencontre des amours, des désirs et des jouissances ; c’est le règne du « malentendu accompli » selon le terme proposé par Lacan dans sa leçon du 10 juin 1980 [10], malentendu qui est transmis par les parlêtres à leur « progéniture » : « Le parlêtre en question se répartit en général en deux parlants. Deux parlants qui ne parlent pas la même langue. Deux qui ne s’entendent pas parler. Deux qui ne s’entendent pas tout court. Deux qui se conjurent pour la reproduction, mais d’un malentendu accompli, que votre corps véhiculera avec la dite reproduction. »
Cette leçon me paraît très éclairante pour notre propos. D’une certaine façon, Lacan fait de cette transmission du malentendu la règle ; et alors ce qui frappe désormais dans les dispositifs qui s’élaborent dans le social, c’est que la discordance notée par Freud à l’intérieur de l’union des partenaires s’est déplacée vers une discordance entre « le couple conjugal », soumis allègrement au malentendu entre les partenaires, et « le couple parental », qui cherche à afficher une entente la meilleure possible pour « le bien des enfants ». Quelles conséquences pouvons-nous constater chez les enfants ?
L.M. : Cher Daniel, je suis tout à fait d’accord, c’est éclairant. Mais je ne pense pas qu’il y ait plus de dissensions aujourd’hui dans un couple qu’à l’époque de Freud. De plus, ce n’est pas parce que le divorce était moins courant que les dissensions d’alors avaient plus d’impact. Par contre, « le malentendu accompli », très jolie formule, a toujours fonctionné même dans les couples sans dissensions, sans querelles. C’est ce malentendu propre à toute rencontre qui en effet « donne l’illusion que le rapport sexuel cesse de ne pas s’écrire » [11] ; c’est cette illusion qui veut se poursuivre dans l’amour censé régner dans la famille et qui veut faire croire, aujourd’hui où l’on croit à la réalisation sexuelle, que tout va pour le mieux. Les conséquences, on le voit, se trouvent en effet du côté des enfants auxquels la vérité est cachée et voilà pourquoi Lacan ramenait la vérité dans les relations du couple dans sa fameuse « Note sur l’enfant », avec l’enfant-symptôme comme représentant « la vérité du couple familial » [12].
Une jeune fille de quatorze ans me rapportait ses rêves où insistait un fantasme, la séparation violente de ses parents et leur divorce. Ils travaillaient ensemble voire volaient ensemble (en tant que personnel naviguant d’une compagnie aérienne) et ce mot « voler » avait de nombreuses résonances pour elle dont celui de « convoler », terme que l’on n’entend plus beaucoup de nos jours. L’entente constante et harmonieuse de ceux-ci était patente mais aussi mentait, c’est-à-dire obturait ce malentendu fondamental qu’est l’impossible du rapport sexuel, et à l’égard de quoi notre jeune patiente avait à apporter sa propre réponse.
Prenons encore le cas de ce petit garçon de huit ans qui affiche des refus, des oppositions menant à de grands désordres à la maison comme à l’école et qui refuse tout autant de me parler le jour où ses parents me l’amènent. Il consentira cependant à rester pour écouter ceux‑ci, enjoignant son père de ne pas s’asseoir à côté de lui, alors que c’est avec celui-ci qu’il a la relation la plus proche. La relation avec sa mère, plus absente du fait de son travail, s’avère plus complexe.
Au fur et à mesure de ce qui se disait, cet enfant ne cessait de s’agiter, et je décidais de lui dire qu’il avait le choix de rester dans mon bureau où il était question de parler pour le moment avec ses parents, ou d’aller dans la salle d’attente. Ce qu’il finit par faire. Je fis part aux parents de ce qui ressortait de nos échanges, une question insistante de séparation pour leur enfant et que peut-être fallait-il qu’ils la prennent en considération dans leur vie avec celui-ci. La mère se mit alors à pleurer me disant que leur couple n’allait pas bien et que, depuis quelques temps, chacun à son tour s’absentait pendant deux mois de la maison, mais qu’ils n’avaient rien dit à leurs enfants pour ne pas les perturber.
Cher Daniel, ne pensez-vous pas que l’important ce n’est pas tant les formes de couple, les querelles ou l’harmonie qui y règnent, mais bien plutôt ce qui s’entend dans ce qui se dit ou ne se dit pas et qui est à mettre en rapport avec l’énigme du désir de l’Autre, désir dont le sujet portera la marque, ce que soulignait Lacan dans sa « Conférence à Genève sur le symptôme » [13] en 1975 ?
Lacan qui lit Freud nous donne cette orientation. En effet, la reproduction ne se confondant pas avec la sexualité, ainsi que Freud l’articule, le malentendu sera véhiculé via la reproduction des corps.
D.R. : D’autant plus d’accord, chère Lilia, que Lacan précise dans cette leçon de 1980 que ce malentendu « c’est de cela dont vous héritez. Votre lignée, c’est ce qu’elle vous a transmis en vous “donnant la vie”, comme on dit ». Néanmoins, je voudrai revenir sur ma remarque inaugurale à propos de ce que je nommais « le verdict freudien ». Il me semble en effet que Lacan vise un tel point, par sa voie propre, quand il énonce, dans cette même leçon, que « le principe de la famille ne s’inscrit que du symbolique ». De fait, dès qu’il y a famille, quelles qu’en soient les incarnations dans la réalité, le symbolique est convoqué et c’est ce qui fait dire à Lacan que « le mensonge de la conduite », de la part de ceux qui incarnent les fonctions de père ou de mère est perçu par l’enfant « jusqu’au ravage »[14]. C’est en ce point que résonne le « verdict lacanien », que ce qui est rejeté du symbolique fait retour dans le réel. Je ne l’entends pas ici dans la perspective d’un pronostic, mais dans celui de l’accueil que nous faisons de sujets, enfants et adultes, qui ont eu à se confronter plus tôt que d’autres à la « position d’objet partiel », voire de déchet de la jouissance de leurs géniteurs, condition certes commune à nous tous, mais de préférence habillée des semblants que permet leur « bafouillage ».
L.M. : En effet, ce qui fait les liens familiaux s’inscrit dans le symbolique. Ce qui n’est plus à démontrer depuis Claude Lévi-Strauss. C’est pourquoi, comme vous le soulignez, quel que soit le type de famille, sa composition, deux mères, deux pères, et j’en passe, nous nageons dans le symbolique, ce sont des productions humaines qui relèvent de cet ordre. Le psychanalyste, s’il en tient compte, ne s’y enferme point et prend en considération l’imaginaire et le réel, ainsi que Lacan nous y a rompu. D’où que la sexualité ne soit pas toute prise dans le symbolique et que celui-ci n’ait en ce qui la concerne aucune prévalence sur les deux autres registres.
[1] Duetto lors des 48e Journées de l’ECF, le 16 novembre 2018
[2] Freud S., Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris, Gallimard, Collection Folio/Essais, 1987, p. 164.
[3] Ibid., p. 173.
[4] Ibid.
[5] Freud S., « Remarques sur un cas de névrose obsessionnelle (L’homme aux rats) », Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 1973, note 2, pp. 233-234.
[6] Ibid., p. 228.
[7] Lacan J., Le mythe individuel du névrosé, Paris, Seuil, novembre 2007.
[8] Ibid., p. 20.
[9] « Journal Psychanalytique d’une petite fille », Paris, Collection Freud et son temps, Denoël, 1975, p. 164.
[10] Lacan J., « Le malentendu », Ornicar ?, Lyse édition, n° 22-23, Printemps 1981.
[11] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 132.
[12] Lacan J., « Note sur l’enfant », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 373.
[13] Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme », bloc-notes de la psychanalyse, Genève, n° 5, 1985, p. 11.
[14] Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 579.