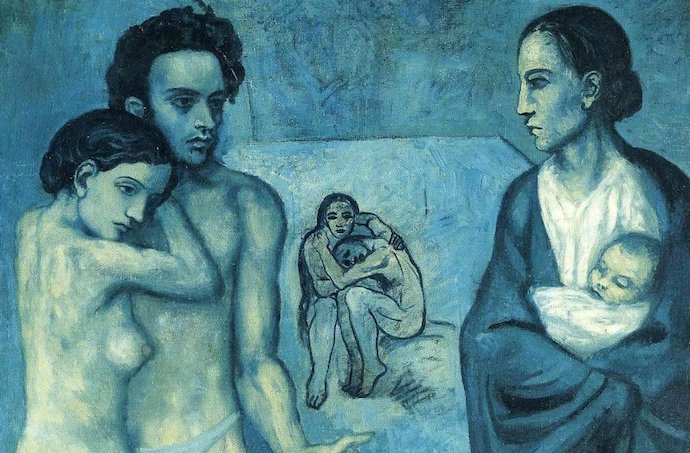Les ratages : entre idéaux parentaux et jouissance
Les Lepic et les Bouley : deux familles, deux modèles éducatifs opposés, telles sont les coordonnées de départ de la série [1]. Leur point commun ? Le ratage…
La série se moque du narcissisme des parents qui croient aux bienfaits de leur modèle éducatif alors qu’ils se montrent assez peu civilisés eux‑mêmes.
Les premières minutes de l’épisode pilote : « la rentrée des classes », illustrent que si la famille a comme fonction de limiter les excès des enfants pour le « vivre ensemble », s’y loge aussi une part d’indomptable pour chacun. Les parents eux-mêmes sont débordés par quelque chose de « plus fort qu’eux ». À l’origine, la série devait s’intituler « Peut mieux faire ». Ce titre inverse le rapport évaluatif, il indique que les parents sont également soumis à des impératifs : plus ils croient aux modèles éducatifs et tâchent de les faire fonctionner, plus cela rate et plus ils sont débordés. Ainsi, Valérie Bouley, qui se retrouve à insulter d’autres en voiture devant ses enfants, est loin d’incarner l’exemple qu’elle voudrait être pour ses enfants et Fabienne Lepic, qui indique que jusqu’en 321, les romains pouvaient tuer leurs enfants, n’est pas juste une mère au foyer dévouée.
Le ratage des parents souligne donc le caractère illusoire des idéaux éducatifs. Inadéquation entre ce qu’ils veulent pour le bien de leur(s) enfant(s) et ce à quoi ils se sentent eux-mêmes obligés et le désir singulier de chacun des enfants. Ainsi, Renaud Lepic, le père, fier d’avoir fait sup de co’, expert de l’organisation, sort toujours son tableau pour remédier aux problèmes que les membres de la famille rencontrent maisn il s’épuise à essayer d’intéresser son fils au savoir scolaire.
De même, Valérie perçoit les limites de son modèle d’éducation basé sur la communication et qui se retourne contre elle. Elle parie que la parole pourrait tout, serait sans faille et elle se retrouve très coupable d’avoir giflé sa fille qui lui a adressé une phrase insupportable sur sa féminité. Elle en appelle à son mari, beau-père de Typhaine, qui va édicter le RIP : Règlement Intérieur Personnalisé [2].
« Toute formation humaine, dit Jacques Lacan, a pour essence […] de réfréner la jouissance » [3]. La famille « habillée » de son modèle éducatif a comme fonction de faire limite à la jouissance. Pourtant, paradoxe, ce que montre la série, c’est qu’en même temps, elle la dévoile. C’est l’envers des règles universelles. Renaud Lepic agacé par une de ses filles qui l’épingle sur ses contradictions, lui dit : « Dans la vie il y a ce qu’on dit à ses enfants et il y a ce qu’on fait en réalité parce que si tu fais que ce que tu dis à tes enfants, eh ben tu serais… »[4] Renaud Lepic ne boucle pas sa phrase et, dans un moment de vérité, laisse entendre qu’il vaut mieux des inadéquations, des ratés ! En effet, c’est dans ces espaces que peuvent se loger les sujets, au‑delà de leur identification à être parents ou enfants. La série illustre fort bien que les ratages éducatifs font place à des moments où les parents consentent à rencontrer la singularité de leur enfant et y répondent. Elle met en valeur ce que Lacan appelait « l’irréductible d’une transmission – qui est d’un autre ordre que celle de la vie selon les satisfactions des besoins – mais qui est d’une constitution subjective impliquant la relation à un désir qui ne soit pas anonyme »[5].
Un désir qui ne soit pas anonyme
Ainsi, Renaud transmet à son fils un discours sur l’amour [6] et lui apprend qu’un homme n’a pas à avoir honte de son manque, c’est même ce qui fait sa force. Il lui dit aussi sa fierté sur son parcours alors qu’auparavant il se désespérait de voir son fils n’avoir aucune ambition et arrêter ses études. Ce lâchage sur l’idéal et la jouissance pour une ouverture sur le désir tient au fait que Renaud Lepic découvre pour lui-même que ce qu’il voulait, être le numéro 1 de son entreprise, n’était pas ce qu’il désirait[7].
De même, Valérie Bouley consent à ce que sa fille devienne gardien de la paix alors qu’elle l’interprétait comme un ratage de sa fonction de mère, car à l’inverse de ses idéaux[8].
Quant à Fabienne Lepic, elle accepte l’homosexualité de sa fille Charlotte en célébrant un mariage gay en tant qu’adjointe au maire au risque de perdre sa place au futur conseil municipal[9].
Ces exemples ont comme point commun d’illustrer comment les parents acceptent, non sans mal ou douleur quelque fois, de céder sur ce qu’ils veulent pour leurs enfants. Fabienne Lepic ponctue : « on s’assouplit, mais on n’est pas contorsionnistes ». En somme, ils se sont cognés au ratage des idéaux éducatifs et des modes d’emploi sur la parentalité mais surtout ils ont su rencontrer un désir singulier chez leur enfant auquel ils consentent. Au-delà de tout précepte, accueillir cette différence, dire oui à cette altérité me semble situer un authentique et invariant pilier de la transmission parentale : faire don de son manque plutôt que de ses idéaux. Cette transmission – d’un désir qui ne soit pas anonyme – conserve sa valeur quelle que soit l’époque et quelle que soit la façon d’être père, d’être mère.
Les beaux jours du couple
Le deuxième enseignement essentiel que révèle Fais pas ci, Fais pas ça, c’est le caractère invariant du couple[10]. On pourrait en être surpris à l’époque des nouveaux liens de filiation et du caractère multiple que prennent les constellations familiales. Si la norme et le style du couple se transforme, la structure reste, elle, inchangée. Lors de la dernière saison, une ellipse amène les personnages en 2027 : Charlotte Lepic, homosexuelle, fait famille avec sa compagne et leurs enfants.
Plus encore. Si les acteurs ont consenti à ce que Valérie Bouley vive une relation extra‑conjugale, on apprend dans un documentaire [11] sur la série qu’ils ont refusé que le couple se sépare ! Les scénaristes ont dû revoir leur programme ! Au-delà de l’idéal de la famille unie, quelle est donc la valeur donnée au couple alors même que ce lien s’avère toujours inadéquat, non complémentaire, impossible, insatisfaisant ? Alors même qu’on s’aperçoit avec la série que les couples ne s’entendent pas, c’est-à-dire qu’ils ne font pas Un ?
Tels Denis et Valérie Bouley qui se réconcilient en se fâchant contre leurs enfants, car ceux-ci se plaignaient de leur dispute [12]. Il n’est pas question pour eux que leurs enfants les empêchent d’être un couple conjugal. C’est dans la dispute qu’ils peuvent faire rapport, c’est-à-dire dans leur désaccord que le rapport peut s’écrire. Il se dispute pour mieux se réconcilier !
Le non-rapport, c’est finalement le dénominateur commun pour chacun des membres d’une famille, tout autant que pour le couple. Alors qu’est-ce qui fait que le désir de faire couple et de faire famille reste aussi vif ? Les êtres parlants s’appareillent à des partenaires pour mieux supporter leur foncière solitude et nommer leur être. Le couple et la famille semblent permettre à certains de résoudre la question énigmatique de l’être et d’inventer avec d’autres leur façon d’être au monde, chacun selon son style.
En effet, l’invention n’est-elle pas le maître-mot de tout rapport, de tout lien ? Entre homme et femme, entre deux hommes, entre deux femmes, entre un parent et son enfant ?
La discussion entre les enfants des deux familles devenus adultes, dans l’épisode clôturant la dernière saison de la série[13], nous enseigne que chacun s’invente son roman familial. Chaque enfant se plaint de ses parents qui l’ont si mal foutu, rêvant et idéalisant des parents idéaux chez les voisins. Ce n’est pas tant la vérité qui compte mais cela indique à quoi sert la famille : parce qu’il y a de structure un ratage, la famille sert aux mythes individuels, ceux que chacun s’invente pour répondre au trou dans le savoir, sur ce que serait être homme ou femme, ce que serait aimer un homme ou une femme.
La famille permet l’invention mais n’est jamais adéquate ou satisfaisante. Elle voile le trou qu’ouvrent les questions du sexuel, de la procréation, de l’origine. C’est pourquoi l’on pourrait dire que la famille, on s’en plaint mais on y tient !
[1] Intervention lors du colloque du CPCT-parents à Rennes, « Faire famille au 21e siècle ? », le 8 décembre 2017.
[2] « Les bonnes résolutions », Fais pas ci, fais pas ça, saison 1, épisode 4, 2007.
[3] Lacan J., « Allocution sur les psychoses de l’enfant », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 364.
[4] « Mamie blues », Fais pas ci, fais pas ça, saison 6, épisode 2, 2013.
[5] Lacan J., « Note sur l’enfant », Autres écrits, op. cit., p. 373.
[6] « Engagez-vous ! », Fais pas ci, fais pas ça, saison 4, épisode 8, 2011.
[7] « Le joker connerie », Fais pas ci, fais pas ça, saison 5, épisode 8, 2012.
[8] « La surprise du chef », Fais pas ci, fais pas ça, saison 8, épisode 3, 2016.
[9] « La naissance des méduses », Fais pas ci, fais pas ça, saison 7, épisode 3, 2014.
[10] Deffieux J.-P., « La famille est-elle nécessairement œdipienne ? », disponible sur internet à l’adresse suivante : http://www.causefreudienne.net/la-famille-est-elle-necessairement-oedipienne/
[11] « Fais pas ci, fais pas ça, une famille pour la vie », documentaire disponible sur le site internet YouTube à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=V8sC8pprtd8
[12] « Les limites et les bornes », Fais pas ci, fais pas ça, saison 4, épisode 3, 2011.
[13] « Nous vieillirons ensemble », Fais pas ci, fais pas ça, saison 9, épisode 5/6, 2017.