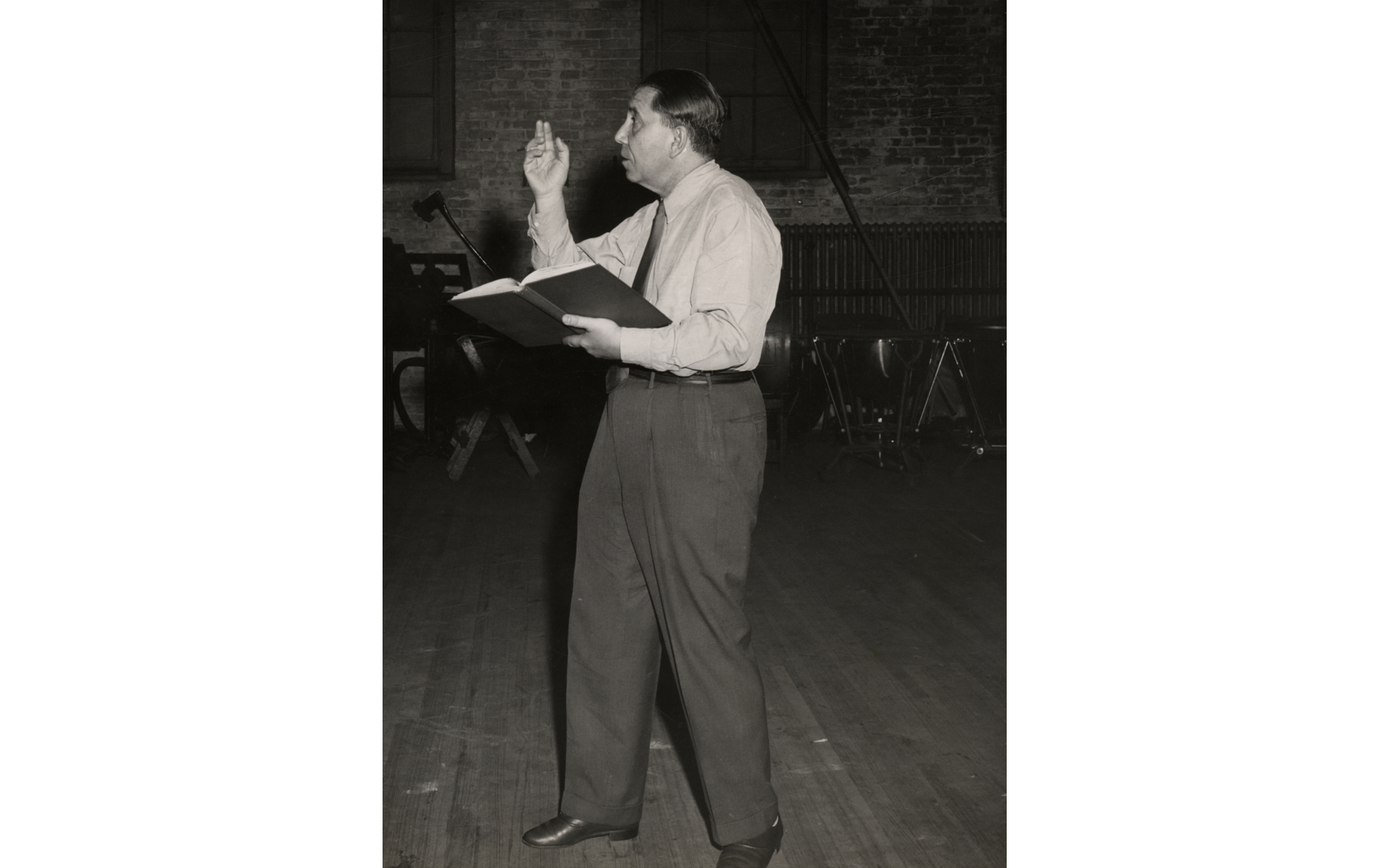L’Hebdo-Blog – L’actualité semble indiquer que le dit déni de grossesse est plus fréquent qu’il ne l’a été. Est-ce une réalité selon vous? Le délitement des discours, la réification de l’enfant comme objet par les techniques et le marché n’ouvrent-ils pas la voie à une plus grande fragilité subjective chez certaines femmes ? Le déni de grossesse peut-il apparaître alors comme le retour dans le réel de ce que forclos le discours capitaliste ?
Francesca Biagi-Chai – Le dit déni de grossesse nous renvoie à un phénomène de corps. Indexé du signe négatif, tout comme l’hallucination négative, il ne relève pas moins du réel forclos du symbolique. Le phénomène de corps que l’on peut identifier comme un événement de corps négatif, à savoir la disparition des sensations propres à faire signifier la maternité, portées depuis toujours par le discours commun, de fait, efface celui-ci et introduit à la dimension de l’étrangeté.
En tant que non-effet il est de tout temps et le cas de la jeune Catherine Ozanne que l’on a pendue sur la place du marché de Meulan le démontre. Elle n’a pas eu d’enfant puisqu’elle ne l’a pas senti, elle ne l’a pas tué puisqu’il n’a pas crié, elle l’a simplement amené sans vie dans la rivière. Donc, il s’agit moins, dans notre actualité, de fréquence que de ce qui rend de manière générale les symptômes visibles, ce qui les dénude, contrairement à ce qui les habillait dans un tissu social capable de les intégrer, de leur faire une place. Le terme « déni de grossesse » nomme et fait exister la possibilité d’une non-reconnaissance de la maternité, dans une non-connaissance du corps propre en tant que corps féminin, susceptible de l’accueillir. Mais cette nomination reste ambigüe et laisse planer l’idée d’un refus et non d’un réel qui s’impose, un réel qu’il conviendrait de situer à sa place, là où il se substitue à l’objet a quand celui-ci n’est pas comme tel découpé par l’érotique du corps. Au XXIe siècle, les symptômes sont identifiés, mais abandonnés au réel sans loi, livrés au hors-discours, ou récupérés dans un discours médicalisé, autrement dit, dans un discours qui les compte sans les faire compter.
C’est aussi ce que l’on peut dire de chacun dans le discours capitaliste. Le signifiant-maître traverse le sujet annulé, y substituant son propre savoir, ou plus exactement sa volonté et conduisant le sujet à produire des objets qui ne sont plus en rapport avec lui. Le corps peut dans ce cas occuper lui-même la place du produit. Les performances de l’extrême, automutilations, tatouages, qui sont autant de tentatives pour que le sujet se le réapproprie, en témoignent. Notre époque va vers une destitution de la parole dans sa fonction transcendantale et fondatrice, elle devient l’instrument du discours du capitalisme, accompagnée par le chant des scientistes. La fréquence des symptômes du corps apparait donc plus importante puisque l’autre de la science tente de se le réapproprier. Le corps libidinal écrase le désir sur la jouissance de l’Un, sur une jouissance autonome. Alors l’interprétation est ouverte à tous les sens, à tous les possibles, autant dire à aucun et le réel apparait dans sa crudité. La réification de l’enfant, dont vous me parlez, n’a d’égal que celle du sujet hypermoderne auquel la femme, hélas, ne semble pas s’excepter, ce qui va de pair avec le monde de l’Un. La critique que nous faisons de l’usage plaqué du dit déni de grossesse ouvre sur une perspective, une ligne de fuite qui fait place au singulier, c’est-à-dire à un au-delà de la structure, dans le rapport de chacune au signifiant de la maternité comme au corps propre. Le discours capitaliste n’appelle-t-il pas le règne de l’enfant généralisé ? Celui de l’analyste restaure le féminin, ici, la prise en compte de la jouissance propre à chacun, comme avenir de l’homme.
* Biagi-Chai F., « Du fameux déni de grossesse », Être Mère, Des femmes psychanalystes parlent de la maternité, sous la direction de Christiane Alberti, Navarin, Le Champ freudien, p. 171.