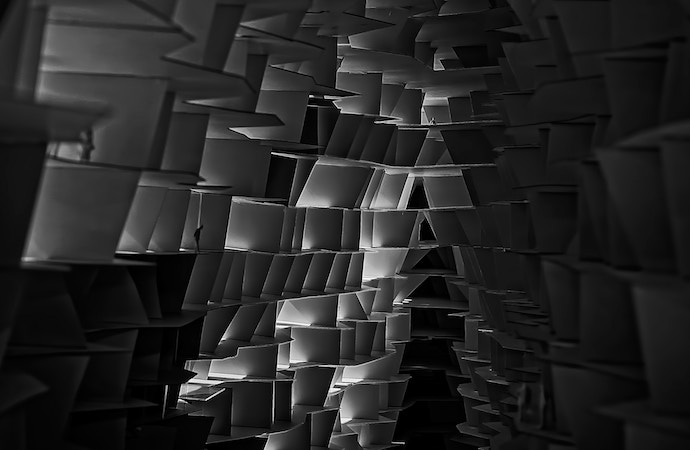Consentir à occuper un poste de psychologue en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes *, Ehpad, implique, pour celui qui oriente sa pratique de la psychanalyse, de repérer à quel discours il est appelé à collaborer [1].
Depuis 2009 il est possible et recommandé de déplacer un résident accueilli en Ehpad vers une unité d’hébergement renforcée (UHR). C’est la réponse préconisée par les politiques publiques au poids que représente pour le soignant les passages à l’acte, insultes, fugues, comportements violents des résidents.
Patrice, est un homme de 75 ans accueilli en Ehpad. Patrice accuse un des professionnels de mal le traiter. Il se plaint à sa famille, à la direction. Cela pose question à la direction qui souhaite apporter un traitement efficace du problème. Doit-on sanctionner le personnel ou déplacer Patrice ? Patrice est-il maltraité ou est-ce un affabulateur ? Les choses s’emballent, les récriminations de Patrice laissent place aux coups. Sans que l’on parvienne à repérer le pourquoi du comment, Patrice se met à cogner quelques résidents et personnel.
Un temps clinique a lieu juste après un coup porté par Patrice, une soignante prend la parole pour dire : « y’a rien à dire, on ne peut pas l’accueillir ici, là il cogne sans raison, il n’a pas sa place ici ; il faut qu’il parte ». Il doit être « déplacé vers une autre institution, un ailleurs et pour toujours. » J’interviens, « oui, mais alors où ? » Après un silence le professionnel propose le nom d’une structure. Je ponctue, « On ne peut pas l’envoyer comme ça sans rien en dire. »
Ainsi l’espace de parole peut s’ouvrir. Qu’est-ce qui arrive à Patrice ?
Une soignante prend la parole pour mettre en lien le décès d’un résident, Tonio, survenu quelques jours plus tôt et la violence de Patrice. Quelques jours après le décès, Patrice est désorienté, perdant l’usage des mots, ne reconnaissant ni ses filles ni son entourage. C’est à ce moment-là que la violence de Patrice vis-à-vis des autres résidents comme des soignants redouble.
Une autre dit que peu avant que le coup ne parte Patrice s’est plaint que ce voisin aurait eu à manger et pas lui, ou encore qu’il aurait violé des femmes. Une autre dit, l’autre jour alors que je l’accompagnais à l’atelier il a commencé à proférer des insultes. J’ai dit « ici pas d’insultes, ici c’est le lieu du calme » et cela a suffi à l’apaiser, son regard a changé.
Chacun repère comment quelques paroles peuvent venir suspendre le débordement, avant que le coup ne parte, chacun peut dire et s’enseigner de sa rencontre avec Patrice. La prise de parole de chacun rend possible la poursuite de l’accueil de Patrice dans l’institution. Son déplacement vers une autre structure est suspendu.
Au fil de nos rencontres Patrice m’enseigne. Il parle de ce qui arrive à son corps : des douleurs logées dans son pied, et de la vitalité de son organe masculin qui, dit-il, se tient là « au garde à vous », « droit comme un I », dès le matin. Il se plaint d’être la nuit l’objet de jouissance d’un autre connard qui lui taperait sur le sexe, lui donnerait des coups de poings, le ferait tomber.
Un jour à bout de souffle il profère : « Je vais lui casser la gueule. Il me donne un coup de poing alors je fais pareil. Je vais lui casser la gueule ». Alors que je ponctue, « alors si c’est à con, con et demi, on ne va pas s’en sortir », « pas question qu’un connard vienne vous emmerder, pas de connard ici, c’est inadmissible ! », il marque un temps d’arrêt et reprend plus tranquillement son souffle pour dire, « oui tu as raison, c’est bien dit. »
Une autre fois, il évoque la guerre d’Algérie et l’usage qu’il dit avoir fait alors des femmes des ennemis. Il parle crûment du plaisir charnel et s’inquiète de la jouissance que je pourrais trouver moi dans les affaires du sexe. Je décide de ne pas déplier ce sujet mais prend le parti de lui faire part plutôt de mon étonnement de finalement très peu connaître le bonhomme.
Mon intérêt porté sur qui il est modifie la manière dont Patrice utilise nos rencontres. Ainsi, la question sexuelle le laissera tranquille pour un temps, et Patrice se raconte. Il parle du temps où il allait à l’école, gardait les vaches, était entouré de jeunes femmes, mais aussi de sa rencontre avec une femme, de sa fierté d’être père, d’avoir eu de jolies filles.
Arrêter, couper, border…
À quoi tient l’accueil de Patrice ? À suivre le discours des politiques sanitaires et sociales, au fait que ce qui est nommé « troubles du comportement » ne pèse pas trop lourd sur les « occupations professionnelles ». Le poids de ces troubles est mesuré à partir de la grille NPIES, inventaire neuro-psychiatrique. Au-delà d’un certain score c’est le déplacement de Patrice vers une autre structure qui est prévu. Prendre part à cette logique discursive constitue un leurre, celui de confondre l’insupportable que rencontre chaque professionnel, ce qui pèse trop lourd sur sa pratique, et le « trouble du comportement » du résident accueilli. C’est croire au rapport qu’il n’y a pas. L’accueil de patrice nous démontre que son « déplacement » est suspendu du fait d’un acte qui ouvre à la mise en mouvement de la parole de chacun, et vient border pour chacun l’insupportable qu’il rencontre.
À quoi a affaire Patrice ? Immanquablement Patrice rencontre ce point où « son sexe toujours au garde à vous, droit comme un I » est aux commandes. La question sexuelle vient parasiter sa parole. La jouissance de son corps s’impose. « Rien qu’à te parler, à te voir là, à voir tes cuisses, avec ma main comme ça je jouis », « ça excite mon œil ». Pourtant, dans la séance, un écart se produit, il commence à s’en plaindre. Il dit être embêté de dire ça, car il m’aime bien, et aime bien me parler. Je ponctue d’un « oui ça ne doit pas vous empêcher de dire ce qui vous arrive. Ainsi il s’engage dans un travail de dire. Il dit la difficulté qu’il rencontre pour dire. « C’est dur de dire tout ce qu’on m’a fait ». Il évoque les douleurs qui le prennent dans « le virage de la cheville » et qui montent jusqu’à la tête. Parler, ça fait « tout remonter » dira-t-il. À bout de mots il évoque comment c’est son corps qui est affecté, « ça tangue » dit-il. J’interroge « ça tangue ? comme dans un bateau ? ». Il reprend cette proposition à sa charge pour préciser non « pas comme dans un bateau, comme dans le porte-avions de la guerre d’Algérie ».
Patrice a affaire à un maître qui exige de lui une jouissance constante, toujours plus, « toujours au garde à vous », « droit comme un I ». Peu à peu ce sont les signifiants que viennent lester sa prise de parole, et qui se répètent dans son discours. Je suppose que cette exigence de jouissance immédiate est à l’œuvre au moment des passages à l’acte et le laisse à bout de souffle, à court de mots parfois.
Chacune de mes interventions vise donc à dire non à la jouissance, à y couper court, d’une main, tout en offrant de l’autre au sujet un espace où loger son dire.
* Texte présenté lors de la conférence de Francesca Biagi- Chai du 1 décembre 2018 à GAP, relevé par celle ci , il fait valoir une clinique possible dans les EPAD qui subvertit le discours du Maître.
[1] Lacan J., « Télévision », (1974), Autres écrits, Paris, Seuil, 200, p. 25.