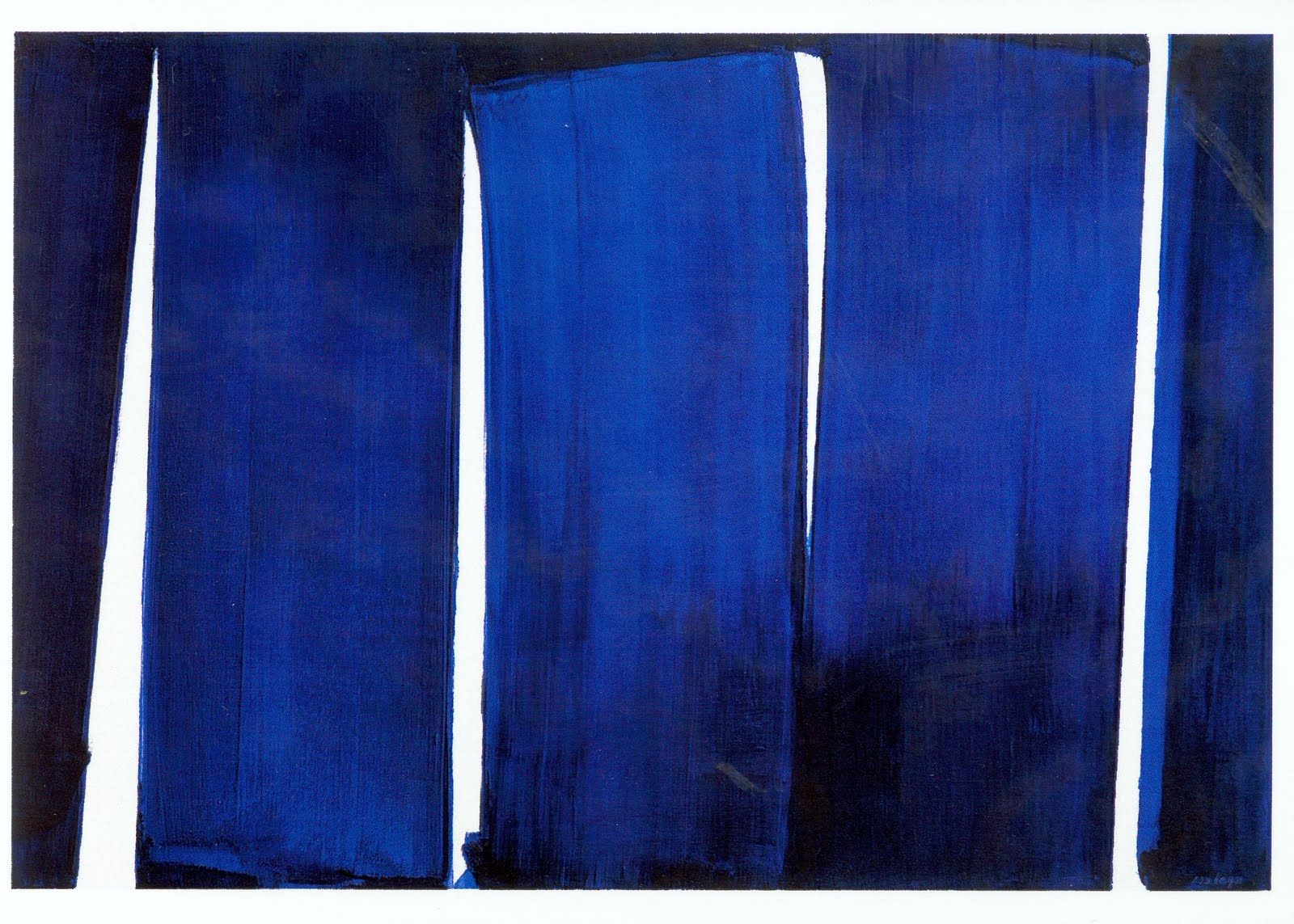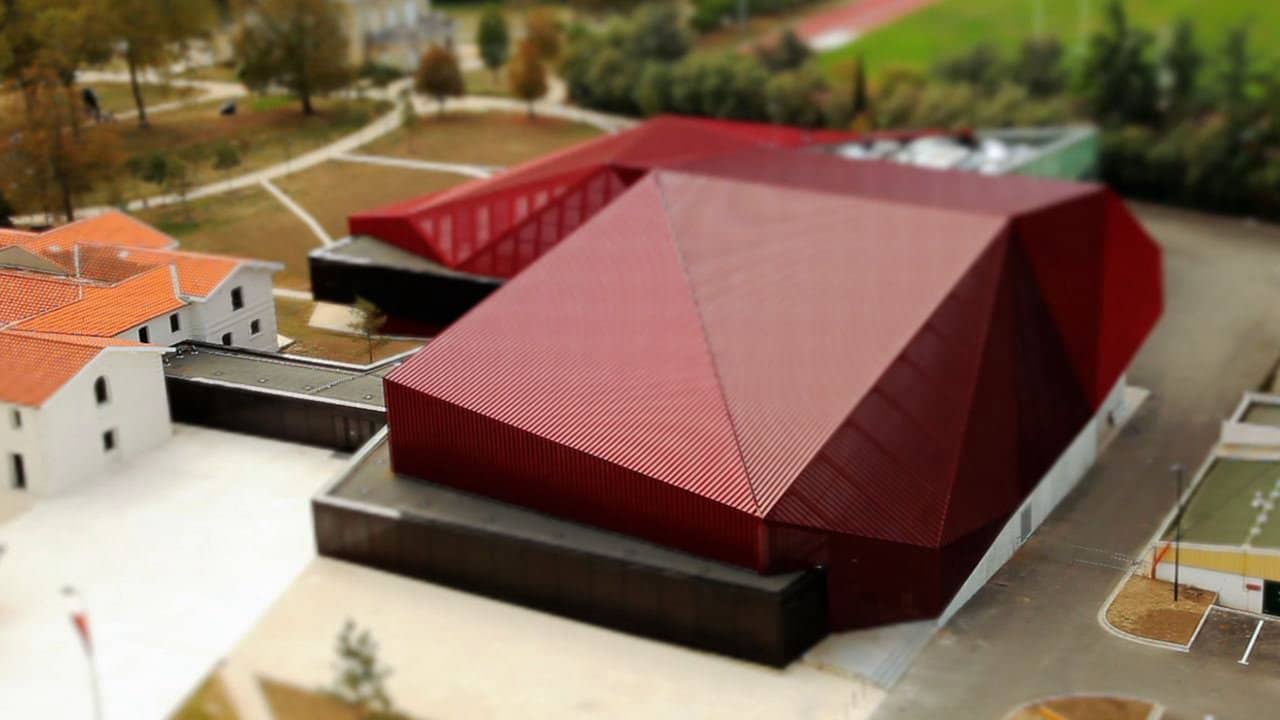Querelle diagnostique ou phénomène clinique ?
Lors de l’après-midi casuistique de mars 2015[1], Jacques-Alain Miller a souligné que le diagnostic n’est plus en vigueur dans une clinique qui prend acte du « tout le monde délire » lacanien. Dans ce contexte, a-t-il ajouté, le diagnostic ne se dit plus, il est sous-entendu. Par ailleurs, ce qui est à mettre en avant est l’interrogatoire clinique en tant qu’il permet de constater le phénomène, le préciser et le décrire très brièvement. Cette description concise est de l’ordre d’une nomination.
Si le clinicien ne peut se passer d’une connaissance du catalogue de la vraie psychiatrie, à distinguer du DSM, sa compétence à décrire le tableau clinique dépend de son talent de bien dire, celui qui lui permet de nommer le phénomène tout en n’effaçant pas le sujet derrière le rapport clinique. Le génie de Clérambault est ici source d’inspiration. Parlant des rapports que Clérambault rédigeait chaque jour par dizaine, Paul Guiraud, qui a préfacé son Œuvre Psychiatrique, les qualifie de « certificats sur mesures, œuvres d’art autant que de science ». En une ou deux pages, Clérambault savait « épouser sans lacune et sans défaut la personnalité du malade, ne reculant pas devant le néologisme qui était toujours de filiation authentique. On peut dire qu’il a presque créé une école littéraire qui devrait être celle de toutes les administrations [2]. »
L’usager du DSM 5 peut se contenter de noter le code 297.1 (F22) pour indiquer que le patient souffre de Delusional disorder. Ensuite, son art se réduit à préciser s’il s’agit du type érotomaniaque, grandiose, de jalousie, de persécution, somatique ou « mixed ». A l’opposé, les descriptions littéraires de Clérambault dans ses courts « certificats » donnent à la personne décrite une consistance vivante. Il ne s’agit pas seulement d’un tableau clinique, mais d’une présence, une épaisseur de corps, nourrie à l’occasion par des citations du patient. Ainsi, on croit entendre la voix d’Amélie, lingère dans une maison religieuse, décrivant l’étrangeté de l’automatisme mental qui la parasite. « Quand on dit « on », dit-elle, on a l’air de parler de deux personnes…Il y a quelque chose qui parle quand il veut, et qui arrête quand il ne parle plus. » Plus loin, Clérambault note concernant Amélie que « son érotisme se manifeste par des sourires et des rougeurs prolongés » ou encore qu’elle « commence et elle arrête des gestes impulsifs. Elle dit tout haut ce qu’elle suppose que nos pensons. » C’est comme si le lecteur participait à l’entretien quand il lit sous la plume de Clérambault : « Une moitié d’elle se fatigant à la fin de l’interrogatoire et lui inspirant à ne pas répondre, une autre moitié, qui nous est favorable, s’irrite, et à haute voix elle rebiffe l’autre : « on veut répondre, laissez, on attendra bien un peu.[3] » On songe ici à L’amante anglaise de Marguerite Duras qui nous permet de toucher du doigt la réticence psychotique à partir de la mise en scène du lien qui s’installe entre l’auteur du crime et l’homme qui l’interroge pour tenter de cerner le trou indicible de sa motivation. Et quand Clérambault conclut de façon laconique « En résumé : Automatisme. Érotisme. Mysticisme. Mégalomanie », ces mots qui appartiennent à une classification universelle, sont transformés en nominations de quelques phénomènes éminemment singuliers du cas d’Amélie.
Les présentations de malades du Dr Lacan témoignent de l’enseignement de Clérambault qu’il reconnaît comme son seul maître en psychiatrie. Telles que nous les dépeint Jacques-Alain Miller[4], elles relèvent de la tragédie grecque, sauf que les participants à la présentation, à la fois chœur et public, sont dans une attente non pas d’une catharsis, mais d’un diagnostic qui serait le dernier mot sur le patient. Lacan esquive cette attente en faisant un pas de côté. Il arrive à affirmer le diagnostic, et dans le même temps le suspendre et le problématiser pour en prolonger l’étude. Sa référence à la classification est là pour dire la normalité du sujet psychotique qui ne manque pas de reconnaître l’Autre dans l’automatisme mental qui le traverse. Pour le reste, Lacan suit le fil freudien d’une nomination de la jouissance singulière qui l’emporte sur la nomenclature psychiatrique. En effet, Ernst Lanzer est entré dans l’histoire de la psychanalyse sous le nom de L’homme aux rats plutôt que comme un cas de névrose obsessionnelle. De même, on pense à Sergueï Constantinovitch Pankejeff comme étant L’homme aux loups avant de considérer le cas de névrose infantile, diagnostic par la suite contesté.
Ainsi, aux côtés de la nosographie psychiatrique qui convient, la psychanalyse tente d’épouser au plus près non seulement la personnalité mais aussi la jouissance sujet. La nomination des phénomènes relève d’une compétence littéraire, plus que scientifique. Rien de mieux pour se former à cet effort de nomination que la cure elle-même. Savoir nommer sa propre jouissance est une condition préalable au bien dire relatif à la nomination de la jouissance de l’autre. Diagnostiquer, c’est faire un effort de poésie.
[1] BOSQUIN-CAROZ, P. Compte rendu de l’Après-midi casuistique des CPCT et associations apparentées (FIPA).
[2] de CLERAMBAULT, G., Œuvre psychiatrique, PUF, Paris, 1942.
[3] Ibid. p. 457- 458.
[4] MILLER J.-A., « Enseignements de la présentation de malades », La conversation d’Arcachon, Paris, Le Seuil, 1997, p. 285-304.