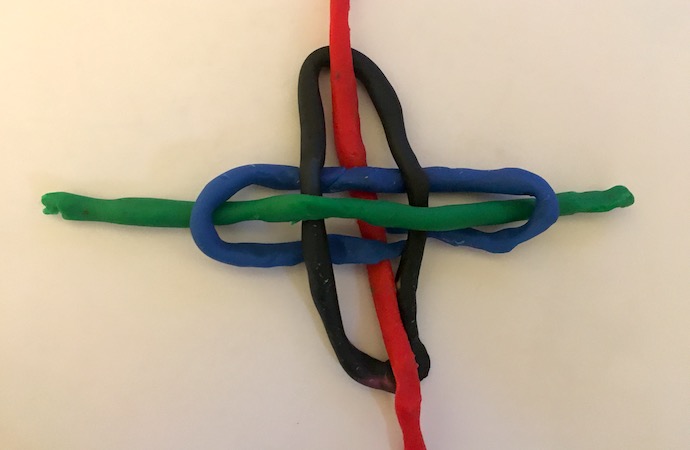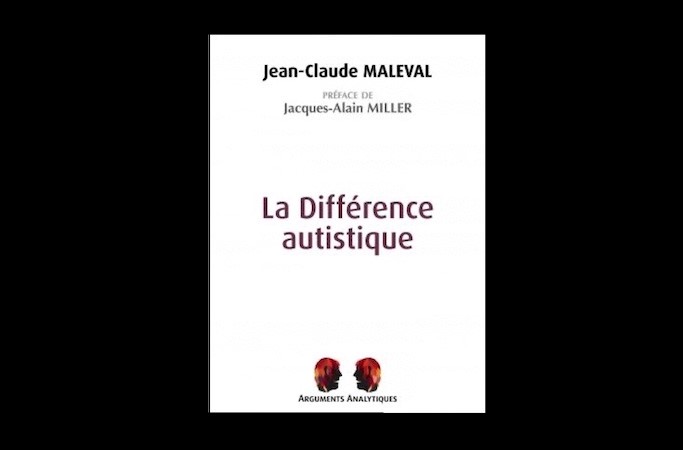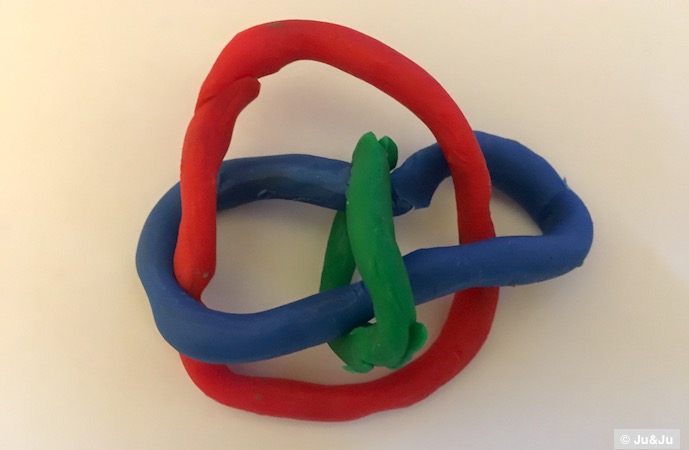À Psychopathologie de la vie quotidienne, Lacan a répondu par le titre du Séminaire Les formations de l’inconscient, indiquant ainsi la dépathologisation attendue d’une clinique psychanalytique.
De quelle pathologie parlons-nous : de celle qui décrit, classifie et nomme le pathos pour tenter de savoir quelque chose du génie propre à tel ou tel ensemble – symptomatique, nosographique – et de la norme qui le règle, ouvrant la voie à un possible traitement ?
Jacques Lacan, jeune psychiatre, a poussé l’ambition assez loin avant de rencontrer la psychanalyse comme en témoigne son article sur une classification des paranoïas[1]. La rencontre avec Aimée, au cours de sa thèse, change la donne par les entretiens quotidiens qu’il a avec elle : il élabore la solution qui a permis à celle-ci d’abandonner la pointe aiguë de son délire et le risque de passage à l’acte. À l’heure des sujets de droit qui cherche à éviter la question de la part qu’ils prennent dans leurs symptômes, la dépathologisation est envahissante au point de ne plus pouvoir reconnaître la victime d’un accident, d’une attaque, d’un attentat de celle qui le serait de son fantasme. Plus de fantasme donc, adieu Sade et Kant aussi bien.
À la maladie mentale qui justifiait une médecine spéciale et donc des psychiatres succédait, au début des années 1950, la notion de santé mentale. Forte de considérations sociologiques et politiques en quête d’un traitement égalitaire des malades et des « sains d’esprit », le fou n’était plus l’effet d’un dérèglement divin mais celui de la société qui le produisait. En corrigeant ses dysfonctionnements, nous retrouverions tous la santé.
Michel Foucault dans son incontournable Histoire de la folie à l’âge classique[2] considère injustement que Freud a contribué à médicaliser les maux de l’âme. Mais il partagera pourtant avec Lacan une conception du sujet qui, par sa définition à partir du signifiant, ouvre la voie à une conception non-pathologique du symptôme.
La pathologie recouvre le catalogue des écarts par rapport à des normes, anatomique, biologique, physiologique, collective. Quand ces normes se diffractent, se pulvérisent en une infinité, les repérages pathologiques sont beaucoup plus délicats. L’imagerie du corps, statique ou dynamique, a fait tellement de progrès que le moindre artefact interroge le praticien qui n’aura d’autre recours que de proposer de nouvelles images pour observer le destin lésionnel, ou non, du dit artefact.
En psychiatrie, l’éclatement des cadres nosologiques a laissé la place à l’infini catalogue des signes des divers DSM. Aujourd’hui le fait psychique lui-même est nié par la certitude de certains psychiatres qui pensent en trouver la trace dans la physiopathologie du corps – au-delà même du cerveau –, traquant le symptôme comme on scrute le virus et proposant d’appliquer des thérapies par anticorps monoclonaux comme espoir de vaincre les dépressions ou la schizophrénie[3].
Affects réduits aux effets immunologiques, symptômes coupés de leur détermination subjective, la psychiatrie disparaît au profit d’une science médicale qui met sur le même plan COVID, autisme, dépression et schizophrénie – pensés à partir de modèles identiques et traités par les mêmes moyens. Peut-être les praticiens de cette médecine se plaindront-ils encore de la violence de certains qu’il suffira de mettre au pas par des mesures d’ordre (police, justice).
D’un côté, il y avait Krafft-Ebing et sa Psychopathia Sexualis ou encore Havelock Ellis qui cataloguèrent un savoir sur la sexualité à travers les perversions, et de l’autre Freud qui décrit les effets des différents modes du refoulement sur la pulsion sexuelle chez les femmes et les hommes. La norme mâle en règle encore le ballet, mais elle se déplace et laisse le sujet aux prises avec une norme intime, au point que chacun puisse la revendiquer, comme les revendications Trans le démontrent. À chacun sa solution, à chacun son mode de satisfaction, la dépathologisation est à son comble.
N’est-ce pas ce qu’opère l’analysant au terme de son parcours ? De son symptôme ne subsiste plus qu’un irréductible reste à partir duquel il aura su faire sous la forme du sinthome. Il aura fallu, pour ce savoir y faire, l’effort démesuré d’un Joyce ou le long parcours de l’analysant, non sans la puissance interprétative de l’inconscient sous transfert supporté par le psychanalyste. Au « tous pareils » produit par la dépathologisation sauvage qui renforce les effets de masse et abrase les effets-sujets, déclinons celle que la psychanalyse, avec Freud et Lacan, nous propose en soulignant le Un de la différence absolue. Penser le fait psychique à partir de là, a manifestement une autre saveur.
_______________________
[1] Lacan J., « Structures des psychoses paranoïaques », Semaine des Hôpitaux de Paris, n°14, juillet 1931, p. 437-445, republié dans Ornicar ?, n°44, 1998, p. 5-18.
[2] Foucault M., Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972.
[3] Leboyer M., « Entretien. “Il faut que la psychiatrie devienne une médecine de précision”, plaide Marion Leboyer », Ouest-France, 3 janvier 2022, disponible sur internet.