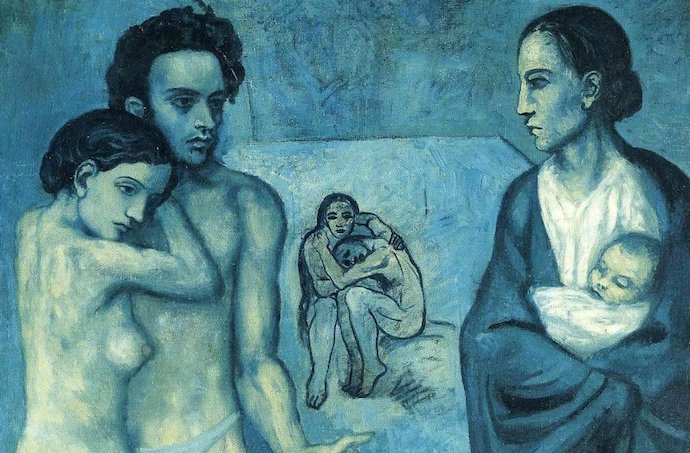Sophie Marret-Maleval : La phrase qu’il nous appartient de commenter [1] est extraite de « L’agressivité en psychanalyse », un texte de Lacan datant de 1948, dans lequel il évoque une maxime de La Rochefoucauld sur « l’incompatibilité du mariage et des délices » [2].
Dans ce texte, Lacan rapporte l’agressivité dans le mariage à la relation d’objet fondée sur l’amour narcissique qui préside à la rencontre amoureuse. Il en déduit une impossible harmonie entre les sexes.
Le terme de « délices », évoque, à travers l’emprunt à La Rochefoucauld, le jardin des délices que Lacan cite plus haut, faisant entendre la dimension sexuelle comme corrélée à celle du bonheur partagé. Déjà Lacan aborde l’inexistence du rapport sexuel, à partir de la version freudienne de l’amour adressé à l’image narcissique, placée dans l’autre et prise pour objet pulsionnel.
Nous avons choisi d’illustrer cette incompatibilité du mariage et des délices par l’exemple d’un couple mythique, Elizabeth Taylor et Richard Burton, deux fois mariés et deux fois divorcés, dont les tribulations conjugales autant que leurs brillantes carrières d’acteurs furent placées sous le feu des projecteurs tandis qu’ils comptèrent, pendant quelques années, parmi les plus gros revenus de la planète.
1- Liz
Christiane Alberti : Liz est née en 1932, dans la banlieue de Londres. Celle que l’on peut considérer comme la dernière grande star d’Hollywood, est convaincue que si elle avait grandi en Angleterre, elle ne serait jamais devenue actrice. Ses parents sont en effet venus s’établir à Los Angeles, lorsque la seconde guerre mondiale menaça en Europe. Par-delà le hasard de la rencontre de son père avec un coscénariste de la MGM qui recherchait une fillette pour jouer le rôle de Lassie, on relèvera que Liz a grandi auprès d’une mère (elle même chaperonnée par sa mère musicienne) qui a toujours voulu devenir actrice mais qui a dû y renoncer pour épouser Francis Taylor. Sarah Taylor a tout fait pour que Liz soit engagée par la MGM dès son plus jeune âge. Elle suivra de très près la carrière de Liz qui en quelque sorte incarnait son idéal. Le père de Liz, qui devait sa réussite professionnelle à son oncle, ouvrit une galerie d’art et ils s’établirent à Hampstead, là où Liz vécut jusqu’à l’âge de sept ans selon les principes d’une éducation à la fois chic et sévère. Francis Taylor témoigne ouvertement d’un mariage de façade et semble préférer la présence d’un ami de la famille Victor Cazalet. S’il était un homme poli, féminisé en un sens par son épouse, la boisson faisait de lui aussi un homme violent, envers Liz de même qu’envers son frère. Ce couple parental a laissé une empreinte indéniable dans la vie de Liz qui a perçu à travers les paroles, les faits et gestes, comiques ou tragiques, ce qui a raté dans le rapport entre ses parents. Cette empreinte a donné lieu à une véritable passion, et dans les couples qu’elle formera avec ses sept maris et ses nombreux amants on devine la parodie de ce rapport-là.
Une enfant-star
Avec son premier rôle à neuf ans, Liz eut l’enfance d’une enfant-star à l’image de Shirley Temple qui la fascinait. Plus précisément, elle fut d’emblée une femme-enfant star, pas seulement parce ce qu’elle avait des partenaires plus âgés qu’elle mais parce que son visage et sa beauté intriguaient : elle n’avait pas l’air d’une enfant mais plutôt d’une adulte en miniature. D’emblée, elle fascinait son entourage par sa beauté, sa plastique impressionnait. Pour celle qui dit avoir cherché désespérément à « se fondre dans la masse »[3], sa vie dès l’enfance fut peu ordinaire. Elle décrit sa vie d’enfant-star comme une « enfance impossible »[4], écartelée entre les exigences de la MGM qui tendanciellement la traitait en esclave, et celles d’une mère omniprésente : Liz avait littéralement l’impression de vivre « sous un microscope », tant elle se sentait épiée, surveillée, observée. Être vue et connue de tous, sur la simple base de ses apparitions à l’écran, est, comme elle le dit, le destin auquel elle n’a jamais pu échapper : Liz est par-dessus tout un être regardé. Le contexte de sa naissance l’a curieusement prédisposé à cela : une maladie génétique appelée FoxC2, l’a d’emblée placée sous les projecteurs de la médecine et sans doute dans un plus grand subornement dans le fantasme de la mère. Cette maladie lui vaut entre autres, outre une hyperpilosité, une double rangée de cils qui a rendu son regard si célèbre. Son attachement remarquable et indéfectible à de nombreux animaux plus ou moins domestiques, au long de sa vie, apparaît ici comme en miroir.
Ainsi sont les femmes, c’est avec ce film, que du jour au lendemain, Liz considère être devenue une star adulte : comment ? Bob Clark lui donna son premier baiser au cinéma. Elle a quinze ans. Au cœur d’une existence étouffante, entre sa mère et la MGM, celle qui n’a aucune amie de son âge, celle qui se dit divisée « entre le moi réel, et le moi magnifié à l’écran »[5], aspire par-dessus tout à se sentir une fille comme les autres.
Surtout elle déclare : « j’ai toujours voulu être une femme »[6]. Elle se décrit à la puberté exhibant sa « silhouette de sablier », mettant en valeur son buste et sa taille fine. Elle rapporte une séance de photos alors qu’elle a seize ans, comme un moment clé : « Vous avez de la poitrine, faites-la ressortir ! » lui hurla le photographe. Sans aucune gêne, ni pudeur, elle déclare que pour la première fois elle s’est vue comme femme. « En une journée, j’appris à être aguichante, à prendre des poses provocantes, même si je savais que quelque part en moi l’enfant n’avait pas encore tout à fait grandit »[7].
C’est sur la voie du « devenir femme » que le mariage s’est présenté à elle comme la seule issue pour s’extraire de cette vie impossible : être « une vraie femme » en passe pour Liz par « être une femme amoureuse et mariée ». Le mariage était le destin que le patriarcat de l’époque destinait aux femmes, et indéniablement il donnait à Liz une attache dans la vie, un être, une place dans le monde. Elle est une femme mariée au vu et su de tout le monde. L’état civil transforme en effet, le lien sexuel en un état solide et pérenne. La nomination, la signification du mariage nous fait croire au « pour toujours », et donne un sens à la vie. Elisabeth croyait vraiment que le mariage c’était « vivre dans un petit cottage entouré d’une clôture blanche et de roses rouges ». Malentendu et ratage seront au rendez-vous.
Elle en vient à épouser ainsi Nicky Hilton, son premier mari, riche, raffiné, mais qui s’avère violent et alcoolique dès la lune de miel : il boit, l’offense… Un désastre, un cauchemar, dit-elle. Liz ne cessera d’œuvrer pour trouver un « homme fort » qui lui donnerait un supplément d’être et qui ferait d’elle une femme normale, désir qui comptait plus à ses yeux que sa carrière.
Dans les faits, c’est sa carrière qui la tient, là les réalisations semblent le plus opérantes, là elle affiche une ténacité certaine : elle apprend vite les ficelles du métier, et même si elle essuie des critiques acerbes sur son art de jouer la comédie, elle connaîtra le succès dans des films cultes comme Géant ou Cléopâtre. La critique est unanime pour relever son génie de la présence. Sa vie de femme est inséparable des rôles qu’elle a tenus au cinéma : elle fut l’ardente adolescente du Grand National, la séductrice de La chatte sur un toit brûlant, la noble tentatrice dans Cléopâtre.
Elle épousera ensuite Michael Wilding, de vingt-cinq ans plus âgés qu’elle, avec qui elle aura deux enfants. Mais très vite, la vie conjugale se dégrade comme en témoigne la dégradation énigmatique de la maison. Parmi les déjections de la ménagerie qui l’entoure, le désordre semble refléter un désarroi profond y compris dans sa fonction de mère.
Alors commence une longue série de six autres mariages.
Ses maris sont tous beaux, riches, illustres, raffinés, et avec tous elle mène une « vie à grand spectacle ». Mais aucun ne parvient à éponger un désœuvrement, le sentiment « d’être inutile », « sans recours », lorsqu’elle est l’épouse du sénateur John Warner. Solitude fondamentale, douleur d’exister qu’elle cherche désespérément à calmer par la voie de la pulsion orale : alcool, barbituriques, drogues, nourriture……
Dans cette série d’hommes, Liz aura « deux grands amours » : Mike Todd et Burton. Mais elle aura trois autres partenaires essentiels, Montgomery Clift, Rock Hudson et Michael Jackson. Tous les trois homosexuels, amis, confidents. Ceux-là lui parlaient de ses yeux, les autres de ses seins.
Avec tous ses hommes, elle apprend à boire, ce sont ses amis de beuveries. C’est sur le tournage de Giant aux côtés de Rock Hudson que son appétence pour l’alcool a débuté.
Mike Todd et Richard Burton joueront un rôle à part : ils incarnent à la fois la passion amoureuse, l’exigence romantique « incurable » de la pureté des sentiments, et sans doute aussi la violence du père. Ils ont en commun d’avoir un cœur immense et un sens du spectacle. Les deux la couvrent de diamants. Sa passion des pierres précieuses avait cependant des limites. Nous le verrons.
Ils incarnent à ses yeux un grain de folie : « je ne suis bien qu’avec des hommes un peu dingues »[8]. Être avec eux « c’est comme tourner dans un film à grand spectacle ». Comme elle le dira de Mike Todd, ils transformaient « l’impossible existence que j’avais à l’écran en réalité »[9].
Le corps
Je proposerai ceci : le corps regardé fut la grande affaire de sa vie.
D’emblée, Liz témoigne d’un rapport malaisé à son image. Curieusement elle peine à se ranger parmi les belles femmes, « je ne me trouve pas et je ne me suis jamais trouvée belle »[10]. Sa beauté ? Cela faisait partie de son métier ou de son patrimoine génétique.
Elle a tout à fait conscience de s’être conformée à cet endroit au diktat maternel : ne jamais oublier que la véritable beauté est intérieure, que les beaux yeux ne sont que le reflet de l’âme : « à vingt ans on a le visage dont on a hérité, à quarante celui qu’on mérite »[11].
Et pourtant, comme elle le dit, il lui suffisait de paraître : « un moi tout puissant à l’écran », une présence magnifiée, telle qu’un producteur a pu déclarer en la voyant passer alors qu’elle était encore mineure : « j’irais en prison pour ça ». Plus tard sa féminité surjouée, indique assez l’usage qu’elle fera de la mascarade : son hyper féminité, dissimule le manque ou le vide voire l’abjection, tandis que du côté de l’être, elle se fait phallus. Les nombreux commentaires sur ses seins indiquent assez qu’elle provoquait l’être par le paraître.
Sur un autre versant que le corps scénarisé, il y a le corps souffrant, malade et ce dès la naissance : les séquelles de sa maladie génétique au plan cardiaque, puis des otites à répétition, et sa vie durant la souffrance logée dans le corps qui lâche (colites, fatigue, perte de connaissances, grippe, virus…) ou se fracture (entorse, mal de dos, fracture,…) ce qui lui a valu des absences et des hospitalisations très fréquentes, dans des moments de rencontre avec un réel insupportable (pertes, deuils, séparations….), comme si le corps scénarisé, magnifié, auréolé la lâchait régulièrement.
Je dis la grande affaire de sa vie, car son étrange autobiographie en témoigne : Liz dit tout se résume à la chronique de ses prises et pertes de poids (que les comiques et les journaux ont tant exploité), et de conseils avisés pour mincir à destination des lectrices : l’identification féminine est noyée dans l’image. Lorsqu’elle grossit, elle décrit un moment clé de désarroi face au miroir : « Je n’étais plus ce produit qui avait tant rapporté, je n’étais plus l’une des plus belles femmes du monde et, pire que tout cela, je n’étais même plus Elizabeth Taylor, celle que je connaissais »[12]. Être grosse/être maigre donne à Liz une signification d’être calquée sur l’image. Le symbolique semble noyé dans l’imaginaire.
Sans le bijou, sans la parure de diamants, insignes de la féminité, Liz n’existe pas. Elle méconnaît que l’objet précieux n’est pas le diamant mais bien cet objet appartenant à une autre dimension, celle de l’objet a d’où s’origine le désir. C’est lui qui rend le diamant si irrésistible : comme un tableau est un attrape regard, un piège à capturer cet objet précieux entre tous, le diamant capture le regard, le sien et celui de Richard.
2- Richard
S. M.-M.: Né en 1925, au pays de Galle, d’une famille de mineurs, Richard était le dixième d’une famille de onze enfants. Sa mère mourût en couche à la naissance du onzième, Richard avait deux ans. Il fut alors élevé par sa sœur Cécilia, ou Cis, de vingt ans son aînée, qu’il adorait. « Il m’a fallu trente ans, dira-t-il, pour comprendre, en la retrouvant dans une autre femme (Elizabeth Taylor) que je l’avais cherchée toute ma vie »[13]. Ses parents, d’un milieu très modeste, avaient cependant la fierté d’avoir été les premiers de la lignée Jenkins à avoir signé le registre des mariages autrement qu’avec une croix. Doit-on y lire l’une des racines de l’intérêt de Richard pour le mariage, à travers un trait de dignité paternel, puisqu’il proposait immanquablement et rapidement d’épouser celles dont il tombait amoureux. Richard portait en outre le même nom que son père Richard Walter Jenkins, dont on disait qu’il n’avait « aucune méchanceté » mais qui se caractérisait d’être un grand buveur, et qui avait une passion pour les mots. Il jugeait que Richard lui ressemblait, et en effet, Richard préleva ces traits d’identification par la suite, reproduisant également le caractère houleux du mariage de ses parents.
À onze ans, il fut remarqué par le directeur de l’école, il obtint une bourse pour faire des études secondaires. Ayant dû interrompre ses études, il fréquenta un centre de la jeunesse tenu par un instituteur, Meredith Jones, qui le recruta pour jouer une pièce inspirée des Misérables. Jugeant qu’il ferait un bon acteur, il parvint à le faire admettre au lycée. Il le recommanda à un ami Phillip Burton, qui prit Richard sous son aile, le logea, paya ses frais et lui enseigna le métier d’acteur. Celui-ci deviendra par la suite producteur pour la BBC et contribua à lancer la fulgurante carrière de Richard dans le théâtre. En outre, Philip Burton l’adopta afin de pouvoir l’envoyer à Oxford faire ses études. « Ce n’est pas Philip Burton qui m’a adopté, c’est moi ! J’ai adopté Philip Burton »[14], dira Richard. Il prit son nom. « Mon vrai père m’a transmis son amour pour la bière. C’était un homme à l’éloquence formidable, passionné, extrêmement violent. Il me terrifiait. […] Mon père adoptif est tout l’inverse : pédant, éduqué, choisissant méticuleusement ses mots, peu enclin à la passion. J’ai encore peur de lui. Il corrige encore mes fautes de grammaire »[15], écrira-t-il encore. Il n’a jamais ouvertement critiqué son vrai père, mais se tenait à distance de sa froideur et Richard n’ira pas à son enterrement[16]. Son choix se porta de la terreur à la peur, en raison de la sévérité de Philip Burton à laquelle, pourtant, il se plia. Néanmoins, il qualifia cette période de « véritable enfer ». La tristesse qui l’accompagna toute sa vie, l’alcoolisation, commencèrent là. Se défaisant du nom de son père, qui était aussi le sien, d’un double encombrant, il fut cependant, semble-t-il, propulsé vers une identification accentuée à ce dernier.
Ce qui se produisit avec Dylan Thomas, le grand poète Gallois qui devint son ami par l’intermédiaire de Phillip, peut nous laisser entendre que la culpabilité d’abandonner une figure paternelle miséreuse et connue pour son grand alcoolisme occupa une place majeure dans son existence. Il se sentit en effet responsable toute sa vie du décès de Dylan Thomas. Ce dernier lui avait demandé de lui prêter de l’argent, mais Burton ne pouvait le lui prêter. Dylan Thomas le menaça de devoir partir pour l’Amérique si Burton ne le lui donnait pas, ce qu’il fit, mais il décéda rapidement après, à New-York, des séquelles de son alcoolisme. Richard affirme qu’il n’a jamais cessé de se répéter qu’il aurait pu trouver cette somme[17]. Soucieux de ne pas manquer d’argent tout sa vie durant, même quand il atteint son but de devenir « riche, riche riche ! »[18], puisqu’ils furent avec Liz Taylor, l’une des plus grande fortune mondiale, Richard fut très tôt généreux, et sa générosité à l’égard de sa famille et de ses proches n’a jamais cessé après le décès de Dylan Thomas.
Malgré son Don Juanisme, Richard se maria à vingt-trois ans, avec Sybil Williams, une actrice qui renonça à sa carrière pour vivre avec lui. Il n’en cessa pas pour autant de multiplier les aventures, clamant : « tout ce que je veux, c’est vivre ma vie »[19]. Il séduisait les femmes par ses talents de conteur[20] et précise les avoir toutes aimées. Il affirmait cependant : « jamais je ne divorcerai de Sybil, jamais elle ne me quittera… elle me considère comme un génie »[21]. Sybil soutenait son narcissisme, ce qu’Elizabeth fera moins du fait de leur rivalité, accentuant sa peur de l’échec. Il eut deux filles avec elle : Kate et Jessica. L’autisme de cette dernière renforça encore sa culpabilité (il craignait de l’avoir contaminée, d’avoir un sang vicié)[22]. La contamination par le vice du père, reste, on le voit, une crainte majeure pour Richard.
Il s’interrogeait d’ailleurs sur la persistance de cette tristesse, sur son alcoolisation, en dépit d’une vie réussie et heureuse : « ça bouillonne trop là-dedans »[23], put-il dire. « J’avais une adorable petite fille, j’aimais beaucoup ma femme, j’étais millionnaire, je possédais une agréable petite propriété à Céligny. J’avais un superbe cabriolet Cadillac […], une grande bibliothèque, une soif inextinguible de connaissances et les moyens de la satisfaire, j’avais la possibilité de jouer tout ce qui me plaisait et j’étais terriblement malheureux »[24], constata-t-il. Son obsession de la mort ne l’empêchait pas de s’alcooliser sans limites. « Je bois pour noyer ma peur ! »[25] dira-t-il. « De quoi ? Il dira qu’un ennemi subtil est en lui, l’entraînant vers la dépression »[26], relève Jacqueline Monsigny. Culpabilité, pulsion de mort firent leur œuvre. Chaque décès contribua à accentuer sa tristesse et son alcoolisme, notamment celui de son frère Ifor dont il se sentit également coupable. Celui-ci fit une chute en allant ouvrir les volets du chalet de Richard à sa demande, qui le laissa paralysé et dont il mourut peu de temps après.
Richard évoquait aussi « la hantise d’une carrière s’enlisant dans la médiocrité », sa crainte de « l’oubli du public »[27]. Il avoue : « Je crois que j’ai toujours secrètement honte d’être acteur, et plus je vieilli, plus j’ai honte »[28]. Honte de cette vie facile, crainte de ne pas être à la hauteur, Richard restait hanté par ses démons.
Parmi ceux-ci : la colère, sans doute un autre héritage de son père ; Il oscillait entre une extrême gentillesse, une profonde générosité et la fureur. Il était en colère contre le monde : « l’alcool m’a soulagé d’avoir à faire face à ce monde étrange dans lequel j’étais forcé de vivre »[29]. Il était révolté et si peu fier de lui : « Il importe de dénoncer l’hypocrisie et l’imposture, même si l’on est soi-même un imposteur »[30], il était amer : « Plus j’en lis sur l’homme, sa nature follement impitoyable, son âme jalouse, obscène et meurtrière, plus je réalise qu’il ne changera jamais »[31]. La colère s’adresse encore aux traits du père, il se reproche son imposture, peut-être d’avoir pris le nom d’un autre, pour échapper à un destin qui ne fit que le poursuivre.
3- Leur rencontre
S. M.-M.: La première rencontre entre les amants du siècle eut lieu dans un salon de Los Angeles, il ignorait tout d’elle, en dépit de son succès.
Il fut fasciné par sa beauté, « elle était époustouflante de beauté … une splendeur. L’abondance faite femme … Sombre… impassible… En bref, elle était franchement trop. En plus, elle m’ignorait totalement »[32].
C.A. : Elizabeth avait dix-neuf ans. Pour sa part, elle en dit : « à première vue je l’ai trouvé plutôt prétentieux. Je crois qu’il a parlé sans arrêt ce jour-là et que je lui ai décoché quelques coups d’œil glacials »[33].
S. M.-M.: Puis ils se retrouvèrent sur le tournage d’Antoine et Cléopâtre à Rome. Au début, Richard ne la supportait pas. Il n’avait jamais vu aucun de ses films, mais il se souvenait l’avoir vue à une soirée. Il ne manifestait aucun intérêt pour l’actrice, l’appelait « Miss Nichons », et se répandit en remarques désobligeantes.
C. A. : Liz tombe immédiatement amoureuse de lui, et l’a aimé sa vie durant. « Petite fille je croyais à mon destin » si ce destin a existé, alors Richard Burton fut son destin. Elle dit de lui « il fut ma vie ».
S. M.-M.: Les biographes évoquent une « confrontation électrique »[34] qui bascula pendant le tournage.
Quand Richard comprit qu’il était amoureux de Liz, il essaya de prendre ses distances, saisi par la culpabilité d’abandonner Sybil, de laisser ses filles, un sentiment qu’il conservera jusqu’à la fin de sa vie.
Liz fit une tentative de suicide, Richard revint vers elle, Sybil fit également une tentative de suicide, mais Richard décida de la quitter. La liaison illicite des amants émut jusqu’au Vatican[35]. Pour déjouer les indiscrétions de la Presse, Richard annonça très vite qu’il allait épouser Elizabeth. C’est néanmoins quand il fut touché par le dépit d’Elizabeth face aux critiques à son encontre dans Cléopâtre que Richard aurait pris la décision de l’épouser.
Elizabeth était un miroir : voluptueuse, une compagne de beuverie, elle passait, comme lui, d’un registre à l’autre[36]. Ils étaient tout aussi opposés : lui, en rugbyman macho, elle, incarnant la féminité ; lui le théâtre, elle, le cinéma ; lui, la culture classique ; elle, l’art de l’image[37]. Il était ponctuel, soigné, elle s’avérait incapable d’exactitude et peu soignée[38].
C. A. : Liz le note, ils sont si différents : elle est sioniste (convertie au judaïsme), il soutient les Black Panthers. Il est un homme de culture, tandis qu’elle peut jouir d’accentuer un laisser-aller et une vulgarité affichée.
S. M.-M. : Chacun était impressionné par les vertus de l’autre[39]. Richard vantait la moralité de celle qui attirait sur elle la critique pour sa liberté, la qualifiant de « l’une des dernières femmes à la pruderie victorienne »[40].
C. A. : Ils tentèrent de rompre sans y parvenir. La vie de couple est un mélange étonnant de délicates attentions et d’affrontements spectaculaires, toujours sous les sunlights, une vie « pleine à ras bord ».
4- Liz et Richard
C. A. : Que dire de sa vie avec Burton ? : Sinon comme elle le dit qu’elle fut « transcendée par le bonheur »[41], du moins portée par le masque du bonheur que confère le mariage. « Il m’a initiée à la poésie et à la littérature et m’a fait vivre une vie épanouissante. Il était généreux, non à l’excès, mais avec faste »[42].
Liz aimait les belles choses et Richard Burton la couvre des gages « resplendissants » de son amour : soit des diamants inouïs de par leur taille et leur valeur (cf. le fameux diamant Krupp d’une valeur inestimable).
Surtout, elle mène avec lui « une vie pleine à ras bord », inséparable de leur métier d’acteur. Avec lui, c’était « Buvons, mangeons, soyons gai car demain nous reprendrons le collier ». Leur vie était inséparable du cinéma.
Elle évoque cependant des « moments difficiles » : doux euphémisme ! « Nous étions comme deux aimants, avec lui j’ai vécu mon propre fantasme fabuleux et passionné »[43]. « Même quand nous ne pouvions plus vivre ensemble, nous nous aimions toujours »[44].
Elle ne peut pas se passer de lui alors même qu’il est insupportable. Il l’injurie, l’humilie, la frappe. Mais en un sens il fait partie d’elle. Le mariage emporte ici des liens réellement puissants.
Liz a des accents bovaryens : le sentiment de vide, l’attente de quelque événement pour que quelque chose l’habite, d’un homme fort qui l’arracherait à elle-même, d’une cause de l’existence, en elle plus qu’elle. Une part d’être, une accroche qui l’unirait à elle-même, lui fait défaut. Elle cherche en vain à sortir de la prison de l’un tout seul.
En deçà de leur première rencontre sur le tournage de Cléopâtre, il y eut cette première fois où Liz a d’abord vu et entendu un homme fou de colère. Lors d’un discours de Khrouchtchev, alors en visite aux Etats-Unis, Burton s’est mis à tempêter, protester tellement que la sécurité dut le maitriser. Ne serait-ce pas l’ombre du père qui plane sur cet homme ravage ? Liz semble ne pas le méconnaitre lorsqu’elle demande à son mari de l’époque de ne pas divorcer pour l’éloigner de Burton afin « d’exorciser un cancer. » D’ailleurs, les hommes gentils, non violents sont méprisés par Liz qui les soumet à une véritable tyrannie domestique.
Le conjoint-symptôme. Voilà ce que Burton incarne pour Liz. « Que peut vouloir dire, pour nous analystes, ce terme de conjoint ? […]. C’est celui avec qui il faut bien, de façon quelconque, bon gré mal gré, revenir à être tout le temps dans un certain rapport de demande. Même si, toute une série de choses on la boucle, ce n’est jamais sans douleur. La demande à être poussée jusqu’au bout. »[45] Le mariage est un lieu sinon le lieu électif pour Liz de ce pousser jusqu’au bout. Jusqu’au bout du rien ne fait couple pour un corps parlant. Jusqu’au bout de la boiterie essentielle de chacun, son symptôme, sa marque singulière.
5- Richard et Liz
S. M.-M. : « Faust c’est moi », dit Richard à propos de cette union[46]. Le jour du mariage, il était crispé[47]. Mais il explique ainsi son choix : « Elizabeth Taylor m’a fait découvrir dans le cinéma des subtilités dont j’ignorais l’existence et que j’aurais pu découvrir par moi-même […] si je n’avais pas été plein de l’arrogance des timides et du refus agressif de me perfectionner au contact des grands acteurs. […] Elle m’a appris entre autres choses la valeur des silences, elle m’a expliqué que ma voix mordante n’avait nullement besoin de se hausser au-dessus du niveau sonore d’une conversation téléphonique »[48]. Elle le fascinait par sa beauté et son mystère : « Elle vous emplit d’un sentiment de danger … elle fait partie de ces rares individus qui ne sont pas comédiens au sens où on l’entend habituellement, mais qui dégagent quelque chose dès qu’ils apparaissent sur un écran, quelque chose que, franchement, je ne saisis pas »[49].
Ils étaient complices, mais leurs querelles étaient fréquentes et violentes. Il reprochait à Elizabeth d’exiger qu’il soit toujours présent à ses côtés[50]. Il se plaignait d’être toujours amenés à tourner ensemble, comme Laurel et Hardy[51]. Il n’était pas sans ambivalence toutefois à ce propos. Il rapporte l’une de leur dispute : « Avant d’aller dormir, j’ai dit à Elizabeth qu’il n’était pas question qu’elle m’accompagne à Londres. Laisse-moi un peu tranquille, ai-je hurlé en claquant les portes. Fiche-moi la paix ! Les nerfs et l’alcool, où cela peut vous mener. Je n’envisagerais pas une seule seconde d’y aller sans elle »[52]. Elizabeth l’apaisait[53].
Touché par son désarroi, ses multiples opérations, il s’occupait aussi d’Elizabeth tout comme il s’était senti « investi du devoir impérieux de […] protéger [Cis, sa sœur] plus que toute autre créature »[54]. Il prenait soin de la fragilité des femmes, couvrait Elizabeth de cadeaux, mais il n’aimait pas qu’elle le contredise devant les enfants[55] et supportait mal que les rôles s’inversent : « Elizabeth se veut mégère, elle se veut autocrate et en vain s’efforce d’exercer sa tyrannie dans des domaines sans importance. […] Elle est aussi extrêmement jalouse et n’apprécie pas du tout que je pose le moindre regard sur une jolie fille. Elle me donne de violents coups de pied sous la table, mais je continue comme si de rien n’était, car une petite humiliation de temps en temps peut lui être bénéfique »[56]. Elizabeth admirée, tant aimée, devait aussi être un peu écornée, ramenée à la place de l’objet qu’elle occupait dans son fantasme. Ses carnets attestent du souci de Richard pour le corps d’Elizabeth, pour sa beauté. Ces remarques semblent occuper plus de place qu’un intérêt pour son âme.
Il lui fut longtemps fidèle, et, de façon surprenante de sa part, déclara dans une interview : « La monogamie est un impératif absolu. […] Il ne faut jamais enfreindre cette règle de la monogamie. Sinon, c’est l’anéantissement absolu ».[57]
Le tournage du film Qui a peur de Virginia Woolf semble avoir marqué un tournant. Ils y interprétaient un couple qui se déchire sur fond d’excès d’alcool. Ils en sortirent épuisés, plus tout à fait les mêmes, face à ce miroir cruel, d’autant plus que la carrière de Liz fleurissait, celle de Richard périclitait un peu, la rivalité entre eux s’accentua.
Dans ses carnets, il continuait d’affirmer son amour pour Elizabeth : « j’aime tellement cette femme que je n’arrive pas à croire à ma chance »[58]. Il constatait toutefois que les scènes de ménages au prétexte futiles étaient légions, il n’était pas en reste pour les provoquer.
Il rapporte une de ces disputes pour rien (qui met en lumière la rivalité phallique qui les occupait) :
« Hier, a été une drôle de journée. La première moitié s’est merveilleusement passée. Puis vers trois heures de l’après-midi, cela a dégénéré en dispute. C’était en grande partie ma faute. Sans raison précise, je suis devenue brusquement irritable et le suis resté jusqu’au soir, quoi que j’aie tenté, vainement, de me calmer vers les cinq heures. Bien évidemment, E. ne faisait rien pour arranger les choses et me tenait tête avec un orgueil bête, somme toute très masculin. Voici un bout de notre dialogue :
Moi (étant monté lire sur notre lit aux alentours de vingt heures) : Est-ce que ça empeste toujours dans la salle de bain ?
Elle : Oui
Moi : Non, ça ne sent plus rien. Ça vient peut-être de toi.
Elle : Va te faire foutre. (Elle redescend en bas tandis que je me replonge dans ma lecture.)
Elle : (étant remontée au bout d’une vingtaine de minutes pour se planter sur le pas de la porte avec une expression haineuse) : Je ne t’aime pas, je te hais. (Il se peut qu’elle ait employé le verbe « détester ».)
Moi (passant mon peignoir) : Bonne nuit, fais de beaux rêves.
Elle : Toi de même.
Et moi d’aller me coucher et de lire dans la chambre de Chris.
N.B. : Au bénéfice des acteurs de ce petit croquis de la vie domestique chez les Burton, il faut souligner que si les mots utilisés sont relativement anodins, ils sont cependant prononcés avec une venimeuse malignité. »[59]
Le décès de son frère accentua encore la culpabilité de Richard. Il sombra dans la dépression et un alcoolisme accru. Le couple se délabra inéluctablement, il se mit à la tromper. « Dès que je me suis senti attiré vers d’autres femmes, j’ai compris que la partie était terminée »[60]. Richard se montrait violent, il frappait parfois Elizabeth, ils se battaient[61].
Dans ces moments, il se compare à son père, se reprochant de s’être conduit à l’égard d’Elizabeth de façon exécrable : « Parfois je me sens tellement le fils de mon père que j’en ai la chair de poule. »[62].
C. A. : Elizabeth demanda le divorce après une hospitalisation de Richard pour alcoolisme, elle se sentait impuissante à l’aider.
S. M.-M. : Malgré leur divorce, ils ne parvinrent pas véritablement à se séparer. Elizabeth voulut se remarier, Richard n’était pas très convaincu mais consentit. Ils se séparent à nouveau en 1975.
Richard avouait encore à un journaliste en 1982 : « Elizabeth et moi sommes parfaitement assortis parce que nous savons de quoi l’autre parle ! Mais oui, j’aime Elizabeth, elle fait partie de moi… »[63].
C. A. : Symptôme, agressivité, narcissisme, non rapport : le mariage de Liz Taylor et de Richard Burton n’a pas fleuri dans un jardin des délices ! En dépit d’un amour partagé, marqué par l’agressivité : hantée par la figure du père, elle rencontre l’homme en colère, tandis que par un trait d’identification paternelle, il rencontre une femme fragile qu’il se voue à soigner. Elle le valorise par sa beauté et lui apprend la valeur du silence, il la fait briller comme femme et localise le regard dans les bijoux à l’incommensurable valeur. Dans le mariage, se révèle la dissymétrie des objets : le regard pour elle, la voix pour lui. Le mariage à grand spectacle soutient le narcissisme de l’un et de l’autre, (richesse et réussite pour lui, la figure de la belle épouse pour elle) mais le mariage les écorche aussi bien : rivalité virile pour lui (elle réussit mieux que lui) dévoilement du vide, du rien de la féminité pour elle. On sait peu de choses de leur divorce. On sait qu’autour d’un objet commun qui les ravage, l’alcool, ils ont fait couple toute une vie pour le pire et le meilleur. Plus loin que l’amour….
[1] Duetto lors des 48e Journées de l’ECF, le 16 novembre 2018
[2] Lacan J., « L’agressivité en psychanalyse », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 119.
[3] Taylor É., Elisabeth dit tout, Paris, Robert Laffont, p. 47.
[4] Ibid., p. 59.
[5] Ibid., p. 67.
[6]Ibid., p. 63.
[7] Bourgeois M.-F., Liz Taylor, ses amours, ses passions, son fabuleux destin, Collection privée, p. 53.
[8]Taylor É., Elisabeth dit tout, op. cit., p. 79.
[9]Ibid.
[10]Ibid., p. 57.
[11]Ibid.
[12] Ibid.
[13] Melvyn Bragg, Richard Burton. Sa vie, ses carnets intimes, Traduction Eric Chédaille, Paris: Presses de la renaissance, 1989, p. 20.
[14] Jacqueline Montigny et Edward Meeks, Les amants terribles, Liz Taylor & Richard Burton, Monaco, éditions Alphée . Jean-Paul Bertrand, 2009, p. 49.
[15] Lester David & Jhan Robbin, Richard et Elizabeth, London: Arthur Barker limited, 1977, p. 29. traduction: Sophie Marret-Maleval
[16] Jacqueline Montigny et Edward Meeks, Les amants terribles, Liz Taylor & Richard Burton, op. cit., p. 126.
[17] Melvyn Bragg, Richard Burton. Sa vie, ses carnets intimes, op. cit., p. 462.
[18] Ibid., p. 263.
[19] Ibid., p. 115.
[20] Ibid., p. 85.
[21] Jacqueline Montigny et Edward Meeks, Les amants terribles, Liz Taylor & Richard Burton, op. cit., p. 130.
[22] Ibid.
[23] Melvyn Bragg, Richard Burton. Sa vie, ses carnets intimes, op. cit., p. 53.
[24] Ibid., p. 484.
[25] Jacqueline Montigny et Edward Meeks, Les amants terribles, Liz Taylor & Richard Burton, op. cit., p. 237.
[26] Ibid., p. 237.
[27] Ibid., p. 237.
[28] Melvyn Bragg, Richard Burton. Sa vie, ses carnets intimes, op. cit., p. 475.
[29] Lester David & Jhan Robbin, Richard et Elizabeth, op. cit., p. 198.
[30] Melvyn Bragg, Richard Burton. Sa vie, ses carnets intimes, p. 300.
[31] Ibid., p. 376.
[32] Ibid., p. 127.
[33] Ibid.
[34] Ibid., p. 204.
[35] Ibid., p. 194.
[36] Ibid., p. 213.
[37] Ibid.
[38] Ibid., p. 221.
[39] Ibid.
[40] Lester David & Jhan Robbin, Richard et Elizabeth, op. cit., p. 73.
[41]Taylor É., Elisabeth dit tout, op. cit., p. 95.
[42]Ibid.
[43]Ibid., p. 99.
[44] Ibid., p. 94.
[45] Lacan J., Le Séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient, texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Seuil, 1998, p. 468.
[46] Melvyn Bragg, Richard Burton. Sa vie, ses carnets intimes, op. cit., p. 219.
[47] Ibid., p. 254 Le mariage eut lieu le15 mars 1964.
[48] Ibid., p. 236.
[49] Ibid., p. 240.
[50] Ibid., p. 260.
[51] Ibid., p. 280.
[52] Ibid., p. 304.
[53] Ibid., p. 307.
[54] Ibid., p. 263.
[55] Ibid., p. 329.
[56] Ibid., p. 306.
[57] Ibid., p. 240.
[58] Ibid., p. 348.
[59] Ibid., p. 385 .
[60] Ibid., p. 532.
[61] Ibid., p. 371-372.
[62] Ibid., p. 410.
[63] Jacqueline Montigny et Edward Meeks, Les amants terribles, Liz Taylor & Richard Burton, op. cit., p. 333.