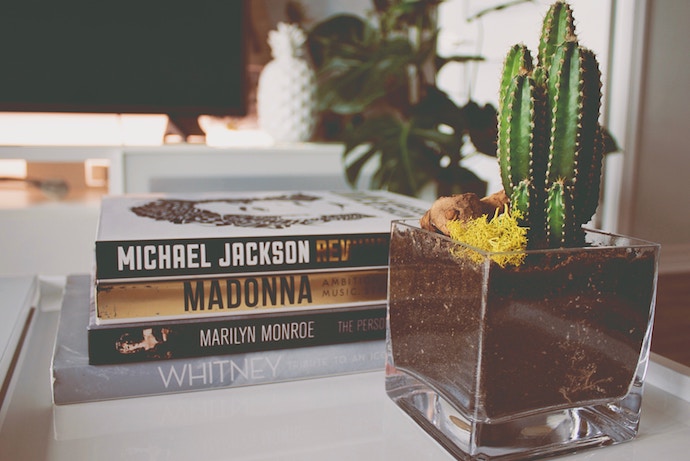C’est à partir de ce qui se saisit de l’impact de la vie sur l’organisme que le corps va se constituer, par l’image au miroir et l’intervention de l’Autre, pas sans un certain consentement du sujet [1]. Chacun est marqué par le vivant, « l’angoisse », dit Lacan, « née avec la vie »[2].
Nonobstant l’anatomie, le sexe biologique, les codes et les normes, l’expérience de la psychanalyse nous enseigne qu’il y a des jouissances au pluriel. Nulle harmonie : Freud disjoint les positions masculines et féminines, de l’anatomie, de la sexuation mais aussi de la culture. On ne peut établir une distinction homme/femme en se conformant à « l’anatomie et à la convention »,[3] écrira-t-il, dans sa conférence sur la féminité. Pour lui, la libido est « transgenre », « une seule libido est mise au service de la fonction sexuelle masculine aussi bien que féminine. » [4] Il déplacera la question vers la dysharmonie de la structure même de la pulsion : « Aussi étrange que cela paraisse, je crois que l’on devrait envisager que quelque chose dans la nature même de la pulsion sexuelle ne soit pas favorable à la réalisation de la pleine satisfaction. » [5] Chacun a à répondre de ce dérangement, ce trou dans lequel aussi bien va se loger sa singularité, ce que nous pouvons entendre dans l’expérience de l’analyse.
Marylin
Marylin Monroe témoigne que : « C’est par la voie du regard […] que ce corps prend son poids. »[6] Qui mieux que Marylin Monroe, incarnant La femme aux yeux du monde, pour témoigner de ce dérangement entre l’être parlant et son corps ? Elle témoigne dans son ouvrage Confessions inachevées, que nul désir ne l’a précédée, ni ne l’a accueillie : « Jamais ma mère ne m’avait embrassée ou tenue dans ses bras ». « Elle m’adressait rarement la parole, sauf pour me dire : « Ne fais pas autant de bruit Norma » alors qu’elle était en train de tourner les pages d’un livre. S’est installé un sentiment d’étrangeté vis-à-vis de son corps comme de sa mère. « Mon corps était plutôt un ami mystérieusement apparu dans ma vie, détenteur d’un pouvoir magique » [7].
Elle va incarner une image mais elle n’habite pas son corps. « Une disjonction existe chez elle entre l’imaginaire du corps et le réel de l’acte » [8]. « Je ne voyais aucun rapport entre mon corps et le sexe qui me laissait de glace ». « Malgré mon rouge à lèvres, mon mascara et mes rondeurs précoces, j’étais aussi sensuelle qu’un fossile […] J’aurais bien aimé désirer quelque chose. Mais je n’avais envie de rien » [9].
Tout bascule à ses douze ans : un matin alors que ses deux robes d’orphelinat sont déchirées, elle emprunte à une élève un sweater d’une taille inférieure à la sienne. Le sweat est très ajusté sur son torse. Arrivant à l’école, elle éprouve les regards qui se tournent vers elle : « l’existence changea à la suite de cette histoire. » [10] Elle s’entraine alors à marcher avec un déhanché d’une langueur voluptueuse devant le miroir. Elle s’approprie ainsi son corps par l’éprouvé lié à la rencontre des regards qui la rend visible à elle-même.
Elle en témoignera plus tard alors qu’elle chante en Corée pour l’armée américaine : « J’avais 17000 soldats devant moi…et ils hurlaient tous vers moi à s’en faire éclater les poumons […]. La neige avait commencé à tomber. Mais j’avais plus chaud que si je m’étais trouvée sous un soleil brulant. » [11] Expérience, éprouvé qu’elle nommera « sa lune de miel avec la 45 Division ».
Sam
Sam va nous apprendre que le corps n’est pas une donnée, qu’il est pétri de mots et d’éprouvés. Sam, 15 ans, vient consulter, car il pleure et ne se sent pas bien. Cela l’étonne car il a été bien accueilli dans son nouveau lycée après une année de déscolarisation. Il ne peut dire ce qui le fait pleurer, mais ce qu’il sait, c’est qu’il a aussi beaucoup pleuré récemment, suite à des entretiens obligatoires avec une personne, dans le cadre d’un accompagnement ordonné par le juge : à chaque entretien, elle l’appelait par son prénom de naissance, un prénom de fille. Elle le prononçait, dit Sam, en appuyant bien sur les syllabes. Alors qu’il lui demande pourquoi elle insiste ainsi, prêt à exploser – lui si calme d’habitude –, elle lui répond : « Quand je te regarde, je vois une fille alors je t’appelle par ton prénom officiel de fille. » Une grande tristesse s’en est suivie. Il dit : « Quand j’étais enfant, on me genrait masculin, les gens lambda dans la rue, dans les magasins, disaient « il », on parlait de moi comme d’un garçon, je me sentais bien dans ces mots. Puis j’ai grandi, mes traits se sont féminisés et on me genrait féminin. Quand j’ai commencé à aller sur les réseaux, j’ai demandé à ceux que j’ai rencontré qu’ils me choisissent un prénom masculin et qu’il s’adresse à moi au masculin : je me sentais plus à l’aise nommé ainsi ». Sam, depuis lors a adopté ce prénom dans la vie.
Comme l’indique Jacques Lacan, « C’est toujours à l’aide de mots que l’homme pense. Et c’est dans la rencontre de ces mots avec son corps que quelque chose se dessine. »[12] Sam poursuit : « J’aimerais toucher à mon image : que mes traits (ma mâchoire), ma voix soient plus masculins pour qu’on me « genre » masculin. » Ce n’est pas qu’il veuille ressembler à un garçon ou une fille, qu’il veuille faire coïncider son image à son genre. Non, ce n’est pas ça…Ce qu’il veut, c’est retrouver cet éprouvé des mots dans le corps. Il a interprété que les mots et le regard de l’autre sont noués : on le « genrait » masculin, car il ressemblait à un garçon ; écho au pied de la lettre de celle qui lui dit : je te vois fille, je te dis fille. Sam ne revendique rien, être un garçon, une fille, faire des choses de garçon ou de fille, peu lui importe, ce n’est pas sa question. Il évoque un effet direct dans le corps des mots de l’autre le désignant, de l’autre « lambda », comme il dit. Il sait juste qu’il a éprouvé quelque chose, qu’il y a eu un impact des mots sur son corps lorsque petit, on l’a « genré » garçon.
Sam et Marylin témoignent de ce rapport dérangé de l’être parlant à son corps, qui ne se laisse dompter ni par la nature, ni par la culture, les codes ou les normes. Question, effet dans le corps, symptôme, chacun a à répondre de ce dérangement. Une psychanalyse, expérience de parole et de corps, peut permettre d’en approcher le mystère pour en constituer un savoir au un par un.
[1] Texte issu d’une table ronde « Homme, femme… Genre compliqué ! », dans le cadre du « Week-end Lacan », organisé du 12 au 14 avril 2019 à Toulouse, par l’ACF-Midi-Pyrénées.
[2] Lacan J., « Les complexes familiaux dans la formation de l’individu », Autres écrits, Paris, Seuil ,2001, p. 34.
[3] Ibid., p. 153.
[4] Ibid., p. 176.
[5] Freud S., La vie sexuelle, Paris, PUF, 1992, p. 64.
[6] Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme » (1975), La Cause du désir, Paris, Navarin, n° 95, avril 2017, p. 9.
[7] Monroe M., Confession inachevée, Paris, Laffont, 1974, p. 36.
[8] Arpin D., Couples célébres, Liaisons inconscientes, Paris, Navarin, 2016, p. 91.
[9] Ibid., p. 40.
[10] Ibid., p. 38.
[11] Charyn J., Marylin : la dernière déesse, Paris, Gallimard, 2007, p. 200.
[12] Lacan J., « Conférence à Genève sur le symptôme », op. cit., p. 12.