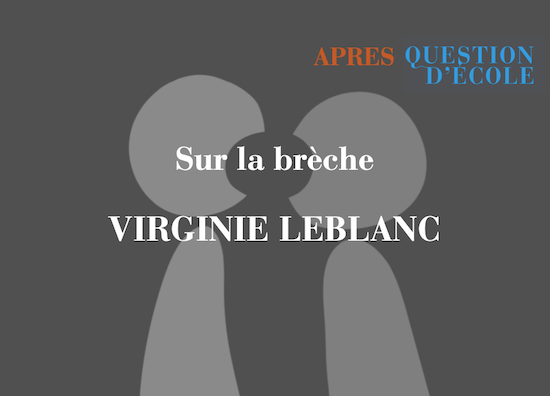Intervention d’Esthela Solano-Suarez à « Question d’École » le 1 février 2020. Version écrite pour HB, nouvelle série.
Ce qui s’enseigne dans le contrôle est relatif à une temporalité et cette temporalité est attenante au point où on en est dans l’élucidation de son propre « je ne veux rien savoir », élucidation qui s’accomplit notamment dans l’expérience d’une analyse.
On ne peut être enseigné dans le contrôle qu’à l’instar de l’accomplissement d’un certain nombre de franchissements produits dans l’expérience analytique. D’où il s’en déduit la nécessité pour le praticien de se soumettre à l’expérience d’une analyse.
Ceci étant dit, nous touchons du doigt que ce que le contrôle enseigne ne relève pas d’une compétence technique, ni de la maîtrise d’un savoir. Il est plutôt question d’une subversion de la position subjective qui rend aisée de se priver de la jouissance de la parole pour produire un vide susceptible de laisser ouvert le champ qui accueille la parole de l’autre.
Avoir l’expérience de la portée et du poids des mots, voire de la puissance de la parole, provient de l’expérience de lecture de l’inconscient accomplie dans l’analyse. Encore faut-il se rompre à la lecture de ce qui dans la pratique est énoncé par celui qui s’adresse à nous.
Dans ce sens, le contrôle est un dispositif qui peut enseigner non seulement à savoir se taire mais aussi à savoir lire. C’est l’orientation indiquée par Lacan dès lors qu’il énonçait le 19 avril 1977 qu’un « psychanalyste […] dépend de la lecture qu’il fait de son analysant, de ce que celui-ci lui dit en propres termes » et il ajoutait : ce que son analysant « croit lui dire. Cela veut dire que tout ce que l’analyste écoute ne peut être pris au pied de la lettre »[1].
J’en déduis qu’il n’y a du psychanalyste que dans la fugacité de l’acte de lecture, qui est coupure. Ceci suppose de faire un tri, de ne pas se laisser entrainer par les effets du signifiant sur le versant des effets de signification, visant en revanche ce qui résonne dans la matérialité sonore de ce qui s’entend, ce qui suppose de faire passer la parole du côté de l’écrit.
Le contrôle servirait alors à nous sortir de l’embrouille des effets de suggestion de la parole analysante, à nous dépêtrer de la routine du signifié, afin de cerner le « moterialisme » du dire, toujours aléatoire, disruptif, venant trancher dans le vif de la matière sonore et dont les résonnances ne sont pas sans comporter un écho dans le corps.
Avec le temps qui passe inlassablement, lorsque les années de pratique se succèdent et s’accumulent, pouvons-nous être assurés de notre position d’analyste au point de cesser d’avoir recours au contrôle ? Il me semble que non. D’abord parce que le contrôle est un moyen pour l’analyste de reprendre la parole, de devenir analysant, afin de s’entendre soi-même, devant la présence d’un autre en chair et en os, s’entendre dire sa lecture de chaque cas, mettant alors en acte qu’il n’y a d’analyste que toujours en devenir. C’est un exercice éthique, qui nous extrait de l’infatuation de se croire analyste. C’est un exercice qui nous décomplète, qui nous préserve du risque de l’autisme de la pratique et d’une certaine crétinisation secrétée par la routine. En cela c’est un exercice salutaire.
Fiat trou ! C’est le tranchant à préserver et à recommencer sans cesse, tout au long d’un exercice qui, relevant de l’infinitude, ne se soutient et ne s’oriente que d’un rapport renouvelé au S(Ⱥ). J’entends ainsi la proposition de Lacan quand il formule : « Ce que je sais, c’est que le discours analytique ne peut se soutenir d’un seul »[2].
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIV, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », leçon du 19 avril 1977, Ornicar ?, n°17-18, printemps 1979, p. 12, souligné par l’auteure.
[2] Lacan J., « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 531.