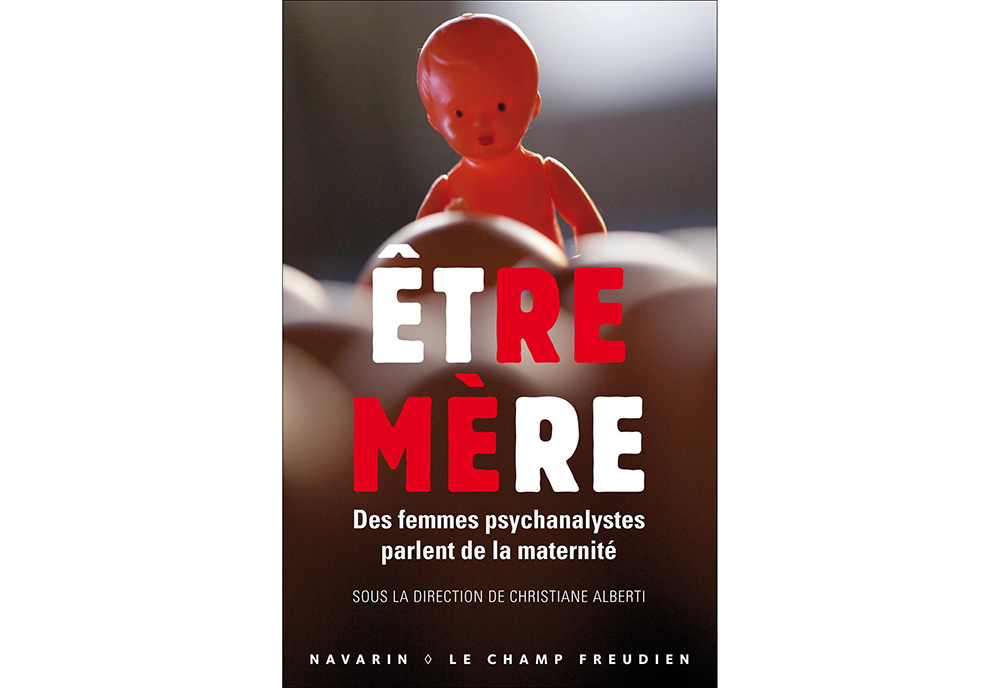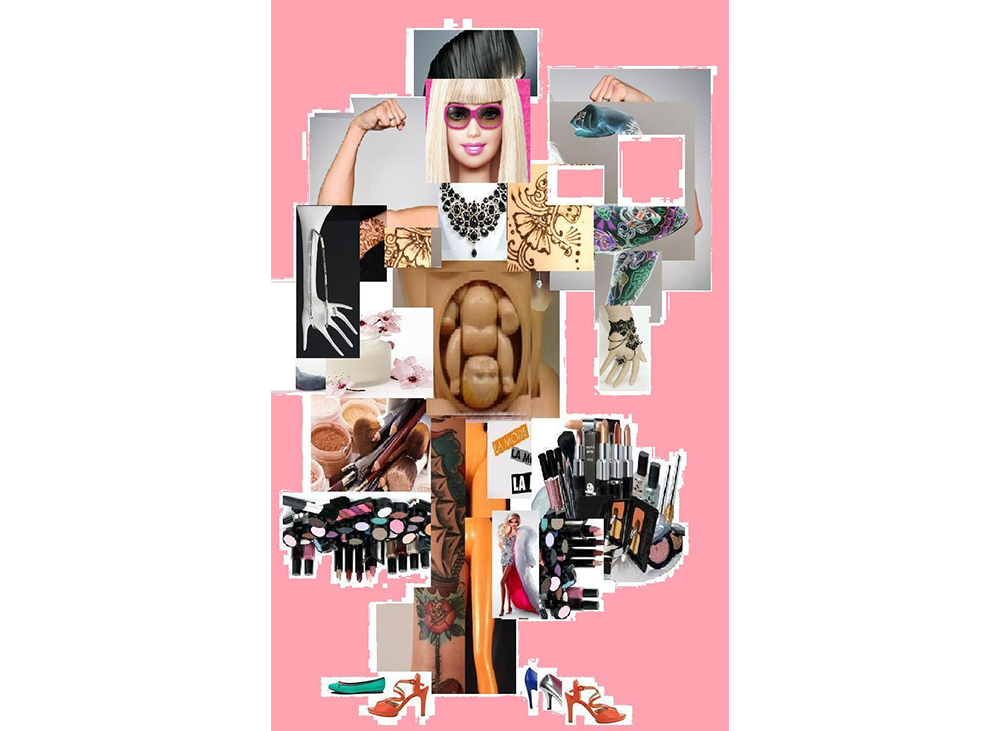Lacan vivant !
Ceux qui n’ont pas eu la chance d’être là lundi soir[1] ont vraiment manqué quelque chose : les auteures du livre Être mère nous ont présenté, chacune, ce qu’elles nous ont transmis dans ce joli volume. Comme nous le dit Christiane Alberti, qui l’a dirigé, la mère ne tient son être que du langage, en tant qu’être parlant. Les contradictions du désir de maternité se présentent tous les jours dans la clinique et font symptôme. Les chapitres du livre, présentés par ses auteures, traitent des symptômes contemporains de la maternité, de la demande illimitée d’enfant faite à la science jusqu’au déni de grossesse et l’infanticide. À entendre ce qui se dit dans une analyse, on pourra s’orienter dans les mutations contemporaines, du côté de l’analyste, et s’en rendre responsable, du côté analysant. Et il n’est pas besoin d’être une femme pour avoir des fantasmes de maternité ! Alors, qu’est-ce qu’une mère? Quand elle y parvient, c’est quelqu’un qui aide un enfant à se séparer d’elle, à être nommé par un désir qui ne soit pas anonyme. Mais la souffrance maternelle, très répandue, témoigne d’une expérience subjective difficile à décrire. Si l’on pensait que La femme n’existe pas, puisque chacune fait objection à l’universel, mais que La mère existe, nos collègues nous ont montré qu’il n’y a pas de savoir sur la maternité comme mode d’emploi. À chacune la possibilité de pouvoir l’inventer dans une analyse. Le débat, dans l’intimité de la Librairie Tschann, avec un public attentif, nous a apporté des surprises. Une sage-femme a témoigné de combien les instruments qu’elle trouve chez Lacan l’aident à entendre ces femmes qu’elle aide à accoucher. « Lacan est vivant », dit-elle, contente d’échanger avec des psychanalystes. Une autre participante a voulu savoir pourquoi on parle toujours de certains concepts, dans un monde complètement changé. Nos collègues lui ont démontré, sur place, l’opérativité des concepts du dernier Lacan dans l’actualité. C’est ce que chacun aura à vérifier dans la lecture de ce volume qui s’annonce passionnante !
[1] Le lundi 19 janvier 2015 s’est tenue à la Librairie Tschann, 126 boulevard du Montparnasse à Paris, une rencontre autour du livre « Être mère – Des femmes psychanalystes parlent de la maternité», sous la direction de C. Alberti, avec les contributions de Agnès Aflalo, Francesca Biagi-Chai, Marie-Hélène Brousse, Carole Dewambrechies-La Sagna, Dominique Laurent, Anaëlle Lebovits-Quenehen, Esthela Solano-Suárez et Rose-Paule Vinciguerra, Paris, Navarin/Le Champ freudien, 2014, en présence des auteures. Lire la suite