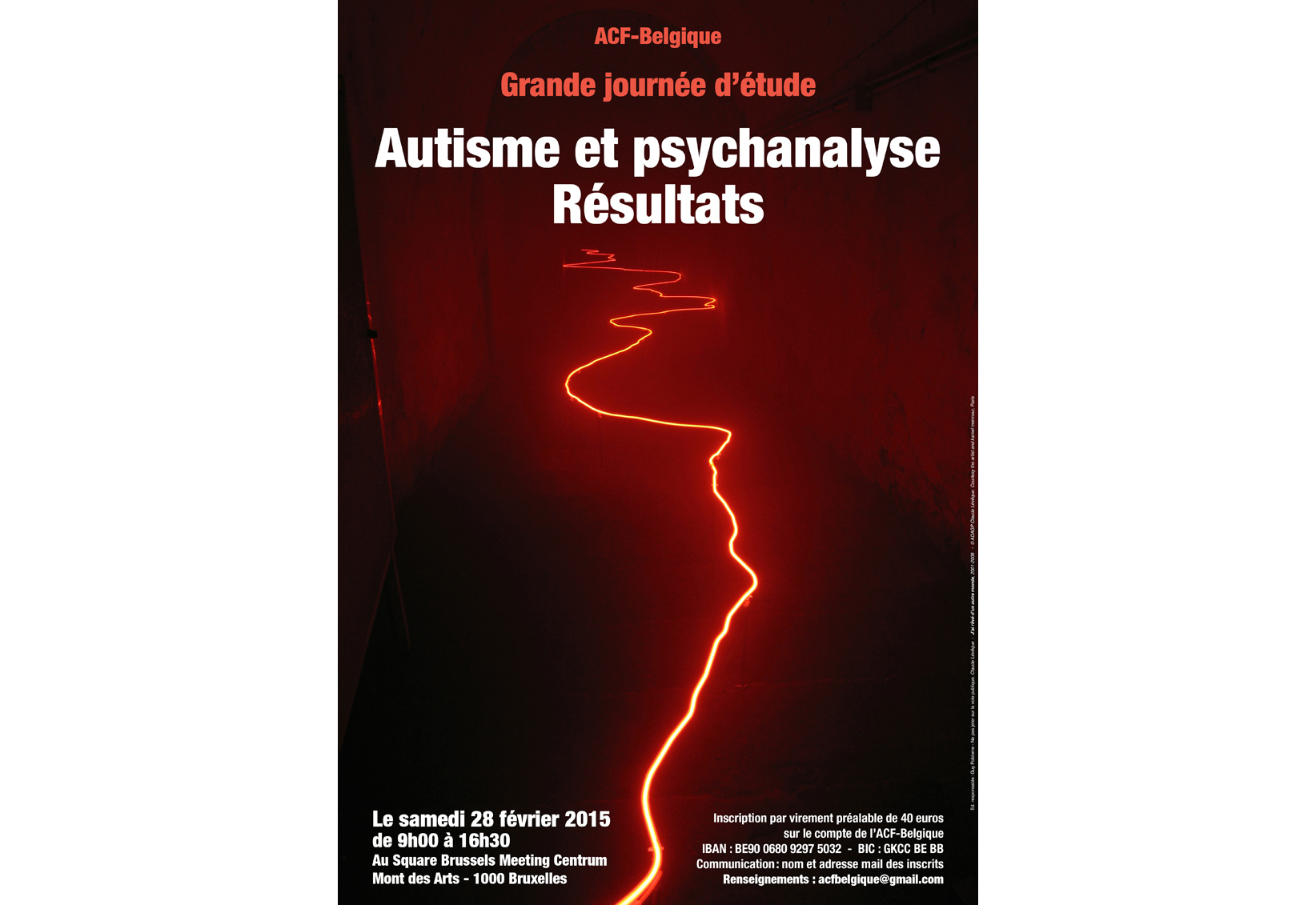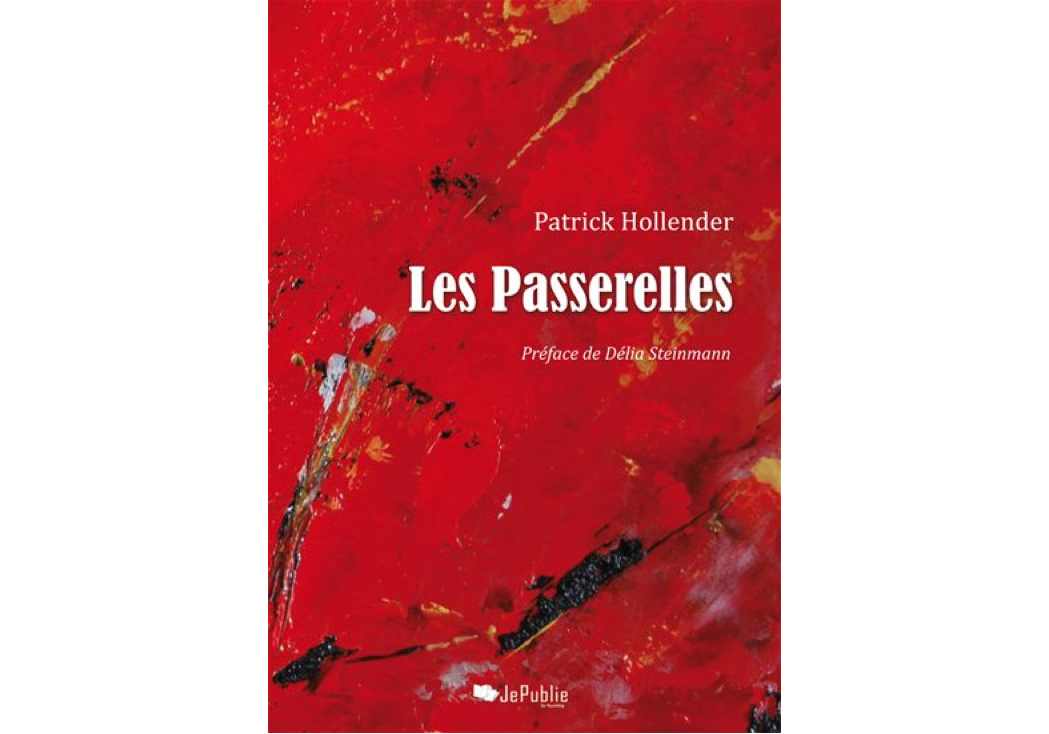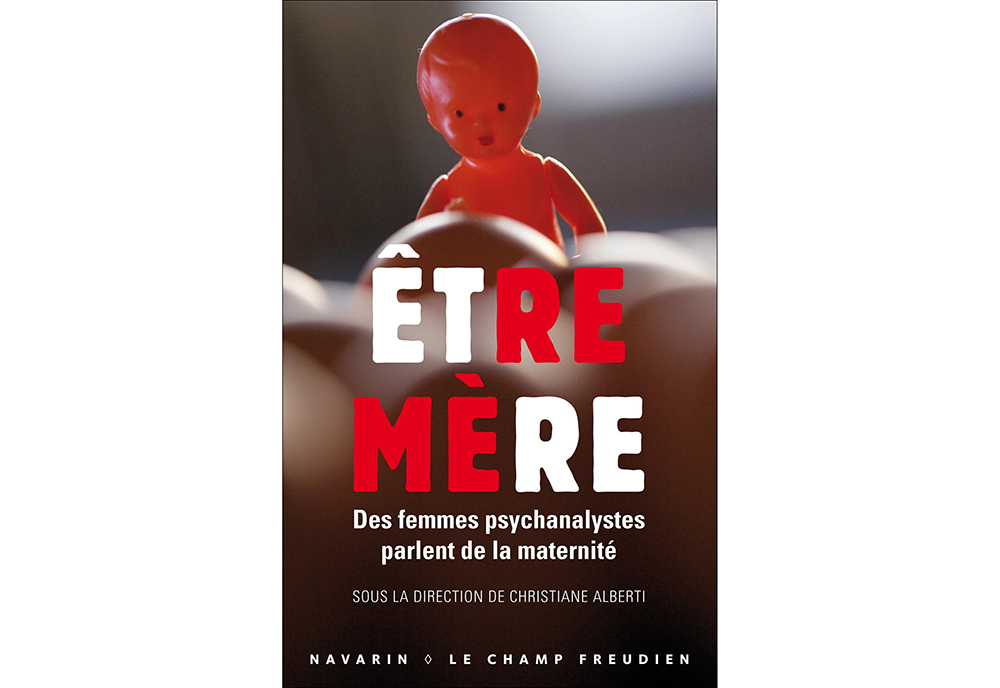Interview L’Hebdo-Blog – ACF CAPA
Le partenaire amoureux, la guerre, les objets... quel trépied en CAPA !
Proposés par les différentes commissions des bureaux de ville de l’ACF CAPA, ces thèmes se déploient dans le cadre d’activités distinctes qui ont lieu sur l’ensemble de ce grand territoire que couvre notre ACF, allant d’Amiens à Reims en passant par Chalon en Champagne, Laon, Charleville-Mézières, Lille et Saint-Quentin. C’est à l’Atelier – notre séminaire interne, activité régionale ouverte prioritairement aux membres de l’association – qu’il revient de rassembler cette communauté de travail autour d’un thème proposé par le bureau. L’Atelier, qui planche actuellement sur « Le symptôme et le corps parlant », a aussi depuis cette année une nouvelle visée, s’inscrire dans la commission scientifique de notre colloque régional biennal dont le prochain, en décembre, aura pour titre « Folies – ce qui ne cesse pas ».
Mais, comme vous le relevez, d’autres types de nouages surgissent à partir des thèmes a priori indépendants, issus du désir de chaque commission. Cette année, ceux-ci se sont trouvés articulés une première fois, dans la foulée des événements tragiques de janvier, par la lecture qu’a faite Gil Caroz de notre proposition à venir nous parler des « rapports » entre les parlêtres. Son titre « Le partenaire amoureux » était choisi de longue date mais l’actualité l’a amené à le tordre en mettant en tension l’amoureux et celui qui choisit au contraire l’usage des armes. Placé sous l’empire de la jouissance phallique, la guerre permet aux individus qui s’y vouent d’éviter de se confronter à l’autre, supplémentaire, singulier. « Faire la guerre pour ne pas se confronter à l’amour », telle fut la proposition heuristique qui émergea pour penser la nécessité de ces deux activités humaines et leur différence au regard de la jouissance. Entrée en matière inattendue pour le prochain colloque à Reims, intitulé « Extension du domaine de la guerre ».
Cette pluralité de travaux et d’axes d’étude trouve aussi la possibilité d’un resserrage dans la composition des documents de Scripta. À chaque numéro, une trace de cette diversité se révèle, avec un point de vue qui permet dans l’après-coup des éclairages inédits et une lecture des phénomènes de notre époque.
Un dernier mot sur le thème des prochaines journées de l’ECF qui résonne avec celui de notre cycle de conférences à Lille : « Homme, femmes, enfant, quels rapports, quels symptômes ? », et avec le café psychanalyse à Amiens : « Faire couple, avec qui ? Avec quoi ? ». La question du « couple » ou du « rapport » dans l’orientation lacanienne ne peut se déployer sans que viennent à l’esprit l’aphorisme de Lacan sur l’inexistence de – l’écriture – du rapport sexuel ou les dernières avancées de Jacques-Alain Miller sur la jouissance Une dans son Cours « L’être et l’un ». Ces balises indexent l’impossible qui leste l’éthique de la psychanalyse, mais elles ouvrent du même coup à l’exploration de toute une série de montages, de bricolages, de ratages qui font le sel des relations entre parlêtres. Et le succès tant des conférences que des soirées du café-psy indique que le public attend la psychanalyse lacanienne sur ces questions.
Lire la suite