Lacan dans la maison de Freud
Un événement a eu lieu à Vienne les 24 et 25 avril 2015.
 Cet événement n’est pas simplement venu de ce que le congrès du « Nouveau Champ lacanien autrichien » (Das Neue Lacansche Feld Österreich) ait eu lieu ces jours-là, mais de ce que, pour la première fois, il se soit tenu dans le Musée Sigmund Freud, au 19 de la Berggasse, c’est-à-dire dans la maison de Freud.
Cet événement n’est pas simplement venu de ce que le congrès du « Nouveau Champ lacanien autrichien » (Das Neue Lacansche Feld Österreich) ait eu lieu ces jours-là, mais de ce que, pour la première fois, il se soit tenu dans le Musée Sigmund Freud, au 19 de la Berggasse, c’est-à-dire dans la maison de Freud.
La centaine de participants a ainsi été accueillie par la nouvelle directrice du Musée Sigmund Freud, Madame Monika Pessler, venue, dès le premier jour, entendre Laure Naveau parler de l’invention par Lacan de la passe.
Le thème du congrès était « Le corps parlant » et était par là même articulé à celui du prochain congrès de l’AMP. Les sujets abordés ont été variés : les moments de crise dans une analyse (en lien avec le thème du congrès de la NLS), l’hystérie au XXIe siècle et la clinique psychanalytique d’orientation lacanienne.
Les interventions, faites par Laure Naveau et Pierre Naveau, ainsi que le cas présenté par Magdalena Sorger-Domenigg, ont été commentés par des membres d’une communauté de travail qui rassemble, depuis plusieurs années déjà, des psychanalystes autrichiens et israéliens – Avi Rybnicki (qui était l’organisateur du congrès), Shlomo Lieber, Mabel Graiver, Dafna Amit-Selbst et Norbert Leber.
Les séquences ont été modérées par Helga Treichl, Elisabeth Müllner, Roman Widholm, Christian Kohner-Kahler, Gerhard Reichsthaler et Andreas Steininger.
Les participants venaient donc de Vienne, mais aussi, par exemple, de Linz ou de Stuttgart, ainsi que de Jérusalem et de Tel Aviv.
Ce congrès du « Nouveau Champ lacanien autrichien » donnera lieu à une publication en langues anglaise et allemande.
Cette année 2015, Lacan est entré chez Freud.
Lire la suite







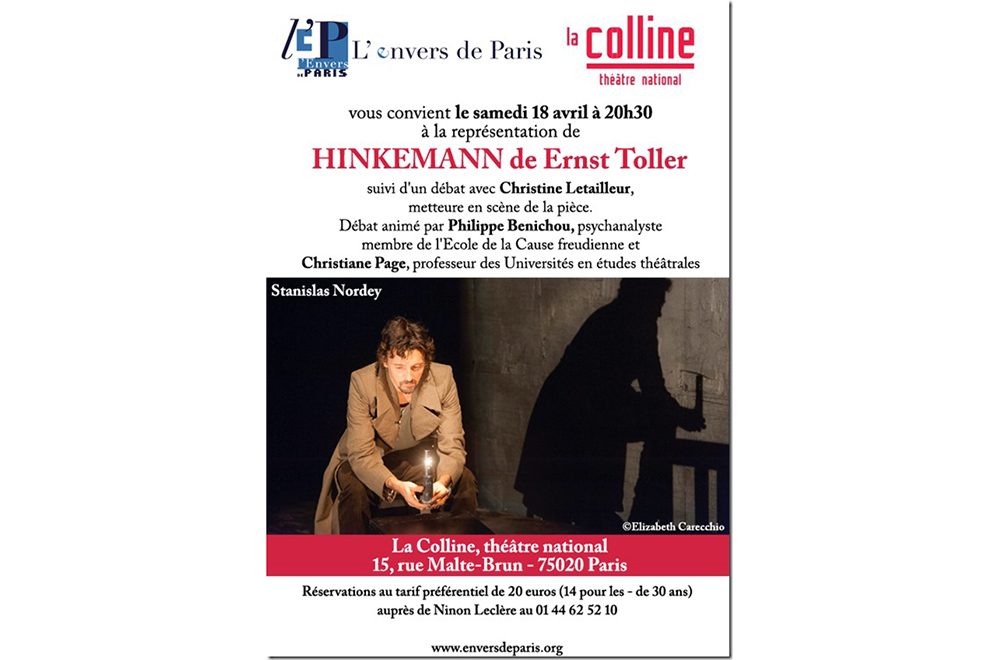

![La solitude de la victime[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/04/JouclaHD.jpg)
