Victime : Réalités plurielles
Anne Danièle Lanos-Joulin est psychologue. Elle travaille dans une association d’aide aux Victimes près du tribunal de Rouen. Dans le cadre de la préparation à Pipol 7, elle vient décliner le signifiant « victime » à partir des rencontres de sa pratique.
La prise en compte de la victime est une préoccupation récente en France : une trentaine d’années seulement.
Mais si le législateur a pu faire évoluer la place de la victime dans la procédure pénale, sa dimension psychique, son statut de sujet reste difficile à faire entendre. Le recueil de la parole des victimes, notamment celle des enfants et des personnes vulnérables pendant les auditions, a besoin de considérablement évoluer.
La procédure Mélanie en est une bonne illustration. Elle prévoit l’enregistrement vidéo de la déposition de l’enfant lors du dépôt de plainte initial afin d’éviter la répétition de son témoignage dans le cabinet du juge d’instruction et lors du procès, les magistrats disposant de ces enregistrements.
En réalité, un enfant victime est filmé deux fois : au commissariat de police et dans le cabinet du juge d’instruction. Il doit également venir témoigner lors du procès d’assises !
Les policiers eux-mêmes se sentent très souvent démunis ou vite exaspérés face à une victime qui pleure et ne parle pas. Cela a pour effet d’accroître le sentiment de culpabilité chez la victime qui ne se sent pas crue et qui regrette d’autant plus d’avoir parlé. Il est en effet très difficile pour une femme battue, par exemple, de livrer tout ce qu’elle a subi, mais aussi tout ce à quoi elle a pu consentir. Il est donc important qu’elle ressente qu’elle a en face d’elle un professionnel qui l’écoute sans jugement car ses révélations s’accompagnent très souvent d’un sentiment de honte.
Mais le réel de l’agression physique et/ou sexuelle rencontrée par le sujet peut avoir un effet désorganisateur et l’angoisse liée à cet événement a besoin d’être contenue. Le sujet peut se trouver totalement submergé par les images de l’agression, par les rêves traumatiques. Il ne peut dans ce premier temps le rattacher à la chaîne signifiante.
Freud dans Au-delà du principe de plaisir nomme traumatiques « les excitations externes assez fortes pour faire effraction dans le pare-excitations »[1].
Face à cette effraction psychique, le psychologue orienté par la psychanalyse va chercher à border la souffrance liée à la rencontre de la mort, de la violence de l’autre ou de la perte tragique d’un être cher et favoriser un travail d’élaboration qui permette au sujet de déployer son histoire personnelle afin de « replacer le traumatisme dans le cours de sa vie où il peut trouver à le lier »[2].
Mais la victime qui vient de déposer plainte est également assaillie de questions, de doutes suscités par la procédure pénale dans laquelle elle s’est engagée. Nous allons ensemble baliser le parcours judiciaire, en donnant sens aux convocations qu’elle va recevoir, mettre en lumière le lien qui existe entre les différents acteurs judiciaires afin qu’elle puisse avoir une représentation globale de la procédure et se l’approprier.
Un des moments les plus redoutés – mais aussi le plus attendu – de cette procédure reste le procès, surtout s’il se déroule devant la cour d’assises car la victime sera obligée de s’y présenter et d’y témoigner quel que soit son âge ! Il reste l’objet de nombreuses représentations imaginaires, angoissantes et souvent erronées, d’attente d’explications sur les motivations de l’accusé et parfois d’excuses de sa part.
C’est pourquoi nous consacrons un certain nombre d’entretiens à sa préparation, en expliquant son déroulement, en se rendant dans la salle des assises afin que la personne puisse visualiser les lieux, « s’y projeter », et qu’elle soit moins impressionnée le premier jour.
Les victimes que nous recevons ne sont ni dans la vengeance ni dans la revendication. Elles souhaitent une condamnation et « être reconnue en tant que victime pour pouvoir tourner la page, passer à autre chose », comme elles disent. L’une d’elle pourra me dire que la procédure lui avait permis de faire une distinction entre elle et son frère (condamné pour viols), « avant on était liés par le non-dit, le dépôt de plainte est venu nous séparer. Une fois la distinction faite, le résultat m’importait peu, il fallait qu’il soit reconnu coupable, mais qu’il soit condamné ou non m’importait peu ».
Il nous arrive également d’accompagner physiquement certaines victimes lors des procès d’assises. Il s’agit assez souvent d’adolescentes ou de personnes vulnérables dont la famille s’est détournée, ayant pris parti pour l’accusé.
Certains parents endeuillés par l’assassinat de leur(s) enfant(s) peuvent solliciter notre soutien. Au-delà de leur demande d’étayage, nous veillons à les protéger de l’horreur de certains témoignages d’experts ou de photographies projetées sur écran.
Au-delà de la procédure, le procès peut venir clore ce que l’effraction psychique provoquée par l’événement traumatique est venu ouvrir. Il offre à la victime la possibilité d’un apaisement, contrairement au désir de vengeance qui la mènerait dans une impasse. Reconnue victime par la condamnation de l’accusé, elle va pouvoir se détacher de ce statut pour reprendre le cours de sa vie parfois infléchi par ces événements, certains traumatismes laissant des cicatrices indélébiles.
[1] Freud S., « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, Payot, 1920, p. 71-72. [2] Briole G., Qu’est-ce qui traumatise ? Conférence prononcée à la Section clinique de Lyon, consultable ici : http://sectioncliniquelyon.fr/wa_files/Briole-traumatisme.pdf Lire la suite




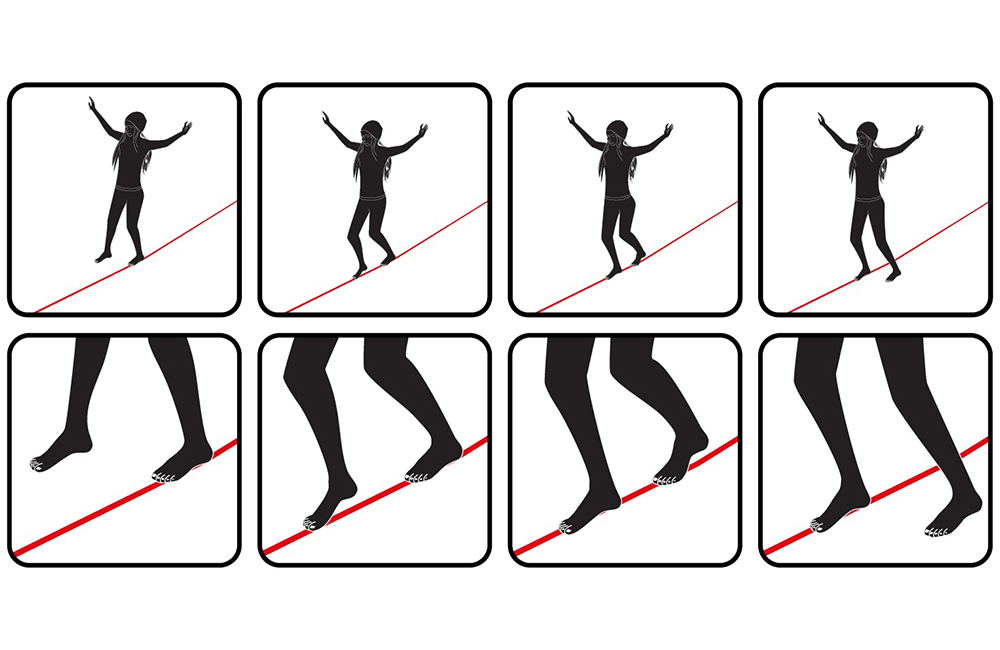
![« Me voici donc seul sur la terre […] »](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/06/blanchetHD.jpg)




