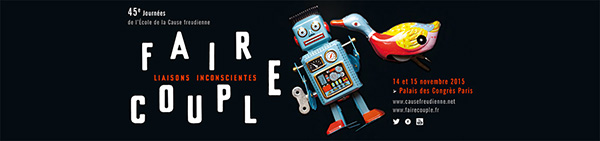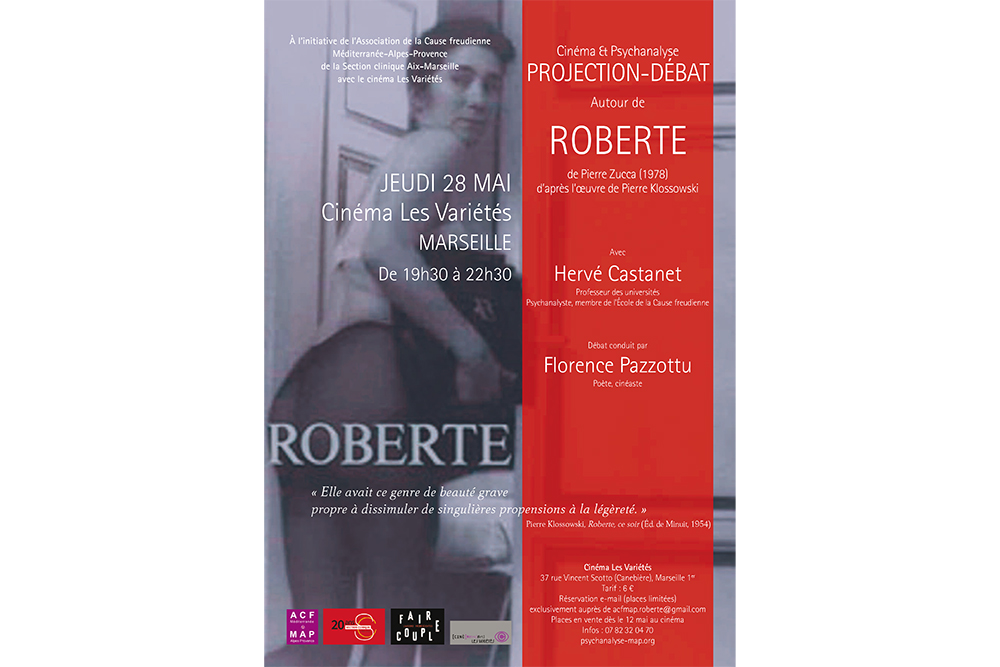Condamnés l’un à l’autre ?
À La Rochelle, après une connexion « Voile et psychanalyse » organisée par l’ACF-Aquitania, Isabelle Autissier, bien que pressée par le temps, a accepté de répondre à trois questions que lui a posées Paul Gil, membre de l’ECF et responsable[1] de la délégation Charente-Maritime.
Dans son dernier roman, « Soudain, seuls », le couple des personnages principaux se retrouve en effet condamné l’un à l’autre, quasiment naufragé sur une île déserte des « cinquantièmes ». C’est avec ingéniosité qu’Isabelle Autissier situe l’essentiel de l’action sur l’île de Stromness, qui fut l’issue salvatrice pour l’expédition Shackleton et garde des traces de l’industrie baleinière passée. Des trois protagonistes, elle, lui et leur couple, lequel parviendra-t-il à survivre ?
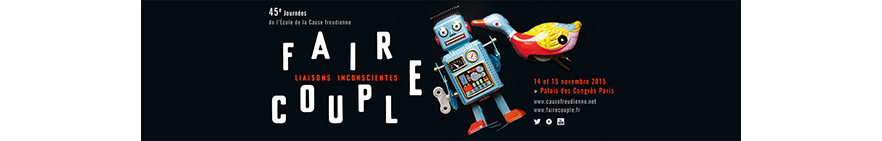
Isabelle Autissier répond à trois questions de Paul Gil
Paul Gil – Dans votre dernier roman, le drame de ce couple tient-il à l’affrontement de l’amour et de ce que vous appelez l’instinct de vie ?
Isabelle Autissier – Ce n’est pas un affrontement entre l’amour et l’instinct de vie, à un moment le sentiment d’humanité, d’empathie, d’amour, qui est le sentiment propre à l’humain, vient se heurter à ces sortes de limites physiques que sont la faim, le froid. Et à ce moment, effectivement, ce qui m’a intéressée, c’est que le couple se pose la question : est-ce qu’on survivra mieux ensemble, ou chacun de son côté ?
Donc, ce n’est pas totalement une concurrence mais, oui, la question se pose.
PG – Accepteriez-vous qu’on voie dans l’épreuve de ce couple particulier une allégorie du couple en général ?
IA – D’une façon pas aussi violente, oui bien sûr, parce qu’un couple est à mon sens une façon de composer avec ce qu’on peut être individuellement, personnellement, et avec ce qu’on trouve dans le couple qui nous conduit à changer un peu nos stratégies, nos façons de faire, pour tenir compte de l’autre. Soit parce qu’on a de l’empathie, soit pour faire perdurer cette association qui permet de belles choses.
PG – Dans votre roman, c’est une femme qui dit à Louise, l’héroïne, que « l’instinct de vie ne se communique pas. Toi et moi, nous l’avons, pas eux. » Alors, est-ce que l’instinct de vie est plus évidemment féminin ?
IA – Je ne sais pas, je le fais dire à ce personnage parce que c’est dans sa logique. Elle le dit aussi à son interlocutrice, pour l’encourager. Lui dire : « Tu ne t’es pas trompée », c’est une façon de la rassurer sur ce qu’elle a fait. Je pense tout de même, ne serait-ce qu’à travers la maternité, qu’il y a un rapport à la vie qui n’est pas le même pour les hommes et les femmes. C’est à mon avis plus distancié, compliqué, pour les hommes. Les hommes donnent la vie par l’intermédiaire d’une femme, ce n’est pas un rapport immédiat pour eux.
[1] Avec Sophie Lafossas-Leynaud.
Lire la suite


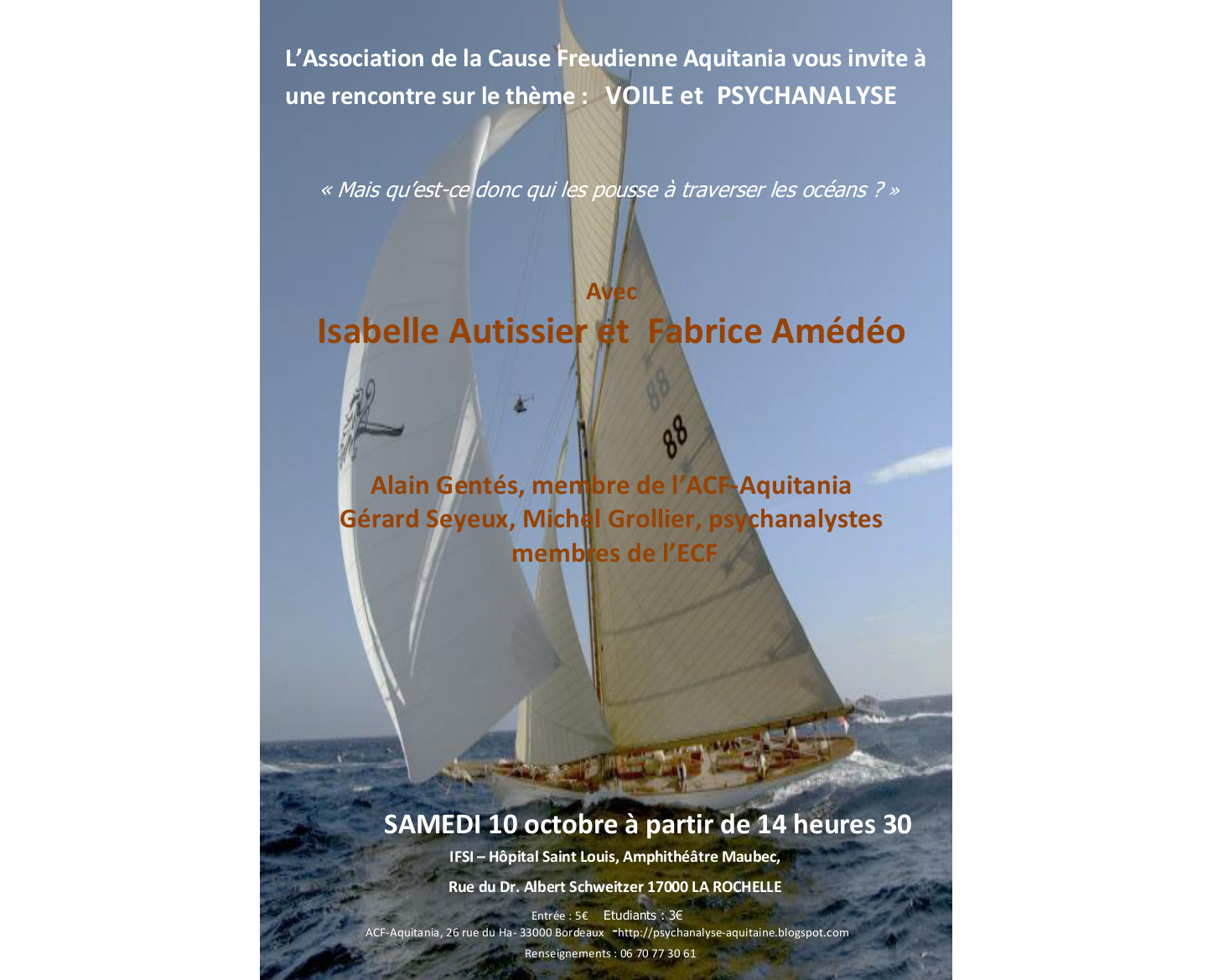



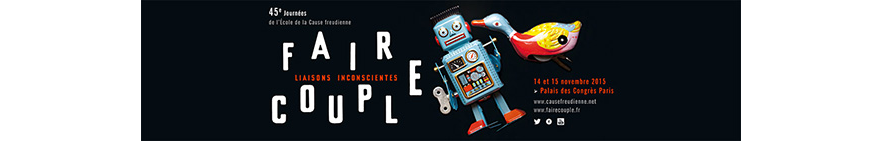 Marie-Noëlle Faucher a témoigné de sa pratique au lieu d’accueil enfants-parents « La Baroulette » lors de la Conversation « Couples avec enfants » qui s’est tenue à Rochefort, organisée par l’ACF Aquitania en préparation aux 45es Journées de l’ECF « Faire couple – Liaisons inconscientes » qui se tiendront à Paris les 14 et 15 novembre 2015.
Marie-Noëlle Faucher a témoigné de sa pratique au lieu d’accueil enfants-parents « La Baroulette » lors de la Conversation « Couples avec enfants » qui s’est tenue à Rochefort, organisée par l’ACF Aquitania en préparation aux 45es Journées de l’ECF « Faire couple – Liaisons inconscientes » qui se tiendront à Paris les 14 et 15 novembre 2015.