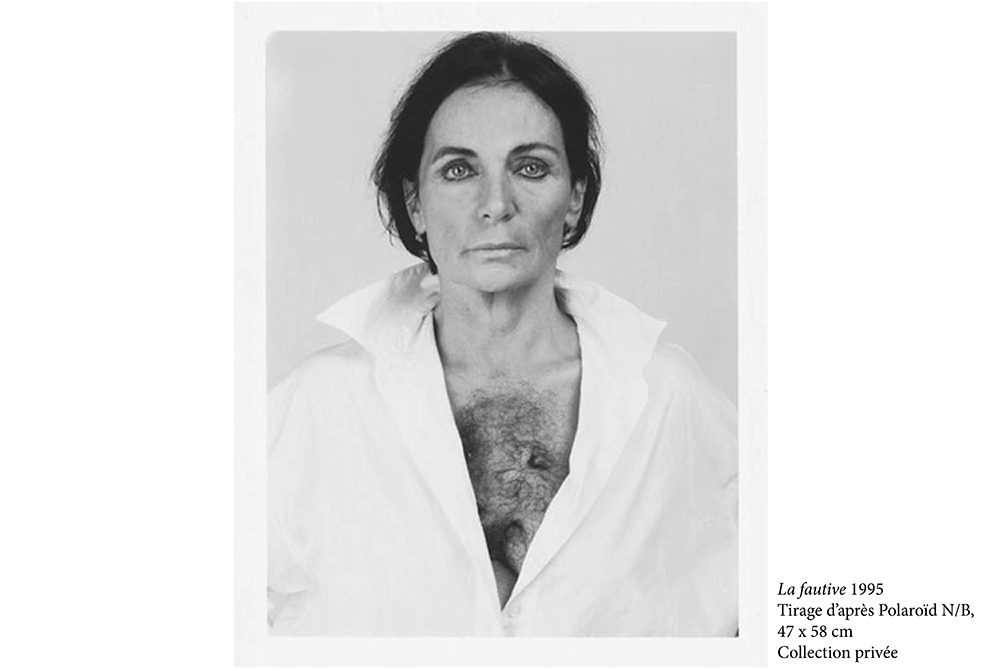L’instant où Anjelica Huston a rencontré Jack Nicholson
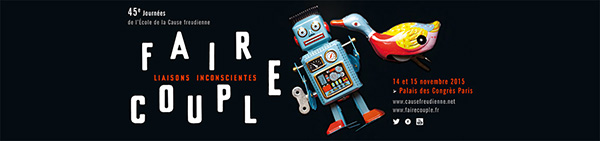
« Dix-sept ans d’amour fou », tel est le titre imparable accompagnant l’image du couple légendaire à la une du dernier Vanity Fair : Anjelica Huston et Jack Nicholson. Si l’on parle beaucoup d’eux ces temps-ci, c’est à cause de la sortie toute fraiche de l’autobiographie d’Anjelica[1]. Elle livre un récit frivole, toute occupée qu’elle est à faire briller jusqu’au vertige les insignes d’une vie dans le luxe et le velours, récit qui n’empêche pas de se rendre à l’évidence : elle a aimé follement cet homme. Et pourtant, la fulgurance de la première rencontre, en deux temps, donne déjà le cadre de ce qui, au cœur de cet amour, sera aussi pour elle son tourment.
Anjelica a 22 ans et parcourt un soir Mulholand Drive à bord d’une Masseratti rouge aux côtés d’une amie qui l’a convaincue de l’accompagner à une fête chez Jack. Elle ne l’a jamais rencontré en chair et en os, mais est loin d’avoir oublié son impression, l’ayant vu pour la première fois crever l’écran d’un cinéma londonien dans Easy Rider. Sa plume rend alors compte de l’éclat de la première rencontre : « La porte d’une modeste maison à un étage style ranch s’est ouverte, et le fameux sourire est apparu ». Apercevant pour la première fois celui dont le sourire sera appelé plus tard « le sourire du tueur », elle se dit : « voilà un homme dont on peut tomber amoureuse »[2].
Ils passeront la nuit ensemble et il lui donnera rendez-vous quelques jours plus tard pour une première sortie romantique qu’il annule le jour même, prétextant un autre engagement. Déçue de « passer en second », elle se console en allant au restaurant avec un couple d’amis. À peine est-elle arrivée au resto qu’ils lui annoncent que « l’engagement » de Nicholson est en réalité une jolie blonde avec qui il vient de monter à l’étage. Cette première rencontre avec le mensonge du partenaire s’accompagne aussitôt d’un choix subjectif : non pas quitter la scène dans ce qu’elle a d’intenable, mais s’y inclure : « J’ai saisi mon verre à vin et, le cœur battant, j’ai saisi l’escalier à mon tour. Jack était en compagnie d’une belle et jeune femme que j’ai immédiatement reconnue : son ex-petite amie Michelle Phillips […] J’ai levé mon verre joyeusement en lançant : " Je suis en bas, et je voulais simplement dire bonjour ". Imperturbable, il m’a présenté Michelle »[3]. Nicholson et Huston commenceront à vivre ensemble peu après.
L’instant de la rencontre contient déjà la matrice de mille autres scènes où elle sera à chaque fois à la place de la femme que l’on trompe et à qui l’on ment. Rencontre amoureuse, certes, mais aussi avec une jouissance qui, à la différence de Nicholson, sera sa fidèle partenaire. À peine descendues les marches du Festival de Cannes, Nicholson part sur la mobylette de la première admiratrice croisée. Voilà que la femme qui faisait la une des magazines de luxe et qui, dix minutes plus tôt était bombardée par les flashs des photographes de la Croisette, devient un objet délaissé sans un mot, sanglotant sur un trottoir. Avec ou sans voile, la tromperie du partenaire fera toujours pleurer cette femme pour qui la question n’est pas de savoir s’il faut le quitter ou pas, mais ce qu’il va faire pour se faire pardonner.
Sait-elle quelque chose du fantasme et de la jouissance palpitant au cœur de ces scènes qu’elle décrit néanmoins comme un martyre ? Rien ne le prouve. Cependant, elle n’est pas sans savoir trois choses. La première concerne l’aveu sur le type d’homme qu’elle peut aimer : « Même s’il m’est arrivé d’aspirer à ce qu’on attend généralement d’une relation sentimentale – réciprocité, partage, affection et fidélité – la dure réalité est que ces qualités-là ne m’excitaient pas forcément. J’ai toujours été attirée par […] des hommes sur qui on ne peut pas compter »[4]. De ce point de vue, avec Nicholson qui déclinera jusqu’au bout sa demande de l’épouser, elle sera servie.
Deuxièmement elle sait qu’elle a choisi Nicholson pour sa ressemblance avec un autre homme, marqué lui aussi par les signifiants « coureur de jupons » et « dédain dévastateur » et auquel elle n’a cessé de déclarer sa flamme du début à la fin de sa biographie. Cet homme est son père, le réalisateur John Huston, dont le portrait amoureux ouvre le livre : « Un mètre quatre vingt-dix et des longues jambes, mon père était plus grand, plus fort et doté d’une plus belle voix que tout autre. Il avait les cheveux poivre et sel, le nez cassé des boxeurs et une dégaine spectaculaire »[5].
Le troisième point concerne un aperçu sur sa manière de reproduire la vie amoureuse de ses parents. Comme eux, elle finira par répondre en miroir à la tromperie répétée du partenaire : « Quand il m’est devenu impossible de me voiler la face plus longtemps, je n’ai pas su comment réagir. J’aurais beaucoup aimé parler de ce dilemme à ma mère. J’ignore si ses aventures l’avaient réconfortée ou n’avaient eu d’autre but que de contrarier mon père. Elle n’avait jamais évoquée en ma présence l’infidélité de son mari ni même la douleur qu’elle éprouvait. Elle avait intériorisé énormément de choses et je reproduisais le même schéma »[6]. Elle ne pourra quitter Nicholson que le jour où il lui annonce que « quelqu’un va avoir un enfant ». Point d’insupportable touchant au réel de sa difficulté à avoir des enfants avec le seul qu’elle voyait, c’est le cas de le dire, à la place du père.
Jamais en analyse, ces trois instants de voir resteront pour elle sans conséquence. Avoir des insights sur ses liaisons inconscientes ne suffit pas à s’arracher de la scène de sa jouissance. Il se pourrait que seule une rencontre qui ne ressemble à aucune autre, celle avec un psychanalyste, soit la condition pour y parvenir.
[1] Huston, A., Suivez mon regard, Éditions de l’Olivier, 2015. [2] Ibid., p. 265. [3] Ibid., p. 266. [4] Ibid., p. 459. [5] Ibid., p. 20. [6] Ibid., p. 405. Lire la suite




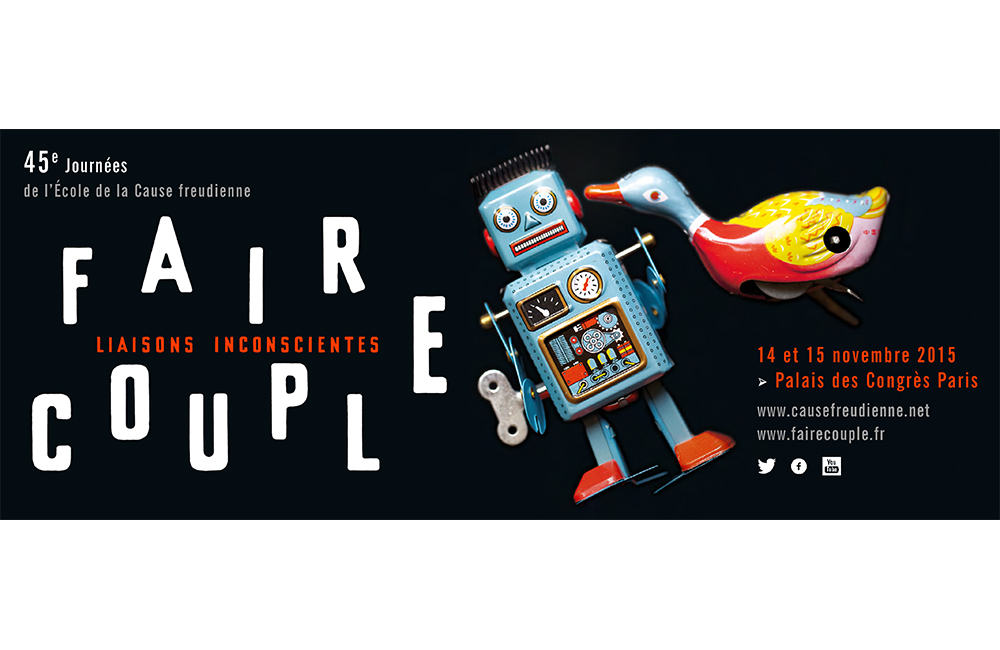
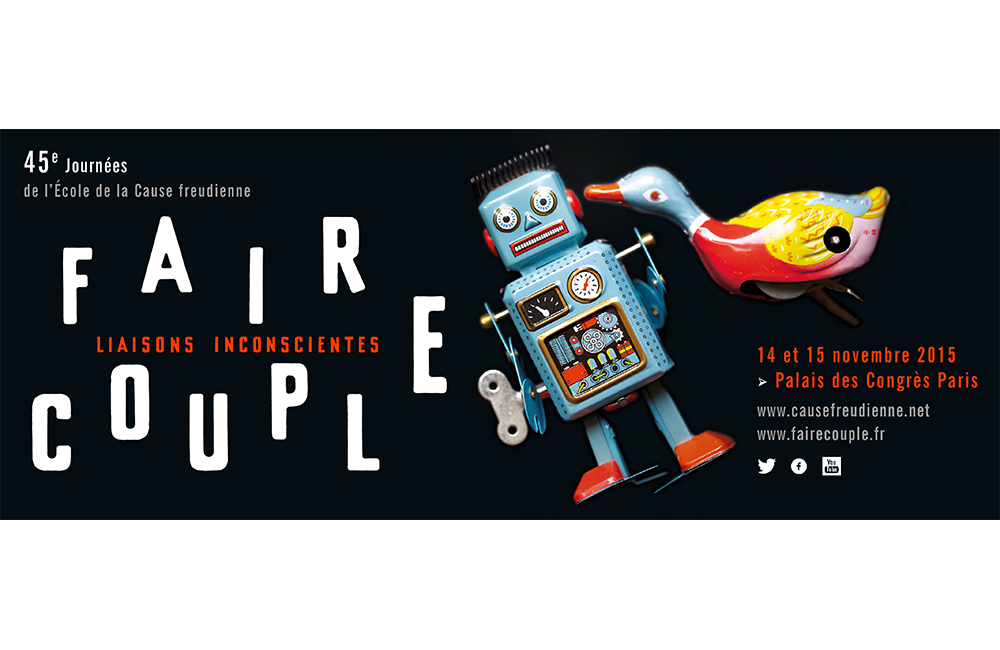
![Antigone : « Une victime si terriblement volontaire »[1] !](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/05/AlbertHD.jpg)