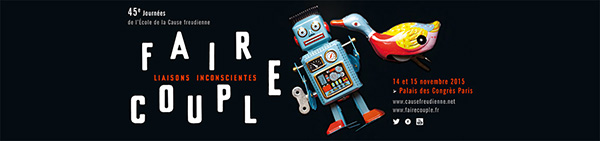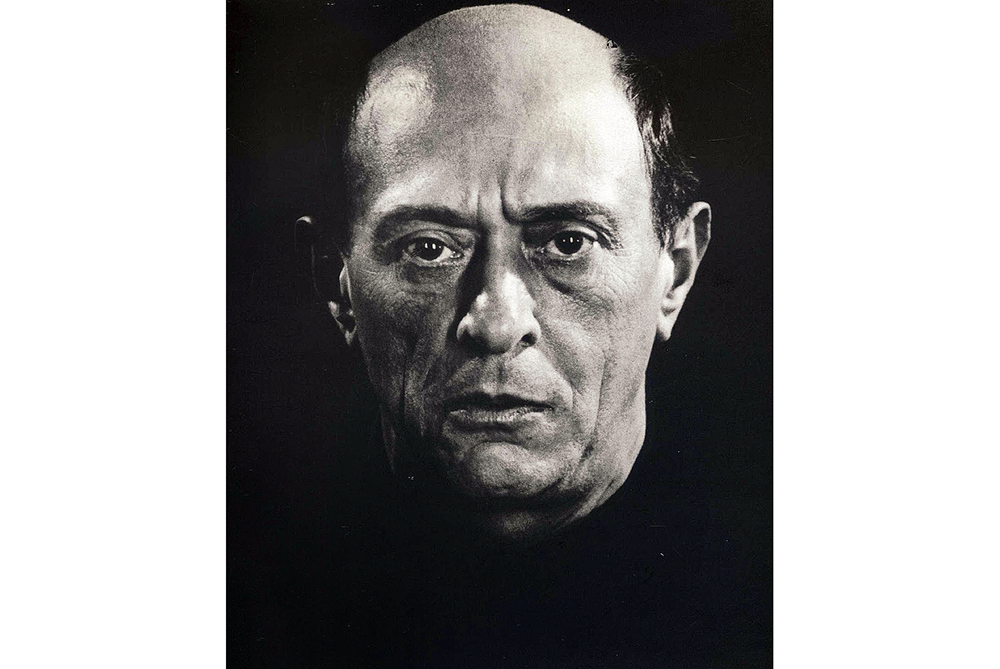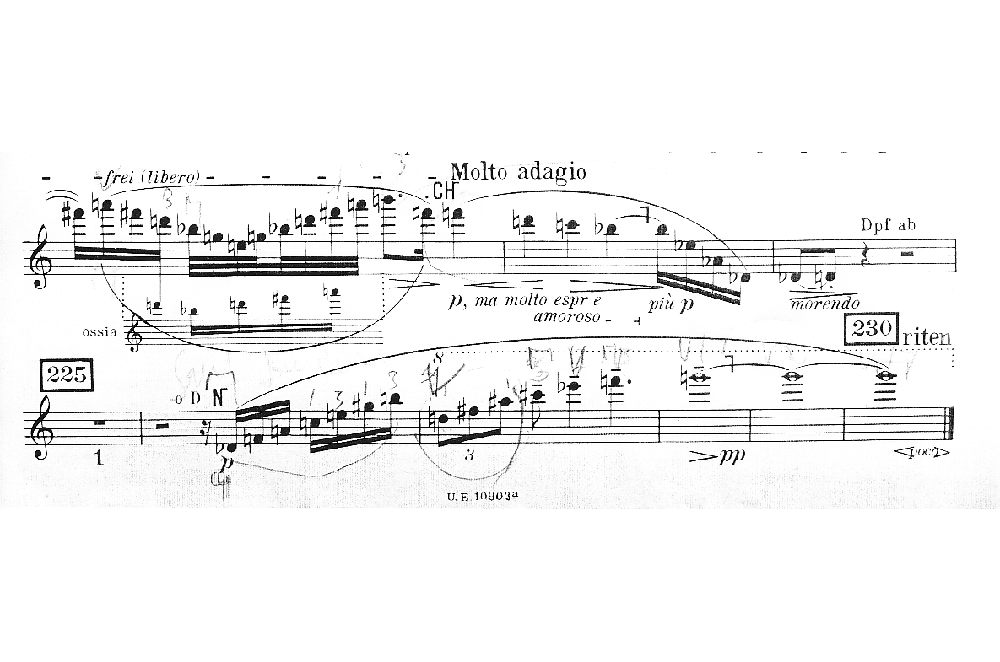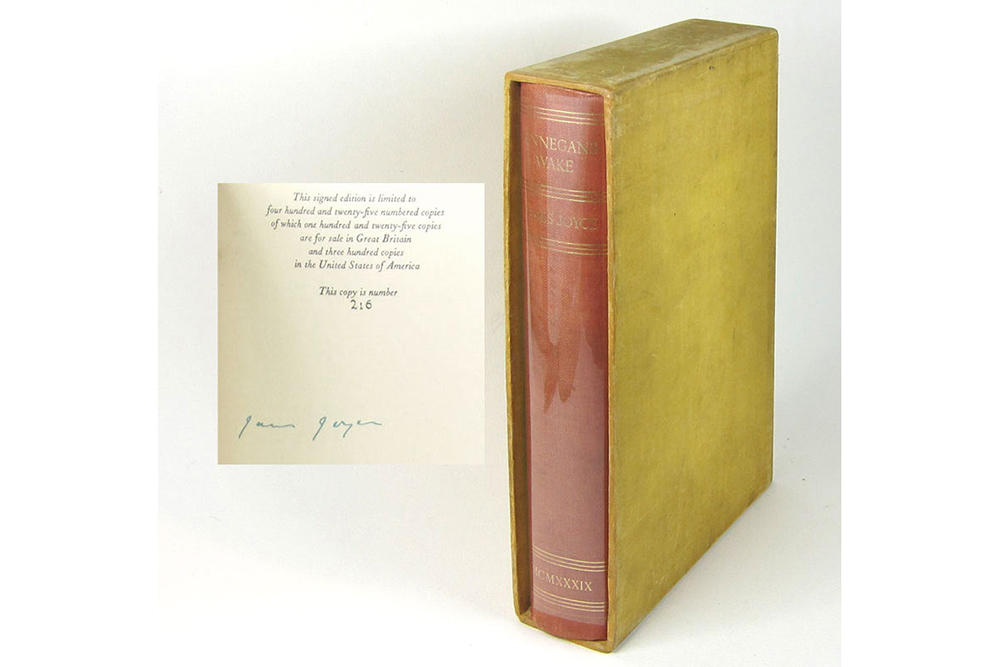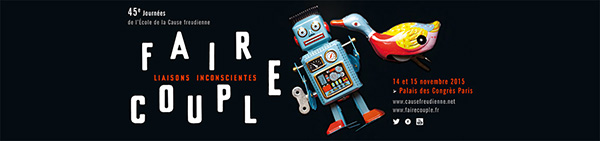La déroute de Madison
Zoom sur la rencontre de Robert et Francesca dans le film Sur la route de Madison (1995) réalisé par Clint Eastwood, avec ce dernier et Meryl Streep. Quelle est la modalité de Faire couple lorsqu’une séparation anticipée des corps est la condition même d’un amour éternel ?
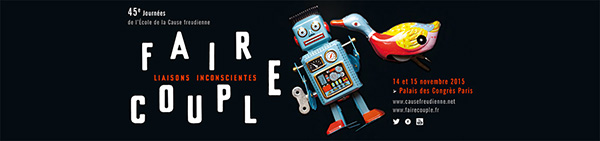
Francesca vit avec son mari Richard et ses deux enfants Mickael et Caroline dans une ferme de l’Iowa. Alors que ceux-ci sont partis quelques jours à une foire dans l’Illinois, le photographe Robert Kincaid (Clint Eastwood) lui demande sa route. Elle le guidera à travers les ponts couverts du comté de Madison qu’il est chargé de photographier pour le National Geographic. Pendant quatre jours, ils vont vivre intensément une passion amoureuse. Ils décideront de se quitter au retour de la famille de Francesca. Ils ne se reverront jamais conformément à la promesse qu’ils se sont faite, ils s’aimeront secrètement toute leur vie durant.
Comment expliquer la possibilité même d’une rencontre amoureuse entre la parfaite petite ménagère de l’Iowa, épouse fidèle et mère de famille exemplaire, et le bel aventurier célibataire et sans attache ? Jacques-Alain Miller rappelle dans son texte « La théorie du partenaire »[1] que l’incidence du non rapport sexuel nécessite la liaison symptomatique. Entre l’homme et la femme, il y a le symptôme, le symptôme fait couple. Plus précisément, « Le symptôme de l’un entre en consonance avec le symptôme de l’autre »[2]. Pouvons-nous faire l’hypothèse d’un accrochage symptomatique entre Robert et Francesca au fondement de leur rencontre ?
Francesca
Toute sa vie, Francesca a renoncé à tout ce qu’elle désirait, ses rêves, le plaisir d’enseigner, de voyager, jusqu’à Robert, son grand amour… Le film laisse à penser que c’est un renoncement assumé. C’est bien la position de l’hystérique dont Lacan dira que sa manœuvre – entretenir l’insatisfaction du désir – vise une seule chose : soutenir le désir du sujet. Pour que le désir survive, elle n’a de cesse qu’il reste insatisfait, c’est sa manière de le soutenir vivant[3]. Peut-être Francesca jouit-elle de ce renoncement, peut-être est-ce là le noyau de son symptôme. Celui-ci est alimenté par un fantasme, celui d’être une femme de l’Iowa parfaite, femme fidèle et mère dévouée à ses enfants, une femme qui « donne sa vie à sa famille », dira-t-elle.
Robert
Cet homme séduisant ne veut pas s’engager auprès d’une femme, ne souhaite pas s’installer quelque part, préfère vivre seul et libre. « J’aime tout le monde de la même façon, sans aimer quelqu’un en particulier », dit-il. Il se présente comme « une sorte de citoyen du monde, tout le temps sur les routes [où] j’étais plus chez moi n’importe où que dans une seule maison ». Voilà peut-être le texte d’un fantasme qui vient se nouer à son symptôme. En effet Robert observe le monde – en le photographiant – mais sans jamais s’y impliquer. Il fait penser à ce que Lacan écrit à propos de l’obsessionnel qui met son désir à l’abri, en restant « hors du jeu »[4]. Nous sommes là en présence d’un désir impossible soutenu par ce sujet.
La rencontre entre Francesca et Robert est symptomatique – ils cèdent à leur désir à la condition de se séparer au point le plus vif de leur passion amoureuse : cette séparation répond aux exigences symptomatiques du renoncement pour l’une, de l’impossibilité pour l’autre, et la jouissance qui en résulte est au fondement de ce couple. C’est bien parce qu’elle va immanquablement être contrariée que la rencontre amoureuse est possible entre ces deux-là.
Mais les amants n’ont jamais renoncé à leur amour, ce qui a fait tenir la danse de ce couple durant toute leur vie est une autre histoire…
[1] Miller, J.-A., La théorie du partenaire, Quarto, n°77, Bruxelles, 2002, p. 11. [2] Ibid., p. 24. [3] Lacan J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, Paris, Éditions de La Martinière et Le Champ Freudien Éditeur, 2006, p. 505. [4] Op.cit., p. 506. Lire la suite