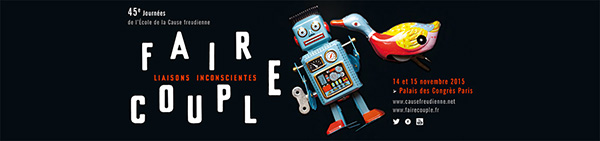Les lundis de l’AMP « Vers Rio 2016 »
La seconde soirée des lundis de l’AMP animés par Laure Naveau a réuni une fois de plus un public nombreux ce lundi 30 novembre. Ce fut l’occasion d’écouter les interventions de Gérard Wajcman et Pierre Naveau autour du thème de travail de ces soirées : « La psychanalyse change, ce n’est pas un désir, c’est un fait. »[1]
Laure Naveau, coordinatrice de l’AMP avec l’ECF, a rendu cette soirée particulièrement vivante par la pertinence de ses analyses et de ses questions. C’est à propos des attentats qu’elle a lu la quatrième de couverture du dernier Scilicet qui vient juste de paraître : « La psychanalyse tend à rendre possible pour chacun l’invention, selon sa singularité, d’une alliance entre son corps et les ressources de la parole contre le pire. »[2]
Gérard Wajcman nous a ramenés au premier temps de l’enseignement de Jacques Lacan dans une intervention intitulée « Notes à propos du stade du miroir ». Lacan est entré dans la psychanalyse avec le corps. Si celui-ci est au cœur du stade du miroir, on y trouve également le drame, tel que Lacan le qualifie, drame qui est en résonance avec l’air du temps puisqu’au moment même où il prononçait sa célèbre communication avaient lieu les fameux Jeux olympiques de Berlin de 1936. Cette conférence intitulée « Le stade du miroir » fut prononcée à l’occasion du XIVe Congrès de psychanalyse de l’IPA à Marienbad, le premier auquel participait Lacan. Son texte inédit a été perdu et n’a pas pu être prononcé en entier par Lacan, interrompu au bout de dix minutes par Ernest Jones[3]. Dès le lendemain, Lacan se rendait à Berlin pour « aller prendre l’air du temps, un temps lourd de promesses, à l’Olympiade »[4], malgré le désaccord d’Ernest Kris. Il allait ainsi confronter sa théorie du stade du miroir au miroir du stade. En effet, ces JO étaient l’exaltation de l’image idéale du corps athlétique, un spectacle d’art total au service de la propagande nazie. Il s’est agi de ce que Walter Benjamin appelle « une esthétisation de la politique »[5] en conclusion de son texte L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Lacan a donc rencontré à Berlin cette exaltation des corps, mais aussi de l’esprit de corps à travers l’accomplissement de l’unité d’un peuple dans la foule, au sens de Jean-Claude Milner qui distingue foule et masse[6]. Cette foule qui faisait corps aux JO a détruit la division du corps social qui fondait la démocratie. Cette solution nazie impliquait la guerre sur le front de la beauté, beauté opposée à la « laideur juive », beauté qui impose le silence. L’élection d’une image idéale a un effet de voile du réel et de ségrégation. Le corps olympien a été l’annonce des corps amoncelés des charniers des camps de concentration. Ces JO ont donc réalisé une fête du peuple et de la beauté qui a utilisé les deux dimensions politiques du corps : spectacle des corps et jouissance du spectacle.
Aujourd’hui, les avancées de la technologie tendent à dissoudre le réel dans l’image. L’art renvoie à la contemplation et à la jouissance du regard alors que les produits de la science renvoient à l’observation et à l’inquiétude qui lui est liée. Dans notre monde contemporain, nous jouissons de nous regarder comme le soulignent les selfies. « Au temps d’Homère, l’humanité s’offrait en spectacle aux dieux de l’Olympe ; c’est à elle-même, aujourd’hui, qu’elle s’offre en spectacle. Elle s’est suffisamment aliénée à elle-même pour être capable de vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de tout premier ordre. Voilà l’esthétisation de la politique que pratique le fascisme.»[7]
Pierre Naveau, avec un titre très pascalien, « Le corps a ses résons », a développé les effets de la résonance du dire sur le corps en lien avec le psychanalyste.
Il nous a tout d’abord rappelé la célèbre citation de Lacan dans le Séminaire Le sinthome « Les pulsions sont l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire »[8]. Le corps est donc sensible au dire. La résonance du dire, de l’équivoque signifiante (résons), produit dans le corps une réponse (répons), c’est la voix. La résonance donne une voix au corps qui dès lors se met à parler et devient le corps parlant. « Le corps parlant parle en termes de pulsions. », nous précise J.-A. Miller[9]. Ce corps parlant est le corps dans lequel des événements de discours ont laissé des traces qui font la singularité du sujet en lien avec son histoire. « Ces traces dérangent le corps »[10] et « y font symptôme pour autant que le sujet soit apte à lire ces traces, à les déchiffrer ». Pour cela, il faut un psychanalyste et c’est alors que le corps a ses résons. Le psychanalyste fait donc partie du corps parlant. Il opère à partir de l’interprétation équivoque qui permet que l’écho dans le corps soit perçu et que la résonance pulsionnelle puisse être entendue par le sujet. Pour être entendue, elle doit être articulée. La pulsion a été présentée par Lacan « sur le modèle d’une chaîne signifiante »[11] susceptible d’être déchiffrée et qui est faite de « substance jouissante »[12]. Le signifiant est donc la cause matérielle de la jouissance. P. Naveau a fait alors l’hypothèse que la pulsion qui va en silence trouve dans le symptôme en tant qu’événement de corps l’articulation signifiante qu’il s’agit de déchiffrer afin de pouvoir la lire. Il a illustré son propos à partir d’un cas clinique d’une jeune anorexique, Roseline, cas tiré du livre d’Hélène Bonnaud Le corps pris au mot[13]. Le corps est pris au mot, car il a son mot à dire. Et dès qu’il y a un psychanalyste, le symptôme s’avère plutôt bavard. Le symptôme à déchiffrer de Roseline est l’écho dans son corps d’un mal dire de la mère, « tu es trop grosse ». Mais ce corps décharné sait aussi quelque chose, la tragédie des camps d’extermination que sa mère taisait.
La conversation a été vive et animée et est revenue, entre autres, sur le spectacle nazi de la destruction des corps et sur le rapport entre le silence de la pulsion et le corps parlant.
[1] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », Scilicet, Le corps parlant. Sur l’inconscient au XXIe siècle, Paris, Collection rue Huysmans, EURL Huysmans, 2015, p. 23.
[2] Scilicet, op. cit., quatrième de couverture.
[3] Lacan J., « Propos sur la causalité psychique », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 184.
[4] Lacan J., « La direction de la cure », op. cit., p. 600.
[5] Benjamin W., L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1939), Œuvres, III, Paris, Gallimard, 2000, p. 316.
[6] Milner J.-C., « À propos de la foule », entretiens réalisés par Pablo Lucchelli, Radio Lacan, http://www.radiolacan.com/fr/topic/653/5.
[7] Benjamin W., loc. cit.
[8] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Paris, Seuil, p. 17.
[9] Miller J.-A., op. cit. p. 32.
[10] Miller J.-A., « Biologie lacanienne », La Cause freudienne, n° 44, février 2000, p. 44.
[11] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », op. cit. p. 32.
[12] Ibid.
[13] Bonnaud H., Le corps pris au mot, Paris, Navarin, Le champ freudien, 2015, p. 52-57.
Lire la suite


![Scilicet, Le corps parlant. Sur l’inconscient au XXIe siècle[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/11/RochCorpsParlant21.png)

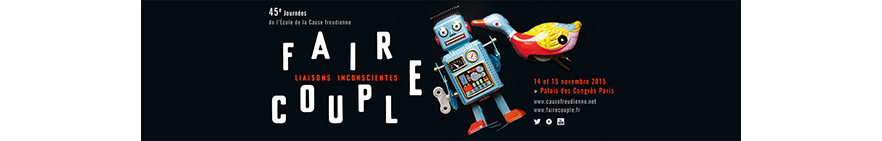



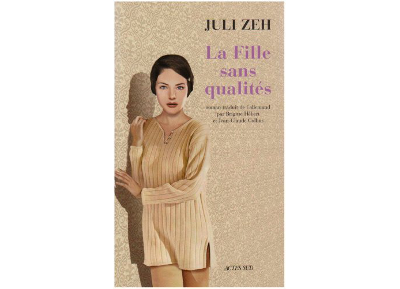
 Il s'agira d'Ada et d'Alev, couple d'adolescents dans un lycée allemand. Joëlle Hallet nous propose ici une lecture de l'instant : une cassure se produit dans un couple par le déplacement subjectif de l’un des deux partenaires. L'étonnant livre de l'écrivaine Juli Zeh, « La fille sans qualités », donne un aperçu sanglant d'un éveil du printemps contemporain.
Il s'agira d'Ada et d'Alev, couple d'adolescents dans un lycée allemand. Joëlle Hallet nous propose ici une lecture de l'instant : une cassure se produit dans un couple par le déplacement subjectif de l’un des deux partenaires. L'étonnant livre de l'écrivaine Juli Zeh, « La fille sans qualités », donne un aperçu sanglant d'un éveil du printemps contemporain.