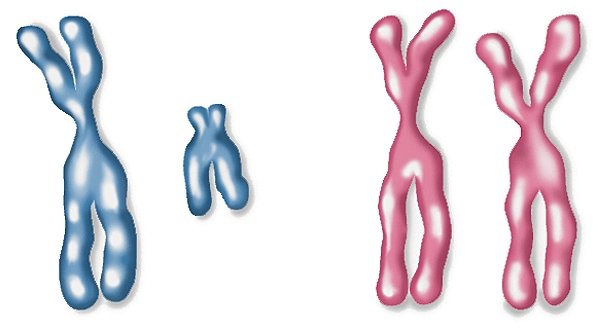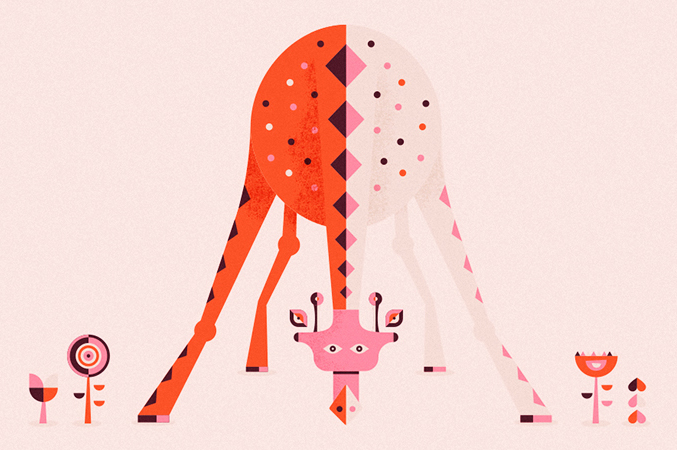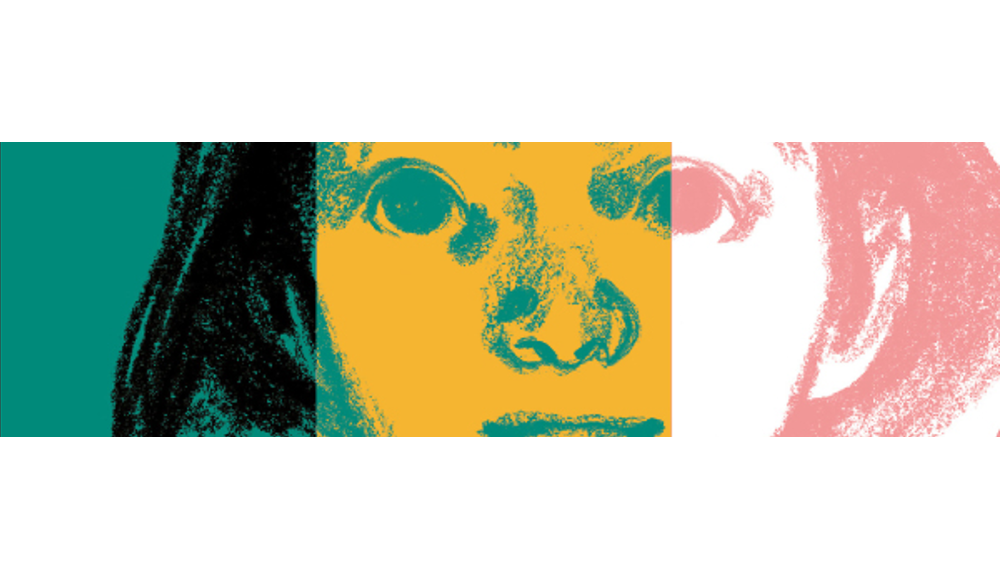Pornographie : censure du langage
« Ou bien tu jouis, ou bien tu parles ». Serge Cottet cerne avec justesse et drôlerie la logique d’un vel propre au porno.
Dans le hard sex, tel que les vidéos le diffusent depuis les années soixante-dix, on ne parle guère. Est-ce alors le corps parlant qui prendrait le relais ? Distinguons :
Il y a le porno chic. Il arrive que les sujets disent quelque chose, du moins dans les préliminaires. Dans l’un d’entre eux, l’incontournable Brigitte Lahaie entreprend une femme dans la rue et lui propose de venir chez elle : « On s’occupe de tout ». L’impersonnel, tel un Dieu du sexe, garantit que la maison ne lésinera pas sur les moyens ; vous en aurez pour vos fantasmes. Ce cliché racoleur, genre Club Med, fait mouche et la femme de rencontre cède (on n’a pas la suite sur Internet). De brefs préambules, un semblant de scénario bâclé en quelques mots font fonction de simple mise en bouche. À partir du moment où ça baise, comme dans le porno hard, on ne parle plus. Normal, la jouissance est muette. Silence, on jouit. Un bruitage tout terrain accompagne les exécutants. L’hyper-réalisme oblige à tout faire, tout montrer, toute honte bue : « Dans la gêne, il n’y pas de plaisir », n’est-ce pas ? Les X les plus nuls gomment toute transgression ; nul interdit, pas d’angoisse. Sex machine, le corps est rivé à un protocole mécanique où les fantasmes pervers, loin de maximaliser la jouissance, la ravale ; on baise comme on passe le balai. Au fait, qui jouit ? Le phallus certes, en gros plan, mais pas le porteur du phallus ; c’est la jouissance de l’idiot que ne dément pas l’acteur Rocco Siffredi, malgré son harem affamé. Lui, sans émotion, impassible, fait le boulot. Un seul interdit : la parole. L’ascèse analytique sert ici d’antonyme s’il en était besoin : abstinence, équivoque phallique du discours, tout dire, ne rien faire, le corps n’en parle que mieux.
Dans le porno, côté mâle, si l’organe jouit seul, si la jouissance est hors corps, est-ce que « ça parle » ? Rappelons que « la jouissance est interdite à qui parle comme tel », selon l’axiome lacanien. Tout se passe comme si les imbéciles en concluaient qu’elle n’est permise qu’à condition de se taire. Ou tu parles, ou tu jouis ! Non seulement le corps ne parle pas, mais il ne faut pas qu’il parle ; cette intrusion du langage dans l’acte émousse la jouissance : la moindre concession à la sublimation prive l’acte de son énergétique, telle une castration par le langage prise au pied de la lettre. La seule concession que le porno fait à cette disjonction, c’est l’expression du cri, pour la fille ; le seul signifiant autorisé pour le porteur du phallus est l’insulte : « Salope » !
Un cinéaste de la nouvelle vague, José Benazeraf (Joë Caligula, Le désirable et le sublime) avait dénoncé cette dérive du X avec la prétention de faire de l’art : « Le porno, c’est fasciste ! », disait-il. Il avait pour argument que la jouissance féminine n’était pas prise en compte ; il voulait la faire parler (Bordel SS 1978). Tâche difficile : le corps ne parle pas tellement dans ses films, mais on parle beaucoup en son nom. J. Benazeraf, auteur hybride, verbeux, subversif, mélangeait les genres. Entre Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Mocky dans les années soixante-dix, son slogan avait la cote : le sexe est politique ! Le porno côtoyait la philo : Spinoza, Hegel... Or, nul n’a été plus que lui visé par la censure ; son « anthologie » des œuvres censurées en DVD (1975) ne va pourtant pas loin ; diffusée un temps en salle et sur Canal Plus, J. Benazeraf la commente en voix off. Il voulait faire parler le sexe, on lui a coupé la parole : on ne compromet pas la culture avec le porno. Conclusion : le porno parlant est plus censuré que le hard.
Par contraste, on se souviendra de la scène du coït dans Les amants de Louis Malle, une des premières dans le cinéma français, en 1958. L’acte sexuel lui-même n’est pas filmé, tandis que l’expression de la jouissance de Jeanne Moreau est explicite. Avec la montée de l’orgasme, rythmant sa jouissance, elle répète de plus en plus fort : « Mon amour ! » dans les bras de son amant de rencontre. Aveu incongru, dérangeant. Le réalisateur a su tirer profit de la censure de l’époque, tout en révélant une censure plus obscure, moins contingente : un impossible de tout dire sur la jouissance féminine.
Tel n’est pas l’avis de B. Lahaie, la voix féminine du porno qui entend en dire toujours plus sur la femme. Depuis ses années hard sex, elle a lu Freud et repris du service hors champ : promue, dans les années quatre-vingts, grand prêtresse de la fellation sur les ondes de RMC pour l’édification des jeunes filles maladroites, elle donne aujourd’hui des leçons de savoir vivre.
Lire la suite