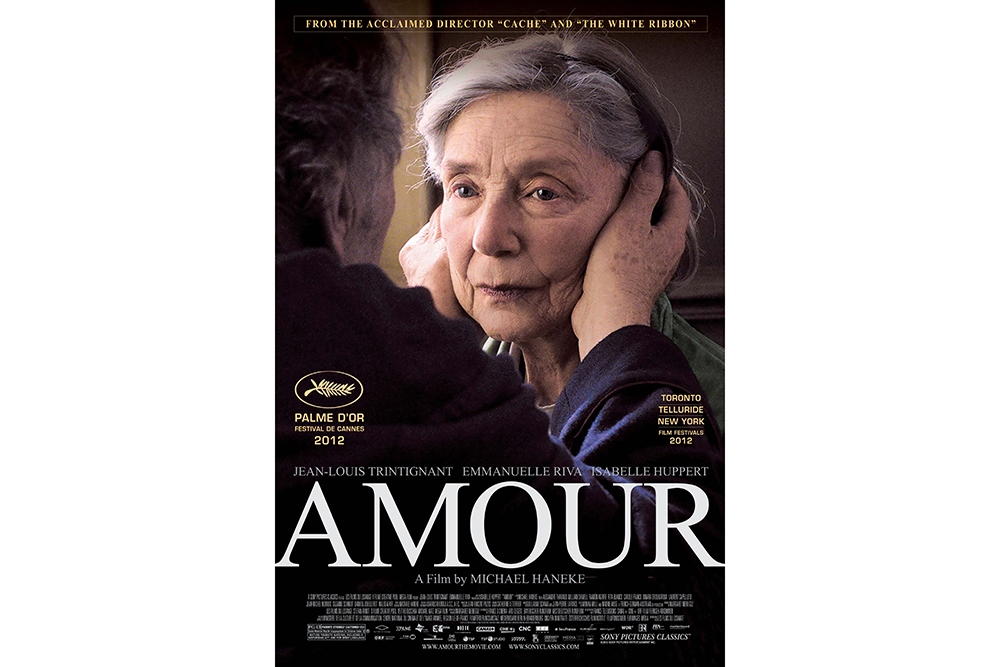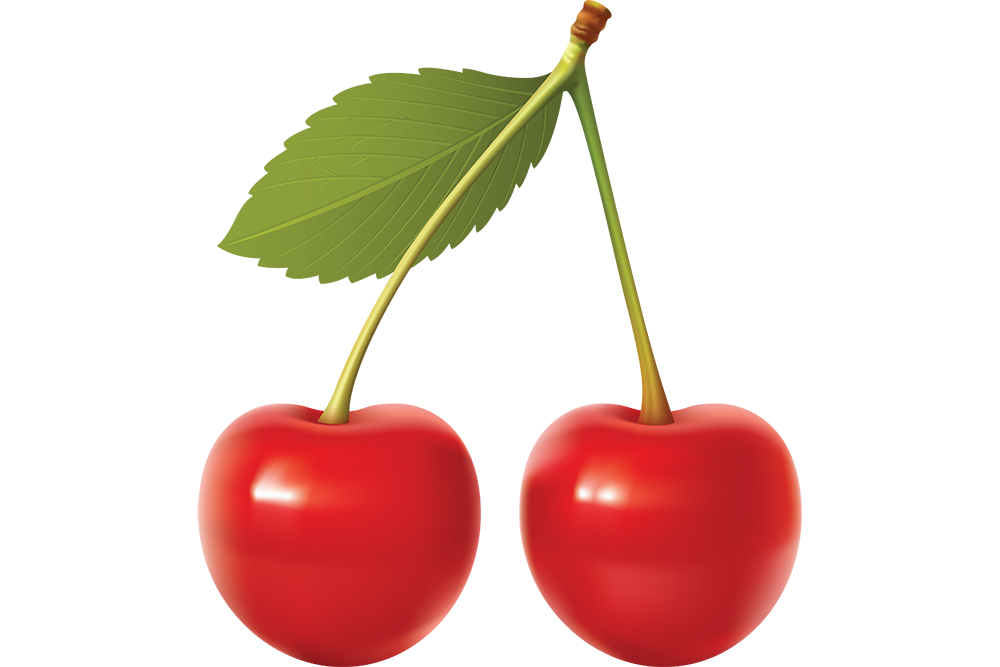Sonny & Cher, un coup de couple
https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/09/Sonny_Cher_-_I_got_you_Babe_-_Video_Dailymotion_3.mp4 Vus du XXIe siècle, les idéaux hippies, ceux de la contre-culture des années 60 ont laissé leurs traces, aujourd’hui,...
Lire la suiteDetails